|
Le 8 juin 2004, un phénomène rarissime va se
produire : la planète Vénus va passer devant
le Soleil. Aucun être humain vivant aujourd'hui n'a
vu de passage de la planète Vénus devant le
Soleil : le dernier passage remonte à1882... les astronomes
appellent ce phénomène un "transit"
de Vénus devant le Soleil.
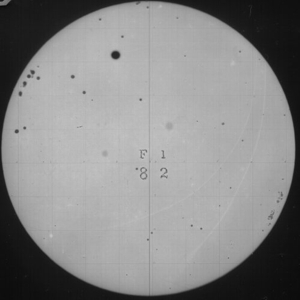
Une des rares photos du transit de 1882
Le transit est, tout simplement, le passage du disque sombre
de la planète Vénus devant le disque brillant
du Soleil. C'est en fait une mini-éclipse (très
partielle !) du Soleil puisque le diamètre apparent du Soleil
sera de 0,525° soit 31,5 mn d'arc alors que celui de Vénus
ne sera que de 0,016° soit 1 mn d'arc : en clair, Vénus
ne viendra couvrir que 3% du disque solaire.
Pour Fécamp, le transit aura lieu de 05 h 20 mn 4.6
sec à et 11 h 23 mn 39.7 sec en Temps Universel, soit,
en heure légale d'été, de 07 h 20 mn
4.6 sec à 13 h 23 mn 39.7 sec. Ces horaires peuvent
varier de quelques minutes en France métropolitaine. Vous
les trouverez pour chaque chef-lieu de département avec une
précision de l'ordre de la seconde sur le site Internet de
l'Institut
de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides qui
nous a fourni l'animation ci-dessous.

Pour observer ce passage dès le début, il faudra que votre
site d'observation dispose d'un horizon parfaitement dégagé
en direction de l'Est. En effet, à 7 h 20, le Soleil
ne sera encore qu'à 11° au dessus de l'horizon à Fécamp
et Toussaint. Par contre, à la fin du transit, aucun
problème : le Soleil sera perché à presque
62° au-dessus de l'horizon.
Il faut rappeler que l'observation du Soleil peut être dangereuse
: regarder le Soleil sans protection peut entraîner des dégats
définitifs sur la rétine de l'oeil. Ne faites donc
pas n'importe quoi ! Les consignes
de sécurité à respecter sont les
mêmes que celles qu'il fallait appliquer lors de l'éclipse
de Soleil du 11 août 1999. Et si vous ne souhaitez pas
appliquer ces consignes, allez vous acheter au préalable
une jolie canne blanche...
L'observation du transit à l'oeil nu :
L'observation du Soleil et du transit de Vénus à
l'oeil nu nécessite des lunettes spéciales en
polymère noir ou en Mylar. Des verres de soudeur sont
utilisables à condition qu'ils soient d'un grade au
minimum égal à 13. Toute autre méthode
est interdite car trop dangereuse : si vous souhaitez savoir
jusqu'où peut aller la stupidité, consultez
le dossier des 10 bêtises à
ne pas faire pour observer le Soleil. La feuille format
A4 de polymère coûte environ 10 euros, la feuille
A4 de Mylar environ 20 euros (plus fragile mais de meilleure
qualité optique que le polymère). Vous pouvez en commander
à la librairie scientifique Uranie (polymère noir), à la Maison de l'Astronomie (polymère
noir et Mylar).

L'observation du transit par projection :
Vous pouvez également projeter l'image du Soleil au
travers d'une paire de jumelles ou d'un télescope sur une
feuille blanche ou un écran. Pour que l'image soit bien visible,
l'écran est mis à l'ombre (avec un carton sur le schéma
ci-dessous).
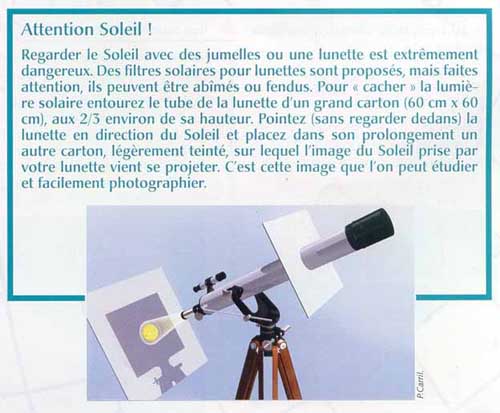
Cette méthode présente une bonne sécurité
pour vos yeux à une condition impérative : restez toujours
à côté de votre télescope afin
de veiller à ce qu'aucun inconscient ne vienne regarder
dans l'oculaire ! Et vous pouvez être sûrs
qu'il y aura toujours une ou deux personnes pour tenter le
coup dès que vous aurez le dos tourné... A cette
restriction près, la méthode d'observation par projection
vous montrera sans problème le disque noir de Vénus sur le
disque lumineux du Soleil.

Un appareil a été réalisé sur le même principe, le
"solarscope", développé en partenariat avec l'observatoire
de la Côte d'Azur. Le Soleil est projeté directement sur un
écran au moyen d'un petit tube doté d'une lentille
grossissante.

La position de la lentille a été calculée
pour empêcher qu'un spectateur imprudent ne puisse se
brûler la rétine. Le solarscope est certainement
actuellement le meilleur système d'observation en public
du Soleil, notamment avec des enfants. Vous trouverez tous
les renseignements sur le site Internet du solarscope. Il coûte aux alentours de 60 euros
dans le commerce et 49 Euros en cas d'achat direct en ligne
(transport non compris).
L'observation directe du transit avec un télescope
:
En ce cas, la seule méthode sûre pour vos yeux
consiste à placer un filtre à l'entrée de l'instrument.
Vous pouvez en confectionner un vous-même avec une feuille
de Mylar ou de polymère noir analogue à ceux
utilisés pour les lunettes d'éclipse. Vérifiez
cependant systématiquement avant toute utilisation
de votre filtre-maison qu'il ne comporte aucun petit trou,
aucune rayure sous peine de courir le risque d'y griller,
bêtement, votre rétine.
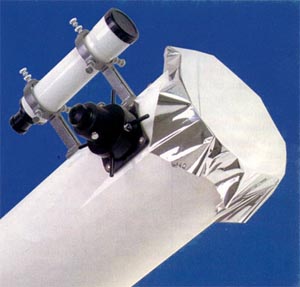
L'achat, dans un magasin d'optique spécialisé
en astronomie, d'un filtre en verre aluminisé vous
garantira par contre une sécurité totale. Certes,
ces filtres sont plus coûteux (de 75 à 150 euros)
mais vos yeux valent peut-être cet investissement...

Un dernier point : si vous disposez d'un petit filtre "sun"
pour l'oculaire de votre télescope, jetez-le à
la poubelle... sous l'influence des rayons solaires concentrés
par le télescope, ce genre de camelote vous éclate
régulièrement à la figure en pleine observation.
Ne vous en servez jamais !!!!!!!
Enfin, les plus fortunés d'entre vous équiperont
leur télescope d'un filtre H-alpha, qui permet d'observer
le Soleil dans la longueur d'onde de l'hydrogène, celles
des protubérances du Soleil : voir le disque de Vénus
se déplacer devant les "flammes" du Soleil
sera un spectacle fabuleux. L'Observatoire Européen
du Sud a filmé ainsi en 2003 le passage de Mercure
devant le Soleil : cliquez sur l'image ci-dessous pour admirer
l'animation que nous en avons tirée (270 Ko).
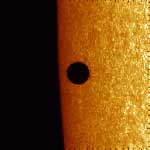
Ce que vous verrez le 8 juin 2004 :
Les astronomes distinguent plusieurs instants bien précis
dans ce passage de Vénus devant le Soleil : l'instant
où le bord de Vénus touche le bord du Soleil
est appelé le 1° contact. L'instant où la
totalité du disque de Vénus est entré
sur le Soleil est appelé 2° contact. Inversement,
le 3° contact est l'instant où le bord de Vénus
s'apprête à ressortir du disque solaire et le
4° contact est celui où la totalité du disque
vénusien a quitté le Soleil.
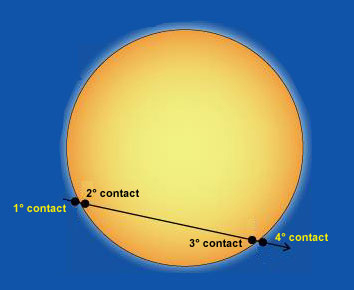
Les 4 contacts lors du transit de Vénus
Les 1° et 4° contacts ne sont pas toujours faciles
à repérer dans le tremblotement que présente
toujours dans un télescope le bord du Soleil en raison
de la chaleur dégagée par ce dernier. Par contre,
les 3° et 4° contacts sont facilement visibles.
Mais les possesseurs de télescopes équipés
de filtres spéciaux assisteront sans doute au phénomène visuel
de "l'arc de lumière" décrit par Camille
Flammarion (fondateur de la Société Astronomique de France),
dans sa description du transit de Vénus du 6 décembre 1882
: quelques minutes après le premier contact de Vénus - son
bord côté Est s’étant engagé sur le disque solaire -, un arc
très lumineux apparut contre son bord Sud et s’étendit progressivement
par l’Ouest et le Nord : le Soleil illuminait donc la couche
atmosphérique de la partie encore externe du disque de Vénus.

Simulation de "l'arc de lumière"
Le phénomène dura une quinzaine de minutes, le temps pour
la planète Vénus de s’engager complètement sur le disque
solaire. A ce moment-là, l’arc disparut, faisant place à un
second phénomène visuel, dit de "la goutte noire"
: le petit disque sombre sembla alors être raccordé au bord
du Soleil par un court ligament, sombre lui aussi, donnant
l’impression d’une goutte qui va se détacher. Puis, une fois
le 3° contact fini et Vénus totalement engagée
sur le disque du Soleil, la "goutte noire" disparut
à son tour. Le phénomène de « la goutte noire » est bien connu
des astronomes car on le retrouve lors des transits d’une
autre planète, Mercure, laquelle par contre ne produit pas
l’effet de l’arc lumineux puisqu’elle ne possède pas d’atmosphère.
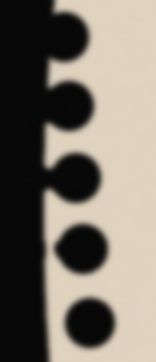
La "goutte noire" lors du transit de Mercure en
2003
Si les 3° et 4° contacts sont aisément repérables,
par contre leur chronométrage exact est parfois un
peu délicat en raison de l'effet "goutte noire".
|
premier contact |
05 h 20 mn 4.6 s |
arc de lumière |
|
second contact |
05 h 39 mn 47.6 s |
goutte noire |
|
troisième contact |
11 h 04 mn 19.8 s |
goutte noire |
|
quatrième contact |
11 h 23 mn 39.7 |
arc de lumière |
Horaires des 4 contacts pour Fécamp
La rareté des transits de Vénus :
Pourquoi donc ce phénomène est-il si rare ?
La planète Vénus tourne autour du Soleil en
225 jours. Nous devrions donc voir ce phénomène
à chaque tour, c'est à dire à chaque
conjonction entre Vénus et le Soleil. Ce serait vrai
si Vénus et la Terre tournaient autour du Soleil dans
le même plan. Mais le plan orbital de Vénus est
incliné de 3 degrés environ par rapport au plan
orbital de la Terre : de ce fait, Vénus passe le plus
souvent au-dessus ou au-dessous du disque solaire et nous
ne voyons alors pas de transit. La figure ci-dessous, fournie
par l'Institut de la Mécanique Céleste et de
Calcul des Ephémérides, montre bien ce phénomène.
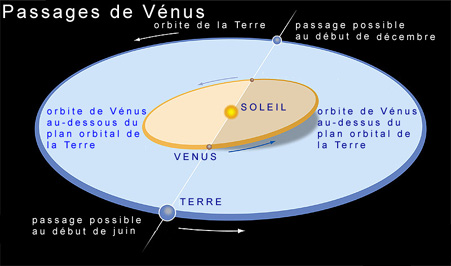 On voit ainsi qu'il n'y a qu'une seule possibilité
pour qu'il y ait un passage de Vénus devant le Soleil
: il faut que le Soleil, Vénus et la Terre soient parfaitement
alignés sur la ligne d'intersection des deux plans
orbitaux (les astronomes appellent cette ligne la "ligne
des noeuds"). La Terre ne croise cette ligne qu'en juin
et en décembre, comme le montre parfaitement la petite maquette
ci-dessous, réalisée par le
comité de liaison enseignants - astronomes (CLEA).
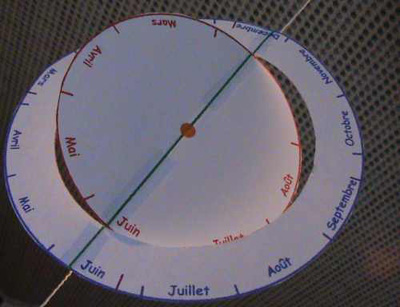
Le problème, c'est que Vénus et la Terre ne se trouvent
simultanément sur ces noeuds que très rarement, environ deux
fois par siècle comme le montre le tableau ci-dessous
des dates de transit :
| 7 décembre 1631 |
| 4 décembre 1639 |
| 6 juin 1761 |
| 3 juin 1769 |
| 9 décembre 1874 |
| 6 décembre 1882 |
| 8 juin 2004 |
| 6 juin 2012 |
Pour mieux comprendre la périodicité de ces
transits de Vénus, vous pouvez consulter notre page
spéciale "prise de tête".
La rareté extrême des transits de Vénus
devant le Soleil explique pourquoi les
astronomes dans le passé ont toujours attendu avec
beaucoup d'impatience ces rendez-vous et ce, d'autant
plus, que c'est grâce à ces transits qu'a pu
être calculée précisément la distance
qui sépare la Terre du Soleil. Il fallait pour celà
que deux équipes d'astronomes, postés en deux
endroits différents de la surface de la Terre, observent
au même instant le transit de Vénus : les astronomes
postés en A voyaient le disque de noir de Vénus
en C sur le Soleil, pendant que les astronomes postés
en B le voyaient en D.
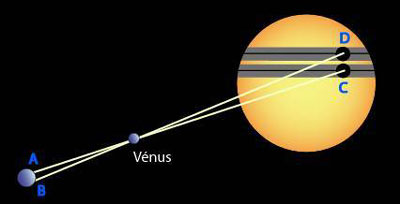
A partir de là, le reste n'est plus qu'affaire de
géométrie et de calculs plus ou moins savants
que nous vous proposons de découvrir, en refaisant
le cheminement du grand astronome
du XVII° siècle Edmund Halley.
Vous pouvez vous aussi profiter du passage de Vénus
devant le Soleil, ce 8 juin 2004, pour recalculer
vous-même la distance Terre-Soleil. D'autres méthodes
existent également que vous toruverez décrites
sur les sites Internet suivants :
Comité
de Liaison Enseignants-Astronomes : ce site est très
bien adapté aux collégiens, lycéens et
à leurs enseignants.
La
Main à la Pâte : ce site est épatant
pour les enseignants du cycle 3 du primaire qui y trouveront
plein d'idées d'expériences pratiques pour leur
élèves.
Enfin, les lycéens plus âgés peuvent
participer, grâce à Internet, à la campagne
internationale 2004 de mesure de la distance Terre-Soleil
organisée par l'Institut
de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides avec
le concours du Ministère de l'Education Nationale et
la Recherche ou bien sur le site
européen Futura-Sciences.
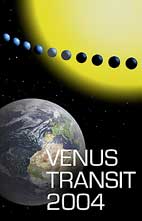
|