CLASSIFICATION DES METEORITES :
Leur classement n'est pas toujours aisé. Plusieurs tentatives de classification sont possibles. La classification la plus courante regroupe les météorites en 3
grandes familles :
- les météorites pierreuses ou aérolithes.
- les météorites riches en métal (alliage de fer et nickel)
ou sidérites
- les météorites mixtes ou métallo-pierreuses appelées sidérolithes.
1. Les aérolithes :
Parmi les aérolithes, si la surface présente des petites cavités on
parle de chondrites (les cavités sont appelées des chondres
par les géologues), et dans le cas contraire d'achondrites.
| 
|

|
| Chondrite :
la météorite de Pultusk |
Achondrite :
la météorite de Chassigny |
79% des météorites sont des chondrites. On ne sait pas
comment elles se forment, mais on suppose qu'elles proviennent de la
ceinture d'astéroïdes situés entre les orbites des planètes
Mars et Jupiter . Les chondrites carbonées représentent 5% des météorites
et contiennent des traces de matière organique, dont des acides aminés.
Leurs ratios d'isotopes sont similaires à ceux du Soleil et on suppose
qu'elles proviennent de la nébuleuse gazeuse d'où est né
notre Soleil. 8% des météorites sont des achondrites. Les achondrites
(= météorites de pierre sans chondres) proviennent de la croûte ou du
manteau d'un astéroide : elles ont vraisemblablement subi une cristallisation
à partir d'un magma en fusion. Par leur texture, leur composition minéralogique
et chimique, elles ressemblent à certains basaltes terrestres d'origine
volcanique
2. Les sidérites :
Environ 6% des météorites sont des météorites contenant des alliages
métalliques à base de fer et de nickel. On pense qu'elles
proviennent du noyau même de leur corps parent. Ces météorites
contiennent des structures très particulières que les minéralogistes
ont su mettre en évidence en polissant ces météorites
avant d'y appliquer un peu d'acide : les
figures de Widmanstätten. Il s'agit de lames de nickel qui viennent
traverser la masse métallique de la météorite, bien
visibles sur la partie droite de la météorite ci-dessous.
Ces structures sont dues à un lent refroidissement du noyau de l'astéroide
qui a permis la séparation des composants du métal en fusion, en
alliages de teneurs en nickel différentes
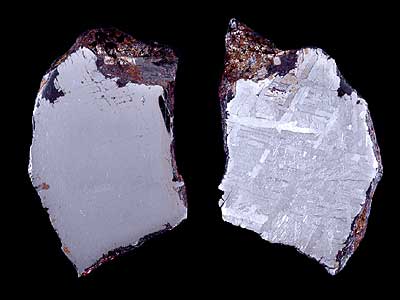
la météorite de Toluca et ses figures de Widmanstätten
(à droite)
3. Les sidérolithes :
Elles représentent 2% des météorites. Elles contiennent des mélanges
de silicate et fer-nickel. On pense qu'elles sont originaires de la zone
frontière située juste au-dessus du noyau des astéroïdes,
d'où proviennent les météorites ferreuses.
LA MEMOIRE DES ORIGINES
En regardant d'un peu plus près leur composition, les géologues
distinguent les météorites différenciées et les météorites non différenciées.
La différenciation est la séparation en plusieurs phases d'un mélange
de roches en fusion. Par exemple, la Terre, formée d'un noyau métallique,
d'un manteau rocheux et d'une croûte, est une planète différenciée. Les
météorites différenciées proviennent d'astéroïdes dont la température
s'est élevée suffisamment pour permettre un début de processus
de différenciation comparable à celui de la Terre. Elles comprennent les
météorites de fer, composées essentiellement de fer et de nickel, qui
sont pour la plupart des fragments de noyaux d'astéroïdes différenciés;
les pallasites et les mésosidérites faites pour moitié environ d'un mélange
de fer et de nickel et pour moitié de silicates; et les achondrites, dont
les plus nombreuses sont des laves volcaniques provenant de la croûte
d'un astéroïde différencié, vraisemblablement Vesta, le troisième plus
gros astéroïde.

Les météorites non différenciées, que l'on désigne sous le nom de chondrites,
viennent d'astéroïdes dans lesquels n'a jamais régné une température suffisante
pour faire fondre les roches. Elles conservent de ce fait la mémoire des
premiers instants du système solaire. Ainsi, l'analyse des chondrites
nous donne une bonne idée de ce qu'était la composition chimique globale
de la nébuleuse solaire, le nuage de gaz et de poussières d'où est né
le Soleil et le système solaire.
Les roches différenciées (terrestres, météoritiques lunaires. . .) ayant
été fondues à un moment ou à un autre depuis la naissance des planètes,
la structure initiale des matériaux constitutifs de celles-ci y est définitivement
perdue. On la retrouve, au contraire, dans les chondrites, faites en grande
partie de petites billes de 1/10 de millimètre à quelques millimètres
de diamètre, composées essentiellement de silicates : les chondres. Ceux-ci
existaient dans la nébuleuse solaire avant la formation des planètes.
Nous voyons donc encore dans les chondrites les "briques " élémentaires
qui ont servi à la construction des planètes.
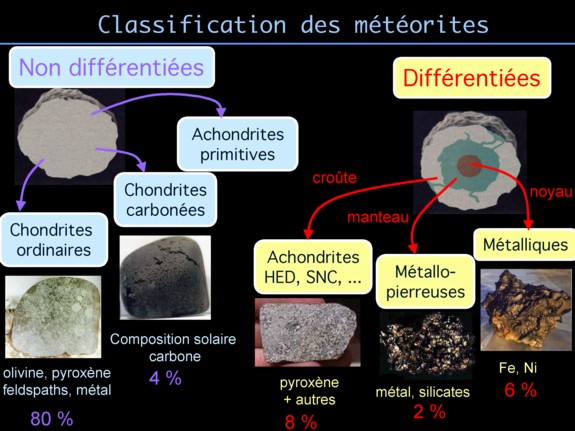
L'AGE DU SYSTEME SOLAIRE
L'âge des météorites, que l'on détermine grâce
à la radioactivité naturelle, est en général compris entre 4,40 et
4,56 milliards d'années. Leurs différences d'âge reflètent des différences
dans l'évolution ancienne de leur température. Les objets les plus anciens
que l'on ait datés sont les inclusions réfractaires des chondrites. Ce
sont de petits ensembles de minéraux formés à haute température. Elles
ont un âge de 4,566 milliards d'années, à 2 millions d'années près. Ce
sont probablement les premiers solides qui se soient formés dans le système
solaire. C'est leur âge que l'on adopte pour celui du système solaire
lui-même.
DE LA POUSSIERE D'ETOILES
La mémoire des chondrites va au-delà de la naissance du système solaire.
Ces météorites contiennent en effet de minuscules cristaux de diamant,
de carbure de silicium, de graphite et d'alumine. L'étude fine des éléments
chimiques constitutifs de ces grains (carbone, silicium, oxygène...) montre
que ces derniers sont très différents de la matière du système solaire.
Ils ont pris naissance au voisinage de divers types d'étoiles (géantes
rouges, supernovae, novæ...), à partir de la matière synthétisée et rejetée
par celles-ci. Après avoir voyagé dans l'espace interstellaire, ils se
sont retrouvés dans la nébuleuse solaire, où ils ont été incorporés dans
les solides en formation. On les rencontre encore dans les chondrites.
Leur étude constitue une nouvelle forme d'astronomie, actuellement en
plein développement.
C'est ainsi que plusieurs études minéralogiques récentes
tendent à remettre en cause l'hypothèse actuelle qui voudrait
que notre système solaire soit issu d'un énorme nuage de
poussières et de gaz, la nébuleuse primordiale, qui aurait
été déstabilisé par l'explosion d'une étoile
voisine. Il y a 4.6 milliards d'années, un cataclysme terrifiant
aurait agité notre coin de galaxie : une étoile géante
en fin de vie aurait explosé en supernova. Le souffle de ce désastre
aurait alors frappé de plein fouet notre nébuleuse primordiale
qui errait dans les parages. Sous la violence de l'onde choc, ce nuage
se serait trouvé déséquilibré et serait entré
en rotation rapide sur lui-même pour former un disque de poussières
et de gaz d'où seraient nés une petite étoile jaune
et son cortège d'astres froids : le Soleil et ses 9 planètes.
Voilà le scénario qui fait figure d'histoire officielle
depuis 30 ans.
Mais l'analyse minéralogique d'une très ancienne météorite,
découverte en 1969 près de Pueblito de Allende, dans le
nord du Mexique, est venu chambouler ce beau scénario bien ficelé

météorite Allende
En 1976, 3 chimistes ont découvert dans les chondres de la météorite
d'Allende une teneur anormalement élevée en magnesium 26,
isotope rare du magnésium produit par la désintégration
de l'aluminium 26, une variété instable de ce métal.
Il y aurait donc eu de l'aluminium 26 dans la nébuleuse primordiale
? Mais gros pépin : la très courte durée de vie de
cette forme d'aluminium (moins de 740 000 ans) ne collait pas avec l'âge
du système solaire, âgé, lui de 4.6 milliards d'années.
A l'époque, les astrophysiciens avaient trouvé une parade
en émittant l'idée que cet aluminium aurait été
injecté dans notre nébuleuse primordiale par le souffle
d'une supernova proche : la supernova serait donc bien responsable et
de la formation du système solaire et de la présence de
métaux exotiques dans la météorite d'Allende. Ouf,
on avait eu chaud mais la théorie de la supernova tenait toujours
le coup ! En 2000, nouvel accroc : le cosmochimiste Kevin Mc Keegan découvre
dans la météorite d'Allende un nouvel élément
à durée de vie courte : le béryllium 10, qui, lui
est consommé par les étoiles et mais n'est en aucun cas
produit par l'explosion d'une supernova. Fin 2003, autour d'un français,
Marc Chaussidon, d'identifier un nouvel élément encore plus
éphémère, le béryllium 7, dont la période
n'est que de 53 jours, un délai bien trop court pour qu'une supernova,
aussi gigantesque soit-elle, puisse ensemencer avec cet élément
toute une nébuleuse de gaz et de poussières. Une autre théorie
est alors mise en selle : les nuages moléculaires interstellaires
ont tendance à se fragmenter spontanément, sans intervention
extérieure, en "grumeaux" dont l'effodnrement donne naissance
à des étoiles de faible masse... comme notre Soleil. Les
proto-étoiles ainsi formées émettent un fort rayonnement
X et ultra-violet qui interagit violemment avec la nébuleuse qui
les entourent. Ce flux énergétique expliquerait la présence
d'aluminium 26, ainsi que les concentrations observées en béryllium
7 et 10.
Cependant, la question n'est toujours pas tranchée car on vient
de trouver un nouvel isotope dans les météorites les plus
anciennes : du fer 60. Cette forme de fer ne peut en aucun cas avoir été
produit par l'irradiation d'une proto-étoile mais est au contraire
produit par l'explosion d'une très vieille étoile ! Le débat
reste donc très ouvert... |