|
Lorsqu'on demande à une personne de citer les objets du
système solaire qu'elle connaît, les noms pleuvent
: Jupiter, Saturne et ses anneaux, Mars, les comètes, etc...
Mais les astéroïdes sont presque toujours oubliés...
mondes lointains, glacés, perdus dans l'immensité
du ciel.
Bien qu'on en connaisse plusieurs dizaines de milliers, les astéroïdes
restent presque impossibles à observer à l'oeil nu : ils sont bien
trop petits, comparativement aux planètes et donc très peu lumineux.
Malgré leur nombre ils ont chacun un espace vital de plusieurs millions
de kilomètres ce qui rend les risques de collisions bien faibles.
La masse totale de tous les astéroïdes réunis est inférieure
à celle de la Lune.
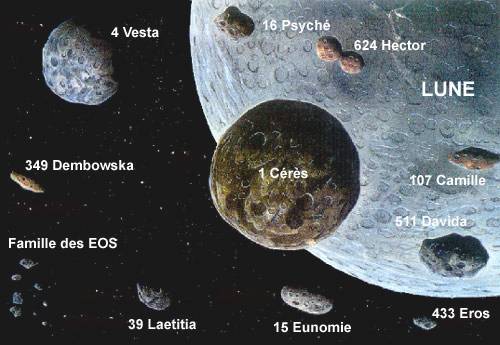
Taille comparée des plus gros astéroïdes et
de la Lune
L'astéroïde Vesta est l'exception : c'est le seul qu'il soit parfois
possible d'observer sans appareil optique. Sa luminosité n'étant
toutefois pas très grande, il faut savoir où tourner les yeux :
dans le ciel nocturne un astéroïde ressemble à une minuscule étoile
! Le meilleur moyen pour partir à la chasse aux astéroïdes avec
ses jumelles ou son télescope est d'observer le fond étoilé plusieurs
nuits d'affilées et de détecter les points lumineux qui se déplacent
par rapport aux étoiles du fond du ciel.
|

|
4 astéroïdes
sont cachés sur cette photo... Pour les trouvez, cliquez
sur l'image ci-dessus ! |
1. LA DECOUVERTE DE LA CEINTURE PRINCIPALE DES ASTEROIDES
Le premier astéroïde fut découvert par Giuseppe Piazzi, directeur
de l'observatoire de Palerme, en Sicile. La veille du jour de l'an
1800, ce dernier observait la constellation du Taureau, lorsqu'il
aperçut par hasard un objet non identifié se déplaçant très lentement
sur le fond étoilé. Il examina le déplacement de cet objet pendant
plusieurs nuits. Le jeune mathématicien Carl Frederich Gauss,
24 ans, utilisa les données de Piazzi pour mettre à l'épreuve
sa nouvelle méthode de calcul des orbites et parvint à
déduire en un temps record la distance exacte et l'orbite de cet
objet inconnu. Ses calculs plaçaient l'astre entre la planète
Mars et Jupiter. Piazzi le nomma Cérès, du nom de la déesse grecque
qui fait sortir la sève de la terre et qui fait pousser les jeunes
pousses au printemps. Le 7 décembre 1801, bingo ! L'astronome
Von Zach réussit à retrouver Cérès à
l'endroit précis calculé par Gauss !

Giuseppe Piazzi (1764-1826)
Sur le moment, Piazzi et Gauss crurent avoir enfin découvert
la mystérieuse "planète 28", la planète
qui manquait à l'appel, entre Mars et Jupiter. Depuis les
travaux de 1772 de l'astronome allemand Bode, tous les astronomes
s'interrogeaient sur cette planète hypothétique :
Bode avait en effet trouvé que les positions des planètes
du système solaire connues à l 'époque s'accordaient
avec une loi empirique découverte par le mathématicien Titius.
Mais la loi de Titius-Bode avait cependant un accroc : elle prédisait
l'existence d'une planète entre Mars et Jupiter, à environ
2.8 Unités Astronomiques (l'UA étant égale
à la distance Terre-Soleil, soit 149 597 870 km). Planète
que personne ne trouva... au tournant du XIXe siècle, un grand espace
vide s'étendait donc entre Jupiter et Mars.

Lorsque le 1er janvier 1801, Piazzi découvrit fortuitement Cérès,
il eût l'espoir d'avoir comblé ce trou. Mais très
vite, il fallut déchanter : Cérès était
bien trop petite pour mériter le titre de planète;
tout juste 1003 km de diamètre ! Un an plus tard, l'astronome
Olbers découvrit une deuxième petite planète, Pallas (608 km de
diamètre) à peu près à la même distance. Puis, ce fut le
tour de Juno, puis de Vesta.

Les découvertes se succédèrent ensuite à un rythme rapide.
L'évidence crevait les yeux : l'espace libre laissé par la
loi de Titius-Bode entre les orbites de Mars et de Jupiter était
peuplé par une myriade de planètes mineures que l'on baptisa
astéroïdes sur la proposition de l'astronome William Herschel. En
1868, 100 astéroïdes avaient déjà été
repérés. Mais toujours pas de véritable planète
dans le secteur...
L'invention de la photographie astronomique devait entraîner
un grand boum dans le nombre de découvertes : 1000 en 1923,
13 000 en 1999. Là où les observateurs visuels devaient
attendre plusieurs nuits pour voir leur astéroïde se
déplacer sur le fond du ciel, les astrophotographes n'avaient
qu'à laisser filer leur pose photographique durant plusieurs
minutes pour voir sur le cliché le déplacement de
l'astéroïde sous la forme d'une petite traînée.
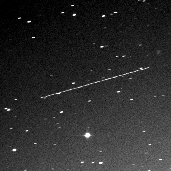
La traînée photographique de l'astéroïde
Toutatis
C'est l'astronome Max Wolf qui, en 1891, fit cette découverte,
tout à fait par hasard. Enchanté de cette trouvaille,
Max Wolf la mit immédiatement en application, ce qui lui
permit de faire un véritable carton : 248 astéroïdes
ont été débusqués par cet astronome,
dont 4 d'un seul coup lors de la nuit du 25 septembre 1892 !!! Aujourd'hui,
tous ces corps constituent la Ceinture Principale des Astéroïdes,
située entre Mars et Jupiter, entre 310 et 520 millions de
kilomètres du Soleil (= 2 et 3.5 Unités Astronomiques). Cette
ceinture mesure d'environ 200 millions de kilomètres de large (
= 1.3 UA seulement).

Image Thomas Roussel / ASCT-astronomie
2. LA VERMINE DU CIEL
La photographie systématique du ciel a permis de répertorier aujourd'hui
plus de 30 000 astéroïdes. Dans les années 50,
le nombre d'astéroïdes était devenu tel que beaucoup
d'astronomes les avaient surnommés "la vermine du ciel"
: c'est ainsi que sur certaines photographies du ciel prises par
le télescope du Mont Palomar, dans les années 1950,
on peut détecter jusqu'à une centaine de traces d'astéroïdes.
Il fallait alors un bon après-midi de boulot pour mesurer
et calculer les orbites de toute cette ménagerie, avec les
moyens de l'époque, à savoir une règle à
calculer, une table de logarithmes, une feuille de papier et un
crayon...
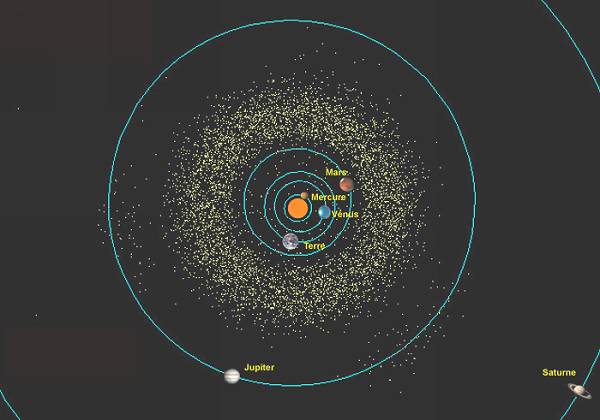
La position des 5781 principaux astéroïdes connus
au 7 juillet 1996
Jusqu'au XXe siècle, les astéroïdes ont été
largement délaissés du champ d'investigation des astronomes
professionnels, en raison de leur petitesse et de leur éloignement
qui rendaient impossible toute observation : seules étaient
connues, approximativement, leurs orbites et leurs masses.
L'analyse de leur courbe
de lumière et de leur spectre lumineux a parfois
permis de glaner quelques informations supplémentaires
sur leur forme et leur composition
chimique. Bien maigre moisson...
La découverte de plusieurs nouvelles familles d'astéroïdes
circulant en dehors de la Ceinture Principale est venue relancer
l'intérêt des astronomes pour ces petits corps :
La famille des astéroïdes géocroiseurs mérite
une attention particulière. Certains astéroïdes,
comme Eros, ont une orbite qui plonge vers l'intérieur du
système solaire ce qui peut les amener à croiser la
route de la Terre...
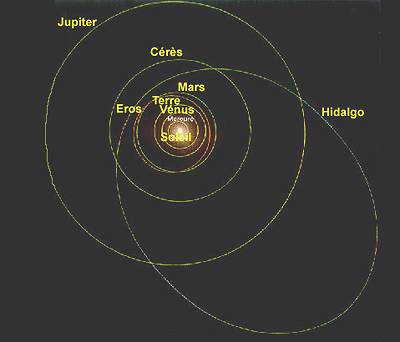
... Et qui dit croisement d'orbite dit risque de collision ! Les
spécialistes de la préhistoire sont à peu près
certains que de telles catastrophes ont déjà frappé
notre Terre dans le passé et que c'est un choc de cette nature
qui a entraîné l'extinction des dinosaures

Aujourd'hui fonctionnent plusieurs programmes de surveillance de
ces astéroïdes géocroiseurs, potentiellement
dangereux pour la Terre. Le plus connu est le programme LINEAR.
Ce dernier programme possède cependant une face cachée
: il s'agit également d'un programme militaire américain,
destiné à mener la "guerre des étoiles"
3. LES DECOUVERTES DES ASTRONOMES AMATEURS
L'invention des caméras électroniques CCD a accru
de façon considérable le nombre de découvertes,
et a totalement supplanté la technique photographique traditionnelle
en raison de leur extraordinaire sensibilité. Mieux : la
baisse des prix de ces caméras CCD a permis également
à des astronomes amateurs motivés de s'équiper
et de se tailler ainsi leur part du gâteau, en découvrant
eux aussi de nombreux astéroïdes.
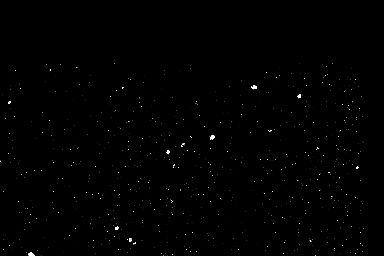
Les champions incontestables de ces chasseurs amateurs d'astéroïdes
sont sans conteste les époux van Houten (1010 découvertes
pour Monsieur et 1008 pour Madame !!!). Les japonais sont également
très fortiches à ce petit jeu, à l'instar de
Takao Kobayashi, qui a accumulé 567 découvertes homologuées
!
Il y a même un astéroïde baptisé 4179
Toutatis par son découvreur, le français Alain Maury.
Ce dernier a également proposé que les cratères
qui parsèment la surface de cet astéroïde soient
baptisés de noms tirés de la BD "Astérix".
Mais l'Union Astronomique Internationale n'a pas encore donné
son feu vert... Une spectaculaire animation de la rotation chaotique
de Toutatis sur lui-même est disponible en cliquant sur l'image
ci-dessous (format mpeg, 483 Ko).
4. LA CEINTURE DE KUIPER ET LES OBJETS TRANS-NEPTUNIENS
Equipés également de caméras CCD (mais en
plus gros !), les télescopes professionnels sont parvenus
à mettre en évidence l'existence d'une deuxième
ceinture d'astéroïdes loin, très loin du Soleil,
bien au-delà des orbites de la planète Neptune et
de la planète Pluton : la ceinture de Kuiper.

Le premier membre de cette famille de petits corps glacés
situés au-delà de la planète Neptune a été
appelé QB1. Il a été découvert en 1992 par
David Jewitt et Jane Luu. On en dénombre aujourd'hui un peu
plus de 1000 mais on estime que la ceinture de Kuiper contient plus
de 70 000 de ces astéroïdes que les astronomes anglo-saxons
appellent les Objets Trans-Neptuniens (TNO).

Les plus gros des objets trans-neptuniens sont restés tels
qu'ils se sont formés, lors de la naissance du système
solaire, voici 4.5 milliards d'années et sont donc de véritables
fossiles vivants, ce qui intéresse au plus haut point les
astronomes.
5. LES IMAGES DES SONDES SPATIALES
Il a fallu attendre la conquête spatiale pour enfin voir
de près quelques astéroïdes. Les premières images
d'un astéroïde sont l'oeuvre de la sonde Galileo qui a mis à
profit son voyage vers la planète Jupiter pour photographier
au passage les astéroïdes Gaspra en 1991 et Ida en 1993.
Les astronomes eurent la surprise de découvrir qu'Ida possédait
un minuscule satellite en orbite autour de lui, qui fut baptisé
Dactyle.
 |
 |
L'astéroïde 951 Gaspra
Photo NASA / JPL |
L'astéroïde 243 Ida et son satellite
Photo NASA / JPL
|
Puis, ce fut la sonde NEAR-Shoemaker qui s'est approchée
en 1997 de l'astéroïde Mathilde. Un film spectaculaire
de cette approche est disponible en cliquant sur la photo ci-dessous
de l'astéroïde (format mpeg, 226 Ko).
|

|
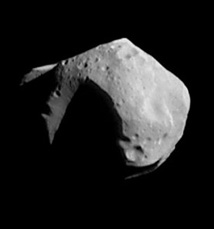
|
La sonde NEAR-shoemaker |
L'astéroïde 253 Mathilde
Photo NASA / JPL |
Continuant sa route, la sonde NEAR-Shoemaker parvint ensuite à
se mettre en orbite en 1999 autour de l'astéroïde Eros
sur lequel elle a réussi l'exploit de se poser le 12 février
2001.
|
|
|
L'astéroïde 433 Eros
Photo NASA / JPL |
Coucher de Soleil sur 433 Eros
Photo NASA / JPL |
6. LES CAPTURES D'ASTEROIDES
En comparant les formes biscornues des astéroïdes et
celles de certains satellites, les astronomes se sont rendus compte
que plusieurs des satellites des planètes du système
solaire ne s'étaient pas formés en même temps
que leur planète mais étaient en fait des astéroïdes
qui avaient été capturés ultérieurement.
Sur la photo ci-dessous, serez-vous capable de distinguer l'astéroïde
Gaspra de Phobos et Deïmos, les 2 satellites de la planète
Mars ?
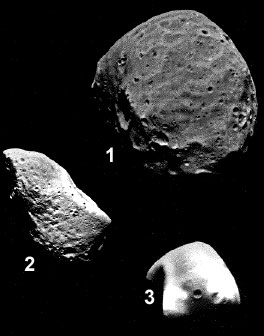
Pour connaître la solution, cliquez sur la photo ci-dessus
Certains satellites ont des orbites anormales, très excentriques,
tournant parfois à l'envers du sens normal des autres satellites
du système solaire. A l'évidence, ces satellites ne sont pas des
satellites issus de la nébuleuse protosolaire qui a donné naissance
aux planètes. Il est probable que ces satellites sont en fait des
astéroïdes qui ont été capturés par les planètes postérieurement
à la naissance du système solaire. C'est du moins ce que laissent
entrevoir les travaux de Brett Gladman et Jean-Marc Petit à l'Observatoire
de la Côte d'Azur : pour achever de vous convaincre de la très
grande fréquence de ces phénomènes de capture
dans l'histoire du système solaire, vous pouvez examiner
les orbites de plusieurs des petits satellites de la planète
Uranus.
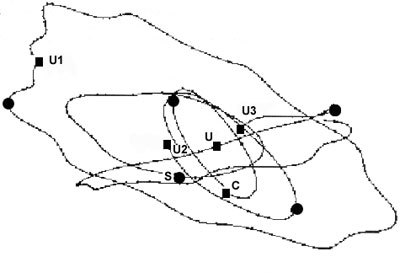
Parfois, la capture se passe mal et, au lieu de se mettre en orbite
autour de leur planète, les astéroïdes capturés
viennent se fracasser sur celle-ci. C'est ce qui s'est passé
en 1994 avec la comète Shoemaker-Lévy qui est venue
plonger dans l'atmosphère de Jupiter, y laissant de monstrueux
nuages noirs visibles pendant plusieurs semaines.
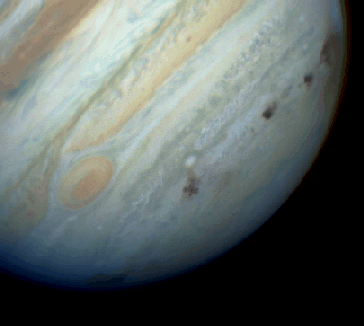
7. CONCLUSION :
Les astéroïdes nous permettront peut-être de connaître
les origines du système solaire. En effet, situés dans une région
glacée de l'espace, en-dehors de toute influence physico-chimique,
ces petits corps ont préservé intacts leurs constituants originels
et leur aspect extérieur est resté figé. En les analysant, les planétologues
peuvent mieux comprendre les mécanismes (collision-fusion) qui conduisirent
à former le système solaire à partir de la nébuleuse d'où
sont nés le Soleil et les planètes.

Les petits corps du système solaire contiennent des informations
essentielles sur la naissance de nos planètes car ils ont été peu
modifiés : pas de pression écrasante comme sur les planètes géantes.
Pas de température interne élevée entraînant la fusion des roches
comme pour les planètes telluriques. Les astéroïdes sont des fossiles
vivants, composés de la matière solide de la nébuleuse protosolaire,
alors que les comètes sont plutôt des fossiles vivants issus de
la matière gazeuse de cette même nébuleuse.
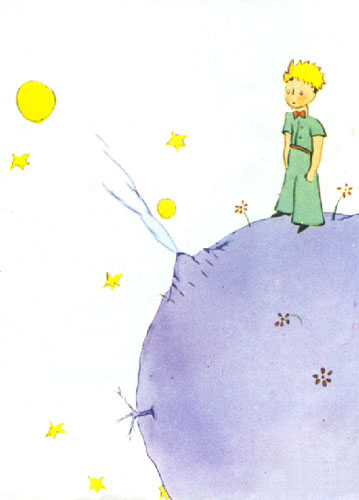
Notre astéroïde préféré : celui
où habite le Petit Prince de Saint Exupery
|
Numéro
|
Nom
|
Diamètre (km)
|
Date de découverte
|
Découvreur
|
|
50000
|
Quaoar
|
1280
|
5 juin 2002
|
Trujillo, C. & Brown, M.
|
|
1
|
Cérès
|
1003
|
1er janvier 1801
|
Piazzi, G.
|
|
2
|
Pallas
|
608
|
28 mars 1802
|
Olbers, H. W.
|
|
4
|
Vesta
|
538
|
29 mars 1807
|
Olbers, H. W.
|
|
10
|
Hygeia
|
450
|
12 avril 1849
|
de Gasparis, A.
|
|
31
|
Euphrosyne
|
370
|
1er septembre 1854
|
Ferguson, J.
|
|
704
|
Interamnia
|
350
|
2 octobre 1910
|
Cerulli, V.
|
|
511
|
Davida
|
323
|
30 mai 1903
|
Dugan, R. S.
|
|
65
|
Cybele
|
309
|
8 mars 1861
|
Tempel, E. W.
|
|
52
|
Europa
|
289
|
4 février 1858
|
Goldschmidt, H.
|
|
451
|
Patienta
|
276
|
4 décembre 1899
|
Charlois, A.
|
|
15
|
Eunomia
|
272
|
29 juillet 1851
|
de Gasparis, A.
|
|
16
|
Psyche
|
250
|
17 mars 1851
|
de Gasparis, A.
|
|
48
|
Doris
|
250
|
19 septembre 1857
|
Goldschmidt, H.
|
|
92
|
Undina
|
250
|
7 juillet 1867
|
Peters, C. H. F.
|
|
324
|
Bamberga
|
246
|
25 février 1892
|
Palisa, J.
|
|
24
|
Themis
|
234
|
5 avril 1853
|
de Gasparis, A.
|
|
95
|
Arethusa
|
230
|
23 novembre 1867
|
Luther, R.
|
Quelques astéroïdes
Pour en savoir plus, un excellent document papier est disponible
: le numéro "spécial astéroïdes et
autres petits corps du système solaire" de la revue
de la Société Astronomique de France.
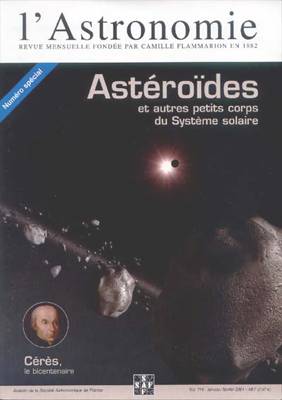
Un peu plus ancien, mais riche de précieuses données
sur les astéroïdes, "astronomie : le guide de l'observateur"
édité par la Société d'Astronomie Populaire
de Toulouse reste une référence : l'auteur du chapitre
consacré aux astéroïdes est Jean Lecacheux, astronome
professionnel, spécialiste des astéroïdes. Difficile
de trouver mieux...

|