| En 1672, Cassini depuis Paris et Richer associé à
Picard depuis la Guyane, réussirent à mesurer la distance
de la Terre au Soleil et donc les dimensions du Système solaire
en observant précisément la position de la planète Mars depuis deux
lieux très éloignés sur la Terre (Paris et Cayenne) : vue de ces
deux sites, la planète ne se projette pas au même point du ciel
(l’écart de parallaxe était de 24”), cela leur avait permis
de déterminer par trigonométrie la distance Terre-Soleil à 22 000
rayons terrestres (la bonne valeur est 23 500 environ).
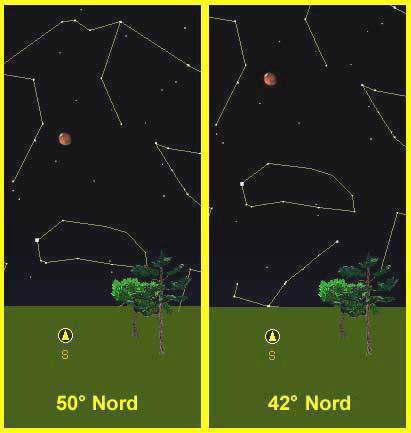
De son côté, Edmond Halley, alors jeune assistant
de l'astronome royal John Flamsteed (1646-1719), parvint en 1677
à observer pour la première fois en entier un passage
de Mercure devant le Soleil, lors d'un séjour sur l’île
de Sainte-Hélène. Avec sa lunette de 7 m de longueur focale, Edmund
Halley parvint à mesurer à 30 secondes près
la durée de ce transit. Il eut alors l'idée de mesurer
plus facilement la distance de la Terre au Soleil, toujours par
une méthode de parallaxe (c’est-à-dire l’angle sous lequel
on verrait le rayon terrestre depuis le Soleil), mais en se servant
des transits de Vénus devant le Soleil : bien que beaucoup
plus rares que les transits de Mercure, ceux de Vénus sont
cependant infiniment plus aisés à observer en raison
de la taille supérieure de Vénus.
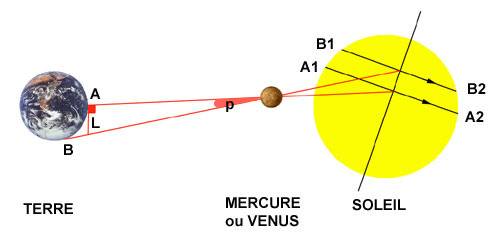
Lors de son passage devant le Soleil, la planète décrit
une ligne A1-A2 pour les observateurs situés au point A et
une ligne B1-B2 pour ceux situés en B. La comparaison des
2 durées de passages mesurées par les observateurs
A et B fournit l'angle de parallaxe p. La distance L entre les observateurs
A et B étant connue, il suffit de faire un petit coup de
trigonométrie pour avoir la distance Terre-Soleil.
En 1629, Kepler avait calculé que Vénus passerait probablement
devant le Soleil le 4 décembre 1639. Le jeune astronome anglais
Jeremiah Horrocks (1619- 1641) reprit les calculs de Képler
et eut la chance d’observer ce transit pendant une heure, juste
avant le coucher du Soleil (il observe près de Liverpool) en prenant
soin d’effectuer trois mesures des positions de la tache noire
de Vénus. Il parvient ainsi à corriger la valeur du demi-grand
axe de l'orbite de Vénus, donnée par Kepler, de 0,72414 à 0,72333
ce qui est la valeur admise aujourd’hui ! Il en déduira
la parallaxe du Soleil qu’il évalue à moins de 14”, alors
que Tycho Brahe l’estimait à près de 3’. Cela prouvait
que le Système solaire est dix fois plus vaste qu’on ne le
pensait alors.
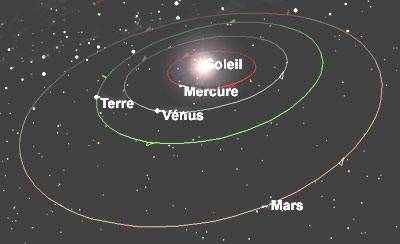
Pendant des années, les astronomes s'acharnèrent
à confirmer ces estimations. La méthode de la parallaxe sera
appliquée pour Vénus, au cours des grandes campagnes scientifiques
internationales lors de ses passages devant le Soleil en 1761 et
1769. C'est ainsi que l'astronome français Le Gentil traversa
les océans pour aller observer le transit de 1761 depuis
l'Inde. Malheureusement son voyage dura plus longtemps que prévu
et il arriva trop tard. Il décida donc de rester en Inde
jusqu'au transit suivant ... 8 ans plus tard ! D'une façon
générale, les résultats de ces périlleuses
expéditions seront assez décevants car la parallaxe solaire
ne sera obtenue qu’à 2 % près (comprise entre 8,5” et
8,9”); les passages de Vénus de 1874 et 1882 réduiront un peu
l’intervalle (entre 8,76” et 8,88”), la valeur admise
aujourd’hui étant 8,794148”.
Vous pouvez, vous aussi tenter de reproduire cette expérience,
avec un avantage sur nos glorieux et acharnés ancêtres
: lors des transits précédents de Vénus et
Mercure, la photographie n'existait pas, ou était seulement
débutante en 1882. Et grâce à Internet, vous
n'êtes pas obligés d'aller risquer votre peau sur les
océans à affronter tempêtes, pirates et cannibales
... Il vous suffit d'avoir un correspondant à l'autre bout
de la France et de comparer vos mesures respectives. A l'époque,
les protocoles de mesure utilisés étaient basés
essentiellement sur la méthode de Halley qui consistait à
chronométrer les instants de contacts entre la planète
et le Soleil, afin d'en déduire par calcul la parallaxe de
la planète.
Pour Mercure, le chronométrage est très précis
car Mercure n'a pas d'atmosphère, mais la parallaxe est très
petite. Pour Vénus, la parallaxe est généreuse
mais le chronométrage est imprécis : les instants
de contacts exacts sont difficiles à préciser du fait
de l'atmosphère de Vénus. Les observateurs du passé
ont noté des phénomènes de"goutte noire", de
"filaments", de "cornes".

Par la photographie, il est possible d'obtenir directement la parallaxe
de Mercure ou de Vénus en superposant des images du Soleil
prises au même moment en des lieux différents sur Terre.
Les logiciels d'imagerie numérique permettent cette manipulation
sans aucune difficulté. On peut tout autant mettre à
la même échelle des images prises avec des instrumentations
différentes. Il existe cependant une difficulté à
surmonter : que les images des différents observateurs soient
toutes orientées de façon identique. En effet, avec un disque
solaire uniforme, il n'est pas possible de recaler le petit point
noir de Mercure ou de Vénus d'une photo par rapport à
une autre. La présence éventuelle de plusieurs taches
solaires constitue une aide précieuse pour le recalage des
images. Coup de chance, il y en avait une grosse juste au milieu
du Soleil, le 07 Mai 2003 ? Mais lors du transit de Vénus
le 08 Juin 2004 ? Ce n'est pas certain, et on ne pourra le savoir
que par l'observation du Soleil 2 ou 3 jours avant le passage ou
bien en se connectant sur Internet afin de
récupérer les images du satellite SOHO.
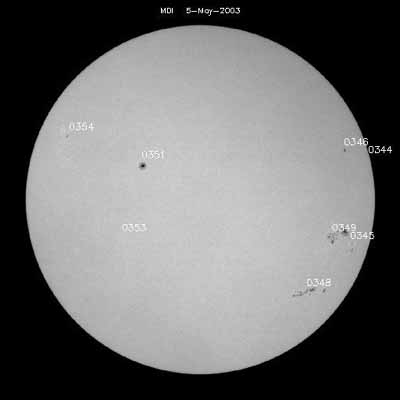
Pour pallier l'absence de taches solaires, il faut recourir à
une méthode : orienter sa webcam ou son appareil photo exactement
dans le sens du parcours apparent du Soleil dans le ciel. Pour cela,
plaquez un fil horizontalement et de façon précise sur l'écran
de l'ordinateur portable. L'utilisation des lignes de l'écran
permet cette précision. Ou bien avoir un viseur gradué
sur son appareil photo : une simple croix sur le verre dépoli
suffit. La mise en station de la monture de la lunette ou du télescope
devra avoir été effectuée de nuit, de façon
impeccable. Le 7 mai 2003, celà tombait bien car le transit
de Mercure débutait en France métropolitaine peu après
l'aube.
Dans ces conditions, avec le moteur de suivi coupé (si vous
en avez un), le Soleil, ou une étoile bien située,
ou une planète comme Mars, doivent glisser longitudinalement
sur l'écran de l'ordinateur ou le long du trait dans le viseur
de l'appareil photo. La caméra ou l'appareil photo ne doivent plus
changer de position durant toute l'observation. De cette façon,
tous les observateurs auront des images orientées de facon
identique. L'orientation étant effectuée, on peut
rebrancher le moteur de suivi du télescope
Pour le passage de Mercure du 07 Mai 2003, la Société
Astronomique de France proposait le protocole suivant :
1. mettez le télescope ou la lunette astronomique en station
en fin de nuit
2. orientez la caméra ou l'appareil photo en fin de nuit
à l'aide d'une étoile ou de la planète Mars.
3. synchronisez votre montre ou votre chronomètre sur l'heure
exacte de Paris, en téléphonant la veille à
l'Horloge Parlante au 36-99. Transformez cette heure en Temps Universel
en retranchant 2 heures.
4. choisissez une focale de telle sorte que le Soleil occupe au
mieux le champ photographique. En photographie argentique, utilisez
éventuellement une lentille de Barlow pour obtenir une focale
de environ 1500 mm maximum. Multipliez les temps de pose de part
et d'autre du temps théorique, en prenant en compte le fait
qu'un Soleil bas sur l'horizon est bien moins lumineux qu'un Soleil
au zénith. Avec une webcam, utilisez de préférence
un objectif de 500 mm de focale maximum pour avoir le Soleil en
entier ou presque dans le champ de votre capteur.
5. lors du transit, prenez une photo tous les quarts d'heure en
Temps Universel. Exemple : 5h TU, 5h15 TU, 5h30 TU, etc...
6. testez la validité de vos images : si, en superposant
vos images, la trajectoire de Mercure est rectiligne, alors vous
pouvez mesurer la parallaxe de Mercure. Si, en superposant vos images
la trajectoire de Mercure est légèrement courbe, alors
vous pourrez mesurer la parallaxe de Mercure, mais uniquement à
partir de deux clichés où Mercure passe au plus près
du centre du Soleil. Si, en superposant vos images, la trajectoire
de Mercure est irrégulière ou très incurvée,
les images seront inexploitables, sauf si vous pouvez les recaler
grâce à des taches solaires bien apparentes.
7. la centralisation de toutes les images exploitables était
asurée par Gilles
Dodray, de la Société Astronomique de France dont
la revue "L'Astronomie" publiera prochainement des images,
avec les lieux de prises de vues ainsi que le mode de calcul de
la parallaxe de Mercure et de la distance Terre-Soleil. Chacun pourra
calculer sa distance Terre-Soleil à partir de ses propres
images et de celles qui seront publiées. L'analyse des résultats
permettra de proposer un protocole analogue pour le passage de Vénus
du 08 Juin 2004.
Pour plus de précisions
sur la technique de photographie du Soleil avec une webcam, consultez
l'article de Jean-Christophe Dalouzy
Pour plus de précisions
sur la technique de photographie du Soleil avec un appareil photo
classique, consultez notre dossier |