La petite planète Mercure a joué un rôle fondamental dans l'évolution
de l'astronomie. C'est grâce à l'observation assidue de Mercure
que les astronomes et les astrophysiciens, de Kepler à Einstein
en passant par Halley, ont pu faire triompher les théories de Copernic,
évaluer les dimensions de notre système solaire et apporter les
premières preuves de la Relativité.
OU EST LE CENTRE DU MONDE ?
Depuis les travaux de Ptolémée, dans l'Antiquité et durant tout
le Moyen-Âge, on croyait que la Terre était le centre du monde.

Il a fallu attendre Nicolas Copernic (1473-1543) pour qu'un astronome
ose affirmer que c'est le Soleil qui est au centre du système solaire.
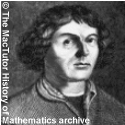
Les premières observations avec une lunette astronomique parGalilée
, en 1610, confortèrent la théorie de Copernic c'est notamment en
découvrant les satellites de Jupiter en train de tourner
autour de ce dernier que Galilée comprit que la Terre n'était
pas le centre du monde.
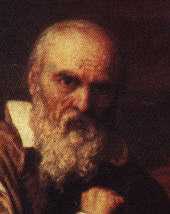
Johannes Kepler réussit alors, après des années
d'un travail acharné, à découvrir les lois
qui commandent les mouvements des planètes, ce qui lui permit
de mettre au point de nouvelles tables de calcul des positions des
planètes. Ces nouvelles tables, appelées Tables Rudolphines
en l'honneur de l'empereur germanique Rodolphe II, supplantèrent
rapidement toutes les tables antérieures grâce à
leur précision. Les tables Rudolphines resteront très
employées pendant tout le XVIIème siècle.
Johannes Kepler avait quitté ce monde le 15 novembre 1630 à l'âge
de 59 ans. Il s'en était fallu de peu qu'il ne puisse tenter lui-même
l'observation du transit de Mercure qu'il avait prédit pour le 7
novembre 1631.
Le 7 novembre 1631, l'astronome, Pierre Gassendi (1592 -1655) se
chargea d'observer le passage de Mercure devant le Soleil, par projection
sur écran depuis son appartement parisien.

Les conditions météo étaient médiocres ce 7 novembre, et c'est
au travers d'une éclaircie providentielle que Gassendi put pointer
sa lunette vers le disque solaire et observer une tache noirâtre.
Quand le Soleil réapparaît entre deux nuages, la "tache" noire n'est
plus au même endroit : c'est donc bien Mercure qui s'est déplacé
! « Je l'ai trouvé et je l'ai vu, ce qui n'était arrivé à personne
avant moi » écrit-il tout heureux à son ami, l'astronome Wilhelm
Schickard (1592-1635)
Cette observation permet d'améliorer encore plus la précision
des Tables Rudolphines et, d'établir de façon définitive
la supériorité du modèle de système
solaire calculé par Kepler sur celui de Copernic et, surtout,
de donner le coup de grâce au vieux système géocentrique
de Ptolémée : le Soleil est au centre du système
solaire, et toutes les planètes sont en orbite autour de
lui conformément aux calculs de Kepler.
DE MERCURE AU G.P.S. EN PASSANT PAR EINSTEIN
Isaac Newton avait établi en 1687 la loi de la gravitation entre
les astres, apportant ainsi une explication satisfaisante aux mouvements
planétaires observés et calculés par Kepler. Or les planètes,
en attraction mutuelle, modifient légèrement l'influence prépondérante
du Soleil, ce qui perturbe leurs orbites : ces dernières
pivotent lentement dans l'espace au fil des siècles. On appelle
cette dérive des orbites la précession des périhélies (périhélie
= le point de l'orbite le plus proche du Soleil).
Après sa brillante découverte de la planète Neptune, basée sur
le calcul des perturbations de l'orbite d'Uranus, l'astronome Urbain
Le Verrier (1811-1877) décide en 1855 de construire une nouvelle
théorie de l'ensemble des huit planètes connues alors.

Pour Mercure , Le Verrier étudie tous les transits devant le Soleil
observés de façon fiable (soit 16 sur 30). En comparant ces observations,
il constate quelques désaccords inexplicables : la précession
du périhélie de Mercure présente un excès de 43" par siècle
que ni la masse de Vénus, ni celle de la Terre ni celle de Jupiter
ne peuvent expliquer.
Pour Le Verrier, la cause la plus probable du désaccord entre théorie
et observations est « l'existence d'une planète ou un groupe de
petites planètes circulant dans les parages de l'orbite de Mercure»;
or aucun astronome n'a jamais réussi à découvrir cet astre mystérieux,
baptisé par anticipation Vulcain.
Jusqu'à la fin du XIXème siècle, la physique
et l'astronomie resteront impuissantes devant ces fichues 43 secondes
d'arc. C'est Albert Einstein (1879-1955) qui va enfin apporter la
solution de l'énigme grâce à sa théorie
de la relativité. Pour Einstein, contrairement à ce
que pensait Newton, l'espace et le temps ne sont pas indépendants.
En particulier, la présence d'une masse dans l'espace modifie
ce dernier en le courbant, un peu comme le ferait une boule posée
sur un coussin.
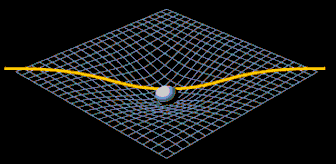
Pour Einstein, la force de gravitation n'est plus nécessaire
pour expliquer les mouvements des planètes : la gravitation
est la courbure de l'espace-temps et les planètes se déplacent
librement dans l'espace du système solaire courbé
par la présence du Soleil.
Dans ce cadre, Einstein montre en 1913 que l'orbite d'une planète
subit toujours une précession en raison de cette courbure de l'espace-temps
: pour Mercure la précession calculée par les équations de la théorie
de la relativité correspond très exactement à 43" par siècle ! Ce
fut la première vérification expérimentale de la relativité générale,
dès sa naissance, en 1915.
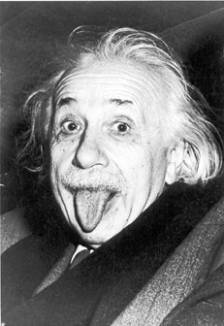
De nos jours, un satellite de la Terre, en orbite à seulement 640
km d'altitude (soit 1/10 du rayon terrestre) effectue plus de 5
000 orbites par an : la précession relativiste (13" par an) devient
alors facilement observable. Il est indispensable de tenir compte
de cet effet pour que les satellites GPS et les satellites de télécommunications
fonctionnent correctement et vous donnent votre position précise
à la surface de la Terre.
LA CHAINE D'ARPENTEUR DU SYSTEME SOLAIRE
Edmond Halley, alors jeune assistant de l'astronome royal John
Flamsteed (1646-1719), parvint en 1677 à observer pour la première
fois en entier un transit de Mercure devant le Soleil, lors d'un
séjour sur l'île de Sainte-Hélène par (1656-1743). Il eut alors
l'idée de mesurer la distance de la Terre au Soleil, par une méthode
de parallaxe, mais en se servant des transits de Vénus devant le
Soleil : bien que beaucoup plus rares que les transits de Mercure,
ceux de Vénus sont cependant infiniment plus aisés à observer en
raison de la taille supérieure de Vénus. La parallaxe est l'angle
sous lequel on verrait la Terre depuis le Soleil. La connaissance
de cet angle permet de mesurer la distance de la Terre au Soleil
et donc les dimensions du Système solaire.
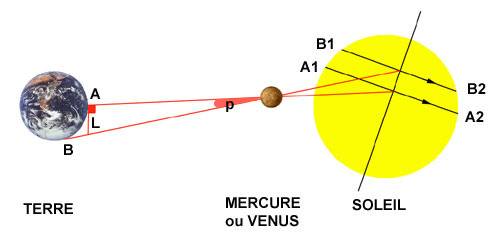 |
Lors de son passage devant le Soleil, la planète décrit une ligne
A1-A2 pour les observateurs situés au point A et une ligne B1-B2
pour ceux situés en B. La comparaison des 2 durées de passages mesurées
par les observateurs A et B fournit l'angle de parallaxe p. La distance
L entre les observateurs A et B étant connue, il suffit de faire
un petit coup de trigonométrie pour avoir la distance Terre-Soleil.
En 1672,Jean-Dominique Cassini (1625-1712) depuis Paris, associé
à Richer et à l'abbé Jean Picard (1620-1682)
depuis la Guyane, avaient eu une idée analogue en observant précisément
la position de la planète Mars depuis deux lieux très éloignés sur
la Terre (Paris et Cayenne) : vue de ces deux sites, la planète
ne se projette pas au même point du ciel (l'écart de parallaxe était
de 24"), cela leur avait permis de déterminer par trigonométrie
la distance Terre-Soleil à 22 000 rayons terrestres (la bonne valeur
est 23 500 environ).
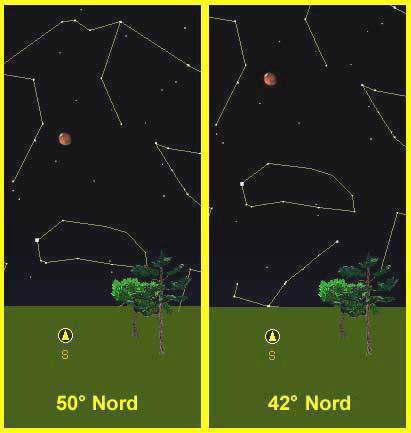
Pendant des années, les astronomes s'acharnèrent
à confirmer ces estimations. La méthode de la parallaxe sera
appliquée pour Vénus, au cours des grandes campagnes scientifiques
internationales lors de ses passages devant le Soleil en 1761 et
1769. D'une façon générale, les résultats de
ces périlleuses expéditions seront assez décevants
car la parallaxe solaire ne sera obtenue qu’à 2 % près (comprise
entre 8,5” et 8,9”); les passages de Vénus de 1874 et
1882 réduiront un peu l’intervalle (entre 8,76” et 8,88”),
la valeur admise aujourd’hui étant 8,794148”.
LA TRISTE AVENTURE DU SIEUR GUILLAUME LE
GENTIL DE LA GALAISIERE
Profitons de l'occasion pour rappeler la triste aventure de l'astronome
français Guillaume Hyacinthe Jean-Baptiste Le Gentil de la
Galaisière (1725-1792), désigné par l'Académie française
des Sciences pour aller observer le passage de 1761 de Vénus devant
le Soleil, depuis la station de Pondichéry en Inde, sur la côte
du Golfe du Bengale. Le Gentil ne put jamais aborder à Pondichéry,
occupée par les Anglais (Guerre de Sept Ans) et le passage de Vénus
devant le Soleil eut lieu pendant qu'il était en mer. Le Gentil
décida de se réfugier à l'Ile Maurice pour attendre
le passage suivant de Vénus, en 1769, soit 8 ans plus tard
... Mais hélas, lorsqu'il revint à Pondichéry, rendue
entretemps à la France par le Traité de Paris de 1763, il manqua
à nouveau l'observation de ce second transit de Vénus par
l'effet d'un malencontreux nuage isolé !!! Ses déboires n'étaient
pas terminés car, lorsqu'il rentra en France en 1771, retardé
par plusieurs tempêtes et attaques de pirates, on ne l'attendait
plus et ses héritiers s'étaient déjà partagés tous ses biens ...
et, tout le monde le croyant mort, son poste à l'Académie
Française avait été réattribué
à un nouvel académicien ...
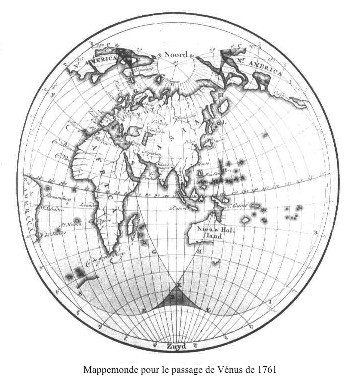 |
|