| L'explication de ce phénomène est toute simple
: Mercure, en tournant sur son orbite autour du Soleil, vient parfois
s'interposer entre ce dernier et notre Terre. Il se produit donc
le même phénomène que lors d'une éclipse
du Soleil par la Lune.
Bien sûr, la planète Mercure est infiniment plus lointaine
que la Lune (83 millions de kilomètres) et bien trop petite
à cette distance pour parvenir à masquer le disque
solaire : Mercure n'avait le 7 mai 2003 qu'un diamètre apparent
de 12 secondes d'arc alors que le Soleil semblait 160 fois plus
grand.
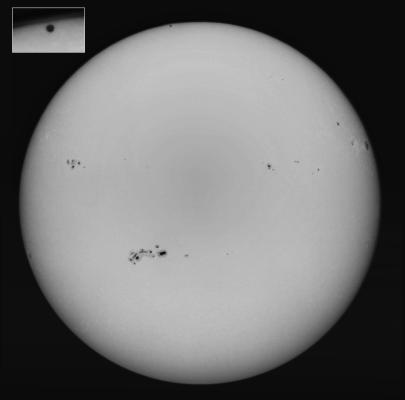
Photo satellite NOAO
Les transits de Mercure sont rares : 13 ou 14 fois par siècle,
en moyenne. Le dernier transit visible depuis la France remonte
à 1973. Après celui de ce 7 mai 2003, il faudra attendre
2016.
Mercure tourne autour du Soleil en 88 jours : pourquoi ne passe-t'il
donc pas devant le Soleil tous les 88 jours ? La cause en est l'orbite
particulièrement biscornue de Mercure. Regardez attentivement
le schéma ci-dessous : à gauche, le Soleil, Mercure
et la Terre sont alignés, créant ainsi les conditions
d'un transit de Mercure devant le Soleil. A droite, au bout de 88
jours, Mercure a fait un tour complet et est revenu à son
point de départ par rapport aux étoiles : les astronomes
appellent ce mouvement la révolution sidérale de Mercure.
Mais, durant ces 88 jours, la Terre a parcouru également
du chemin sur son orbite : cette fois, le Soleil, Mercure et la
Terre ne sont plus alignés.
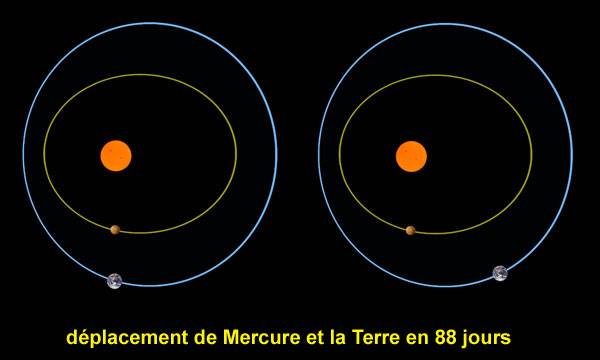
Schéma ASCT-astronomie
Il faut attendre 28 jours supplémentaires pour que Mercure
rattrape la Terre et que l'alignement Soleil - Mercure - Terre soit
à nouveau réalisé : ce dernier ne peut donc
se produire qu'une fois tous les 88 + 28 = 116 jours. Ce deuxième
mouvement est appelé la révolution synodique : c'est
le mouvement que doivent accomplir les planètes Terre et
Mercure pour se retrouver à nouveau parfaitement alignées.

Schéma ASCT-astronomie
Mais on n'observe pas pour autant un passage de Mercure devant
le Soleil tous les 116 jours, à la fin de chaque révolution
synodique. La plupart du temps, Mercure passe dans le ciel juste
au-dessus ou bien juste au-dessous du disque solaire. L'orbite de
Mercure est inclinée de 7 degrés par rapport à
celle de la Terre. Pour qu'il y ait un transit, il faut que Mercure,
la Terre et le Soleil soient alignés sur une ligne qui passe
par les intersections des plans des orbites de la Terre et de Mercure,
ainsi que vous le montre le schéma ci-dessous. Les astronomes
appellent cette ligne : la ligne des noeuds.
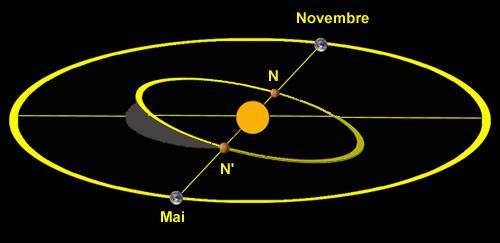
Schéma ASCT-astronomie
Les transits ne peuvent donc survenir que lorsque Mercure se trouve
exactement sur l'un des deux noeuds. Cet alignement magique ne se
produit qu'assez rarement en raison d'une autre complication : l'orbite
de Mercure dessine autour du Soleil une ellipse beaucoup plus aplatie
que celle de la Terre, qui est quasiment circulaire. De ce fait
Mercure n'a pas toujours la même vitesse sur son orbite :
elle avance beaucoup plus rapidement lorsqu'elle est proche du Soleil
alors qu'elle ralentit lorsqu'elle s'en éloigne. Et bien
souvent, Mercure arrive aux noeuds avec un peu d'avance ou au contraire
un peu de retard : pas de transits ces jours-là ...
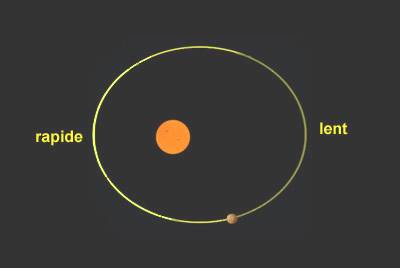
Schéma ASCT-astronomie
Cette différence de vitesse de Mercure sur son orbite a
donc une conséquence sur la fréquence de ses passages
aux noeuds. Les transits observables lorsque Mercure se trouve exactement
au noeud ascendant, ont toujours lieu entre le 5 et le 11 mai, selon
une périodicité de 13 puis 33 ans. Les transits lorsque
Mercure passe au noeud descendant ont toujours lieu entre le 5 et
le 15 novembre, mais selon une périodicité plus complexe,
de 7, 13 ou 33 ans : en effet, ces transits se produisent lorsque
Mercure est au plus proche du Soleil et donc plus rapide, ce qui
augmente la fréquence des passages à ce noeud.
Vous l'avez compris : le calcul des transits de Mercure a longtemps
été un véritable casse-tête pour les
astronomes ! Pendant longtemps, les transits de Mercure et de Vénus
devant le Soleil ont servi de pierre de touche pour valider la précision
des tables de calcul des paramètres orbitaux des astres du
système solaire. C'est en particulièrement grâce
aux transits de Mercure que les Tables Rudolphines mises au point
par Kepler ont supplanté les premières tables de Copernic
et ont permis de remiser définitivement au grenier des antiquités
le modèle géocentrique de Ptolémée qui
avait dominé tout le Moyen-Âge.
Pour la France, le dernier transit observé remontait à
1973 : il a donc fallu attendre 30 ans, et le 7 mai 2003 pour en
voir un. Quant au prochain transit visible depuis la France, il
n'aura lieu ensuite que le 9 mai 2016.
Lorsque le Soleil, Mercure et la Terre sont parfaitement alignés,
comme en 1 sur le schéma ci-dessous, les observateurs voient
un transit central : Mercure passe pile poil au milieu du disque
solaire. En 2, il faut se contenter d'un transit périphérique
comme ce sera le cas le 7 mai 2003. Enfin, dans la configuration
n°3, on ne peut observer qu'un transit partiel : le disque de
Mercure ne fait que mordre en partie sur le Soleil.
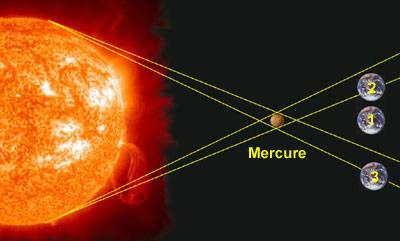
Schéma ASCT-astronomie
Le diamètre apparent de la petite
planète Mercure n'étant que d'une douzaine de secondes
d'arc, soit un 1/158 du diamètre apparent du Soleil, l'observation
du transit nécessite une lunette astronomique ou bien un
télescope grossissant de 50 à 150 fois.
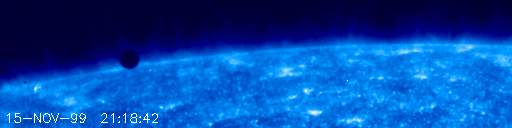
Animation satellite SOHO
Et bien évidemment, pour éviter de se griller la
rétine, l'objectif de votre appareil doit être impérativement
équipé d'un filtre solaire spécial.

Photo "Maison de l'Astronomie"
Plusieurs types de filtres existent, qu'il s'agisse de feuilles
mylar (cf-dessus) qui restent cependant assez fragiles, ou bien
qu'il s'agisse de filtres en verre aluminé, plus coûteux.
Le premier contact, c'est le moment où le disque de Mercure
aborde le disque du Soleil : cet instant avait lieu le 7 mai 2003,
pour la Seine-Maritime, à 5 h 11 mn 29.6 s TU. Le deuxième
contact, c'est à dire le moment où tout le disque
de Mercure est placé devant le Soleil, commençait
à 5 h 15 mn 55.1 s TU. Le troisième contact (= le
moment où Mercure commence à ressortir du disque solaire)
s'est produit à 10 h 28 mn 22.8 s et la fin du transit (=quatrième
contact) a eu lieu à 10 h 32 mn 47.1 s TU. En fait, seuls
les 2° et 3° contacts sont facilement observables au télescope.

Schéma ASCT-astronomie
Vous pouvez retrouver les horaires précis d'un transit pour
chacun des autres départements de France sur le site Internet
de l'Institut
de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides
(IMCCE)
Enfin, exactement comme pour une éclipse de Soleil, le transit
de Mercure n'est visible que depuis une petite partie du globe terrestre.
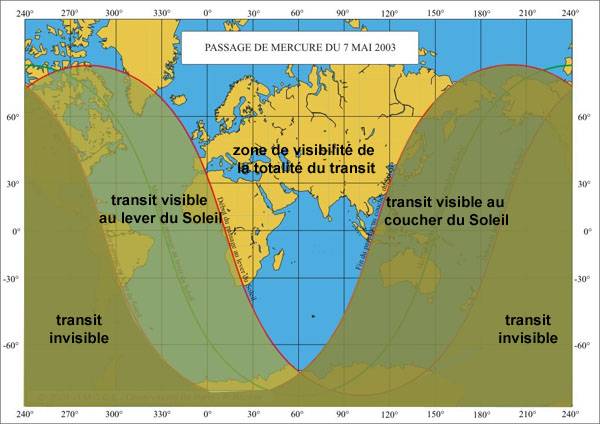
Schéma ASCT-astronomie
Le moment du deuxième contact est celui où le disque
de Mercure est totalement à l'intérieur du Soleil.
Cet instant peut être précédé durant
quelques secondes d'un curieux phénomène, appelé
le phénomène de la "goutte noire", dû
à la diffusion de la lumière du télescope dans
votre télescope. Le même phénomène peut
se reproduire durant les quelques secondes qui suivent le 3ème
contact.

C'est grâce aux transits de Mercure et de Vénus devant
le Soleil que la distance exacte de la Terre au Soleil a pu être
calculée et que, en partant de ce calcul, les dimensions
du système solaire ont pu être évaluées.
Mais de longues et difficiles observations ont été
nécessaires avant de parvenir à ce résultat.
Retrouvez l'histoire
de ces expéditions lointaines en des contrées
dangereuses sur le site Internet de l'IMCCE.

Image IMCCE |