| L'irruption de la webcam a révolutionné les techniques
de l'astrophotographie : peu coûteuses, faciles d'emploi,
faible sensibilité aux turbulences de l'atmosphère
terrestres, les webcams permettent d'obtenir très rapidement
des résultats très sympas. Une seul inconvénient
: il faut accepter de prendre le temps retraiter les images afin
de les déparasiter car les capteurs CCD dont sont constitués
les webcams restent peu adaptés à la prise de vue
astronomique.
Le Soleil n'échappe pas à ces quelques règles
de bon sens. Les lignes suivantes, extraites de l'article que Jean
Christophe Dalouzy, membre de l'observatoire de Rouen, a publié
dans le numéro de Mars / Avril 2003 de "l'astronomie",
la revue de la Société Astronomique de France, font
le point sur la question :
Quand on parle d'images solaires, souvent on entend ces phrases
" Oh, il est très difficile d'obtenir de bonnes images ! ", " La
turbulence est très importante ", " Cela peut être dangereux ! ",
" Il faut du matérie! très cher ". Même si d'excellents résultats
peuvent être obtenus avec une pellicule photo noir et blanc, son
emploi ainsi que l'obtention de bons résultats restent très longs
et difficiles. Par contre la webcam vient à la rescousse pour mettre
à la portée de tout amateur la possibilité de réaliser assez rapidement
de bonnes images.
Le matériel
En ce qui me concerne, j'utilise une webcam Philips Vesta Pro.
Comme pour l'observation visuelle de la surface du Soleil, il faut
impérativement disposer d'une protection adéquate à mettre au niveau
de l'objectif de l'instrument et surtout pas au niveau du foyer
car il y a un risque d'échauffement qui peut provoquer l'éclatement
du filtre, on ne le répétera jamais assez ! Les feuilles de mylar,
de polymère, astrosolar,... peuvent également être utilisées, mais
avec précaution, car il faut manipuler ces feuilles avec ménagement
pour éviter toutes petites rayures ou petits trous.

Pour ma part, je préfère de très loin les filtres en verre aluminisé,
bien plus faciles d'emploi et sans le moindre risque. Le seul inconvénient
réside dans leur prix (mais je pense que mon oeil vaut plus cher
que les 70 ou 150 Euros du filtre !). Les filtres dits visuels,
de transmission 1/100 000e, conviennent très bien et peuvent en
outre permettre l'observation visuelle. Il ne faut pas oublier de
protéger également le chercheur.

Venons-en maintenant au dernier matériel, et pas des moindres :
le télescope ! Pour l'imagerie solaire, rien ne sert d'avoir
un grand diamètre pour obtenir de bonnes images, je dirai même au
contraire ! Il ne faut pas dépasser 130 mm de diamètre. Pourquoi
? Tout simplement parce que la turbulence de jour est toujours importante.
Plus le diamètre est grand et plus l'instrument sera sensible à
cette dernière, d'où l'intérêt d'utiliser un plus petit diamètre.
Bien évidemment certaines images exceptionnelles ont été réalisées
avec des télescopes de 400 mm, mais dans ce cas, il faut
vraiment une turbulence très faible, ce qui arrive très très rarement
! Les petits instruments permettent donc de faire plus souvent de
bonnes images, ce qui facilite grandement le suivi des taches solaires.
Quant à l'instrument lui même, de petits Maksutov (style ETX) ou
mieux, de bonnes lunettes apochromatiques permettent d'obtenir d'excellents
résultats. On peut également utiliser un télescope de 200
mm de diamètre, par exemple, que l'on peut diaphragmer ...
L'acquisition des images
Voyons maintenant l'acquisition des images solaires. Je vais vous
donner ma façon de procéder, bien évidemment elle n'est pas exhaustive
! Avant de voir l'acquisition proprement dite, voyons tout d'abord
les conditions de prise de vue. Le principal ennemi de l'imagerie
solaire est la turbulence atmosphérique terrestre. Pour la
limiter, il faut essayer de faire les prises de vue entre 9 h 00
et et 9 h 30 HL (heure locale), pour que le Soleil soit assez haut,
mais qu'il n'ait pas encore eu le temps de trop réchauffer l'atmosphère.
Il faut également éviter un ciel avec de trop fréquents passages
nuageux (c'est évident !).
L'instrument doit être assez bien mis en station, mais ne doit
pas être forcément motorisé. Toutes les images qui illustrent cet
article ont été faites sans motorisation et sans suivi, simplement
en laissant défiler le Soleil devant le capteur. L'imagerie des
taches se fait en général au foyer de l'instrument, mais si l'on
veut obtenir quelques gros plans d'une tache, on peut tenter de
mettre une lentille de Barlow afin de multiplier par x 2 le grossissement.
Gros problème : les reflets du Soleil sur l'écran de l'ordinateur
posent souvent problème, surtout si le Soleil "donne" en plein dessus
! Un carton dans lequel on ne met que la tête ou un grand drap noir
enveloppant l'ordinateur peuvent être utilisés, mais dans ce cas
attention à la chaleur !
Avant de faire votre acquisition, je vous conseille de chercher
sur Internet l'image du
satellite SOHO, pour voir la disposition et l'emplacement des
taches visibles.
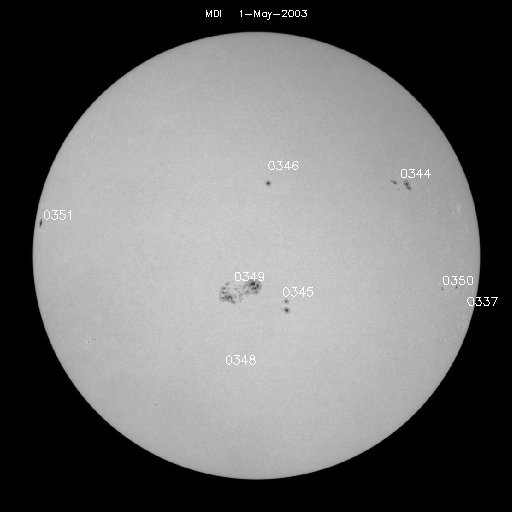
Les réglages lors de l'acquisition
Tout d'abord, vous réglez votre petite caméra en mode noir et blanc,
les couleurs sur le Soleil étant celles du filtre, il n'y a aucun
intérêt à faire des films .avi couleurs, qui prennent beaucoup
plus de place sur le disque dur ! Ensuite réglez le gain au minimum
pour éviter de voir apparaître le grain de l'image.
Puis vous laissez le temps de pose au maximum, le Soleil est alors
nettement surexposé, mais cela permettra ainsi de faire la mise
au point. Vous pointez le bord du Soleil que vous essayez de rendre
le plus net possible. Une fois que la mise au point vous semble
à peu près bonne, vous diminuez le temps d'exposition et vous vous
rendrez compte alors que la netteté est à parfaire. Affinez-la le
mieux possible. C'est l'étape la plus importante !
Il ne vous reste alors plus qu'à centrer les taches que vous voulez
"webcamer". Vous diminuerez suffisamment le temps d'exposition pour
éviter de trop surexposer certaines zones.
Vous faites enfin vos acquisitions. Toutes les taches sont enregistrées
sur le disque dur de votre ordinateur sous forme de films au format
.avi. Arrivé à ce stade, vous n'avez pas totalement fini, car il
vous reste encore à faire une image du flat ou plu (plage de lumière
uniforme). Cette image va vous permettre de supprimer toutes les
impuretés, poussières,... de votre capteur.
Pour effectuer cette plu, il faut que vous réalisiez un avi d'une
zone où la lumière est uniforme avec les mêmes réglages que lors
de vos prises de vue de taches solaires. Pour cela, vous avez 2
solutions :
a) soit pointer une zone du ciel bleu sans nuage : pour cela
enlevez le filtre et diminuez le temps d'exposition pour obtenir
une luminosité à peu près égale à celle du Soleil que vous avez
sur vos images de taches solaires.
b) soit faire une image d'une zone centrale du Soleil sans tache
en gardant les mêmes réglages : je trouve cette dernière méthode
bien plus facile, rapide et efficace.
En conclusion, vous vous retrouvez avec sur le disque dur de votre
ordinateur n films au format .avi de taches solaires et 1 avi de
plu, qu'il va maintenant falloir retraiter...
Le traitement des images
Ce sont les logiciels Avi2bmp
et Iris (téléchargeables
gratuitement sur Internet) qui vont servir à effectuer cela. Tout
d'abord réalisons notre image plu : pour cela, ouvrez l'avi de votre
plu sous Avi2bmp et sélectionnez les 10 meilleures images puis enregistrez-les
au format fits. Puis sous Iris, réalisez une médiane de ces 10 images,
le script est le suivant :
>Ioad pIu1
>smedian2 plu 10
>save plu
Ensuite, il faut déterminer le coefficient multiplicateur (n) qu'il
faudra utiliser pour diviser les images des taches par la plu. Celui-ci
est obtenu grâce à la commande bg qui vous donnera le Background
n :
>bg
On a maintenant notre plu (image 1), il faut alors chercher les
images des taches.

image 1
Pour cela on ouvre les avi sous Avi2bmp et on recherche les meilleures
images du groupe de taches souhaité (image 2).
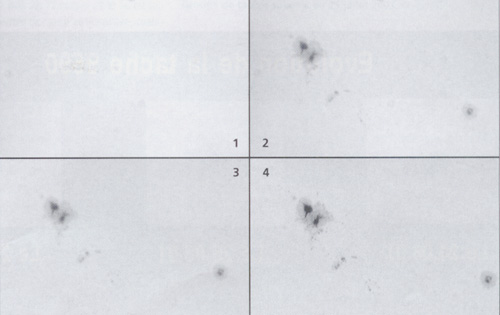
image 2
Là, on a le choix : soit, on prend la meilleure que l'on traitera
individuellement, soit on prend les meilleures images que l'on compositera
ensemble. Je préfère cette dernière solution, sauf si la turbulence
est vraiment très forte. Je prends habituellement 5 images individuelles.
La suite du traitement, illustrée dans cet article, s'appuie sur
cette dernière méthode, mais le traitement de l'image individuelle
est très semblable.
On enregistre donc les 5 meilleures images en format fit.
Puis sous Iris, on va diviser ces 5 images par la plu avec le coefficient
n du background. Ce sont ces 5 images (appelées s1, s2, s3, s4,
s5 par exemple) qui vont être compositées.
Pour cela, il faut d'abord les recadrer, avec la commande pregister,
dont le script suit. Après avoir fait un cadre sur le groupe de
taches souhaité :
>pregister s ss 512 5
>file_trans s ss 5
On composite ensuite les 5 images recadrées :
>add2 ss 5
Puis on réajuste les seuils de visualisation pour obtenir une image
"agréable". Vient ensuite le traitement : on peut effectuer un traitement
par ondelette, mais je préfère le traitement par vancittert; le
script est le suivant :
>vancittert x y où x est la puissance du vancittert et y
le nombre d'itérations.
Après plusieurs essais, je suis arrivé à la conclusion que le traitement
le plus approprié était le vancittert 3 2, mais c'est à vous d'essayer
de voir ce qui s'applique le mieux à vos images
On enregistre enfin l'image finale en bmp, en l'appelant par exemple
ici "final".
>savebmp final
La partie du traitement sur Iris est finie, il faut maintenant
reprendre cette image sous des logiciels de retouche d'images classiques,
style Paint Shop Pro, Photoshop... Les réglages à effectuer seront
la luminosité et le contraste, éventuellement le gamma et un petit
masque flou. Ne pas hésiter à jouer franco sur la luminosité et
le contraste, du style - 40 et + 37 ...
Et voilà, votre image finale est devant vous !
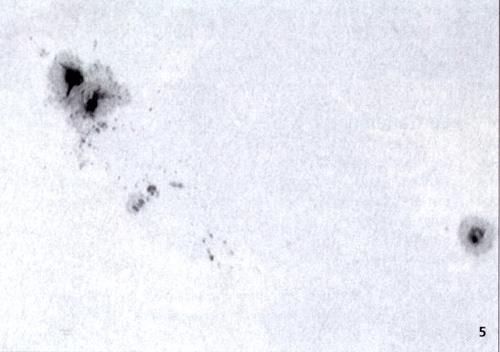
Peut-être que vos premiers résultats ne vous plairont pas, mais
vous verrez qu'en persévérant, vous obtiendrez rapidement de magnifiques
images de notre étoile !
Possibilité d'études du Soleil ?
Nous avons vu comment réaliser des images solaires avec une webcam,
mais ces images sont-elles utilisables pour d'éventuelles mesures
? J'avoue ne m'être jamais réellement posé la question, car mon
but premier était avant tout la réalisation de belles images de
notre étoile. Néanmoins, deux applications me viennent à l'esprit
:
- la première est un suivi des taches solaires au jour le jour,
c'est-à-dire qu'il est possible de pouvoir suivre l'évolution de
la morphologie d'une tache ou d'un groupe de taches sur plusieurs
jours. J'ai fait ceci sur le groupe 9591 et la tache 9590 en août
2001 (voir image ci-dessous).
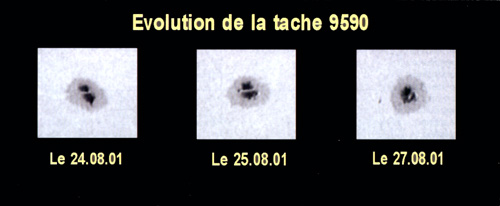
- la seconde est la mesure de la taille réelle des taches. Comme
nous avons une image numérique quadrillée en pixels, la précision
est nettement supérieure à une mesure sur une photo argentique ou
en visuel. Pour cela, il faut d'abord déterminer l'échantillonnage
de notre formule optique, c'est-à-dire le nombre de secondes d'arc
par pixel. Pour cela deux solutions : soit par le calcul, soit par
la mesure.
Pour le calcul, il existe une formule qui permet de déterminer
l'échantillonnage
échantillonnage = 206 x [ taille du pixel/ focale]
avec la taille du pixel en micron et la focale en mm.
Le problème de cette formule est qu'il est nécessaire de connaître
précisément la focale de notre montage optique, c'est pourquoi je
préfère très nettement la seconde méthode.
Pour la mesure, en fait, tout commence la nuit ! On pointe une
étoile double assez brillante avec la même configuration optique
qui va nous servir à réaliser les images du Soleil. Puis on mesure
en nombre de pixels la séparation entre les deux étoiles, connaissant
la séparation en secondes d'arc (donnée par un logiciel ou par un
atlas du ciel), on peut ainsi remonter à notre valeur en secondes
d'arc par pixel en faisant simplement le rapport. Sur notre image
solaire, on détermine ensuite la taille en pixels de la tache et
on connaît ainsi sa taille en secondes d'arc en multipliant cette
mesure par l'échantillonnage. Il ne nous reste plus qu'à chercher
la distance Terre- Soleil dans les éphémérides au moment de la prise
de vue et le tour est joué.
Une telle mesure pourra être effectuée pour mesurer le diamètre
de Mercure, par exemple, lors de son transit du 7 mai 2003. Il s'agit
là de quelques propositions "d'étude solaire" à l'aide d'une webcam,
avec la méthode d'imagerie proposée dans l'article, mais plusieurs
autres domaines peuvent également être envisagés, je pense notamment
à la spectroscopie ou bien à l'imagerie monochromatique (H alpha
par exemple).
Le transit de Mercure
Le 7 mai 2003, Mercure passera devant le Soleil; son globe sera
alors visible comme une "tache" sombre et parfaitement circulaire
qu'il sera intéressant de suivre tout au long du phénomène.
Le début du phénomène sera hélas assez bas sur l'horizon et le
Soleil se situera donc encore dans les zones turbulentes de notre
atmosphère, mais plus Mercure va traverser le disque solaire, plus
le Soleil sera haut dans le ciel et plus les conditions de prise
de vue seront favorables. Le transit devrait se terminer en France
vers midi et demi.
Bien évidemment ce phénomène sera parfaitement possible à prendre
avec une webcam (si le temps le permet !). La technique de prise
de vue est la même que celle décrite plus haut.
Il sera également intéressant de prendre plusieurs séries d'images
pour reconstituer sous forme de film la totalité du phénomène. La
taille de Mercure au moment du transit sera de 12 secondes d'arc
environ. Sur le cliché ci-dessus on a effectué une simulation de
la taille de Mercure (petit point noir à côté de la tache) telle
qu'elle apparaîtrait avec une webcam au foyer d'un ETX 90.
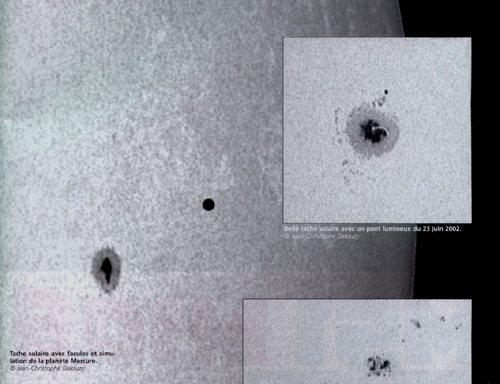
Conclusion
Je tiens à le répéter, la méthode que je vous ai donnée ici est
celle que j'utilise, mais ce n'en est qu'une, sans doute, parmi
d'autres ! À vous de déterminer la vôtre ! Une fois que l'on s'est
lancé dans l'imagerie solaire et que notre technique est bien rodée,
il est intéressant de réaliser des suivis quotidiens de certaines
taches ou groupes de taches. Voir leur évolution, leur changement
de structure, mais aussi leur similitude, est une étude ou exploration
passionnante qui est maintenant facilement réalisable par tout le
monde grâce à l'imagerie webcam. Mais comme évoqué dans l'avant-dernier
paragraphe, d'autres études peuvent être abordées et je reste bien
évidemment ouvert à toutes propositions pour pouvoir en discuter
: Jean Christophe Dalouzy.
|