| |
| |
Les outils de l'Astronome |
|
| |
|
La lunette astronomique : des yeux
de géants |
La lunette astronomique, précurseur du télescope
La lunette astronomique a été conçue en Hollande
vers 1608. On en attribue l'invention à l'opticien hollandais Hans
Lippershey. Mais c'est en 1609 que l'astronome italien Galilée présenta
la première lunette astronomique. Son confrère allemand Johannes
Kepler en perfectionna le principe, en proposant une formule optique
à deux lentilles convexes. Cette idée fut mise en application vers
1630 par l'Allemand Christophe Scheiner, un père jésuite astronome
et mathématicien. Pour la petite histoire, sachez que c'est Scheiner
qui a découvert les taches solaires avec sa petite luenette.
Du fait des difficultés dues à l'aberration sphérique des lentilles
d'une lunette, la longueur focale doit être très élevée.
On est allé jusqu'à construire jadis une lunette de
61 m de longueur focale !
|
|
Premières lunettes astronomiques
De conception rudimentaire, les lunettes de Galilée
lui permirent d'effectuer de nombreuses observations du ciel : découverte
des cratères de la Lune, des satellites de la planète Jupiter,
des phases de la planète Vénus, des étoiles
composant la Voie Lactée. Elles étaient constituées d'une unique
lentille de verre. Sa première lentille, d'un diamètre de 2 cm,
ne grossissait que trois fois. |

|
Simplicité du principe de la lunette
Dans une lunette, la lumière venant des astres
traverse un jeu de lentilles qui la dévie.
La grande lentille de l'objectif d'une
lunette capte la lumière et forme une image, qui est ensuite grossie
par l'oculaire. Le rôle de l'objectif de la lunette est de
capter le maximum de rayons lumineux en provenance des étoiles et
de les concentrer en un point appelé foyer. L'oculaire est en fait
une petite loupe. La partie optique est maintenue dans un tube métallique,
lui-même supporté par une monture mécanique sur trépied. La puissance
d'une lunette astronomique, sa capacité à distinguer
deux points très éloignés (= son pouvoir de
résolution), dépend du diamètre de son objectif. Cet objectif
est aujourd'hui généralement constitué d'un assemblage de deux lentilles
ou plus, possédant une courbure étudiée, qui assurent une bonne
correction des défauts chromatiques dus au passage de la lumière
à travers le verre.
|
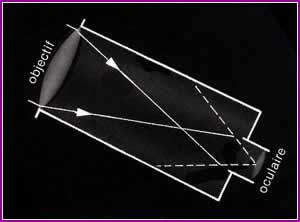
|
|
Les plus grandes lunettes du monde
L'étude des étoiles exige des instruments de grande taille, très
perfectionnés. |
Nom de l'observatoire (et localisation)
|
Diamètre de l'objectif (m)
|
Longueur de focale (m)
|
Année de mise en service
|
|
Mt Stromlo(Australie)
|
0,66
|
10,8
|
1956
|
|
Johannesburg (Afr. du Sud)
|
0,67
|
10,9
|
1925
|
|
Allegheny (Pennsylvanie, U.S.A.)
|
0,76
|
14,1
|
1914
|
|
Potsdam (R.D.A.).
|
0,80
|
12,0
|
1905
|
|
Greenwich ( G.B. )
|
0,66
|
6,8
|
1899
|
|
Yerkes (Wisconsin, U.S.A.)
|
1,02
|
19,4
|
1897
|
|
Berlin (R.D.A.)
|
0,68
|
10,5
|
1896
|
|
(G.- B.)
|
0,71
|
8,5
|
1894
|
|
Meudon (France).
|
0,83
|
16,2
|
1891
|
|
Lick(Californie, U.S.A.)
|
0,91
|
17,6
|
1888
|
|
Nice (France)
|
0,76
|
17,9
|
1887
|
|
Mc Cormik (Virginie, U.S.A.)
|
0,67
|
9,9
|
1883
|
|
Vienne (Autriche)
|
0,68
|
10,5
|
1878
|
|
U.S.Naval Observatory (Washington, Colombia, U.S.A)
|
0,66
|
9,9
|
1873
|
|
|
| |
|
| |
|