| |
Les outils de l'Astronome |
|
| |
|
|

|
|
Instruments d'observation
Les
jumelles classiques, avec ou sans zoom, de poche ou pliantes,
elles sont légères, maniables et peu encombrantes. Un grand nombre
d'amas d'étoiles, plusieurs nébuleuses et galaxies
sont accessibles avec une bonne paire de jumelles
La lunette astronomique est l'instrument idéal pour observer la
Lune et les principales planètes comme Mars, Jupiter et Saturne.
Elle permet de s'initier à l'astronomie pour un budget raisonnable. Inconvénient : si les optiques sont généralement assez correctes, par contre la monture des petites lunettes d'initiation est généralement d'un niveau catastrophique.
Le télescope : son rapport qualité/prix permet d'avoir des
instruments de plus grand diamètre, plus sensibles à la lumière,
ce qui permet d'observer des astres éloignés (nébuleuses,
galaxies) ainsi que beaucoup plus de détails sur les planètes. |
|
La distance focale
La distance focale (ou longueur focale) est la distance séparant une lentille du point où les rayons lumineux émis par une étoile se concentrent pour fournir une image bien nette de l’étoile. Le point de netteté est appelé « point focal » ou bien « foyer » de la lentille. En avant de ce point, on parle de zone intra-focale et au-delà de zone extra-focale. Par abus de langage, certains astronomes parlent de focalisation lorsqu’ils veulent parler de la mise au point de leur télescope. |

|
Le rapport d'ouverture
C'est un bon indicateur
de la luminosité de l'instrument. On l'obtient en divisant la distance
focale F par le diamètre D de votre instrument. Pour observer les
astres faiblement lumineux du ciel profond (nébuleuses, galaxies) choisissez
un rapport d'ouverture F/D inférieur à 5.
Inversement, un rapport supérieur à 10 est préférable
pour l'observation des planètes.
Entre 5 et 10, on dispose d'un équipement polyvalent. |
Exemple :
Un instrument de 60 mm de diamètre et de 800 mm de longueur
focale , a un rapport d'ouverture de 800/60 = 13,33. |
La qualité des oculaires
Il existe un grand nombre
de types d'oculaires dont la qualité, c'est-à-dire la capacité à
corriger les défauts d'observation et à obtenir une image mieux
définie, va de pair avec le nombre de lentilles qui les composent.
L'oculaire d'un télescope agit comme une loupe et agrandit
l'image formée au niveau du foyer de votre instrument. Il est caractérisé
par un chiffre en mm qui correspond à la focale f de sa lentille
: par exemple 6 mm ou 20 mm. |
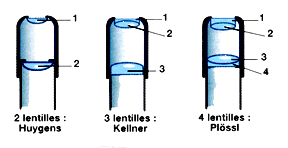
|
Le grossissement
Il est lié à loculaire
utilisé. Contrairement aux apparences, un oculaire de 6 mm grossit
davantage qu'un de 20 mm : en effet, le grossissement donné
par un oculaire s'obtient en divisant la focale F du télescope
par la focale f de votre oculaire : G = F/f
Conseil pratique : ne vous laissez pas piéger par les grossissements
mirobolants proposés par certains commerçants. La
luminosité de votre image diminue très rapidement lorsqu'on
augmente le grossissement. Il vaut mieux avoir une petite image
bien nette, bien contrastée, plutôt qu'un gros pâté
flou et sombre lorsque vous observerez dans votre télescope.
En pratique, en Normandie, il est généralement inutile
de grossir plus de 1,5 fois le diamètre de l'objectif de votre télescope.
Au grand maximum, en cas de ciel exceptionnellement transparent,
vous pouvez espérer grossir jusqu'à 2,4 fois le diamètre
de votre objectif. Exemple : avec une lunette 60 / 800, par exemple,
le grossissement le plus couramment utilisé ne doit pas dépasser 60 x 1,5 = 90 fois.
Et si vous avez la chance d'avoir un ciel exceptionnel, vous pourrez
monter jusqu'à 60 x 2,4 = 144 fois. |

|
La barlow
C'est une optique spéciale qui multiplie le grossissement
par 2 ou 3 le grossissement d'un oculaire. Il suffit d'insérer lo'culaiedans lalentille de Barlow et de placer le tout dans le porte-oculaire du télescope. Avec un
oculaire de 4 mm, par exemple, offrant un grossissement de 200,
on peut ainsi obtenir un grossissement de 600 avec un Barlow 3 fois.
Mais n'oubliez pas que la luminosité de l'image est approximativement
divisée par 4 chaque fois que vous multiplierez le grossissement
par 2 |

|
|
La monture
C'est le trépied
sur lequel est posé votre lunette ou votre télescope. C'est
cette monture qui permet de suivre le déplacement des planètes, éventuellement
de façon automatique si elle dispose d'un moteur.
Il en existe plusieurs types qui se regroupent en fait en deux grandes
familles : |
La monture azimutale
La plus simple : un trépied,
avec un axe vertical et un axe horizontal. Elle permet d'effectuer
une orientation verticale et une rotation horizontale. Seule difficulté,
ce type de monture ne permet pas de suivre très facilement
la course des étoiles dans le ciel car vous devez alors agir
simultanément sur les deux axes. |
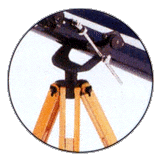
|
La monture équatoriale
Idéale en astronomie,
elle permet de suivre les déplacements des planètes et des étoiles
en n'agissant que sur un seul mouvement. Revers de la médaille
: ce système ne fonctionne que si la monture a été
correctement alignée sur le pôle Nord céleste
(les astronomes appellent cette procédure d'alignement la
"mise en station" du télescope). D'un maniement
plus technique, cette monture offre des possibilités d'observation
plus variées, plus précises et dans de meilleures conditions
de confort. Elle permet également de faire des photos du ciel. Le
fin du fin : la monture équatoriale motorisée, informatisée
et équipée d'un GPS : mise en station automatique,
repérage des étoiles automatique, pointage et suivi
des étoiles automatiques ... très pratique ... mais plus
cher ... |

|
La Terre tourne ! Hé oui.
Cette évidence, peu perceptible
à l'oeil nu, entraîne par contre une difficulté d'observation
bien connue des astronomes lorsqu'ils se servent de leurs télescopes
: les objets célestes disparaissent rapidement du champ de vision
si on ne les "suit" pas. Si vous voulez observer la Lune, une monture
azimutale suffit largement. En revanche, préférez une monture équatoriale
pour l'observation des astres les moins lumineux, vous éviterez
ainsi de passer votre temps à chercher votre sujet plutôt qu'à l'observer.
|
|
| |
|
| |
|