|
Un télescope de 114 mm de diamètre, avec un grossissement
entre x 100 et x 150, vous montrera les bandes nuageuses les plus
fines qui ceinturent Jupiter, ainsi que des détails dans
ces dernières : nodosités, irrégularités.
Sur l'image ci-dessous, on parvient même à repérer
la Grande Tache Rouge : la voyez-vous ?

Schéma ASCT-astronomie / Ph Ledoux
Jupiter dans un télescope de 114 mm, sous
un ciel bien transparent
Mais si, on la voit ! Un peu ... Regardez bien sur le limbe de
Jupiter, à l'extrêmité gauche de la bande nuageuse
située sur la zone tempérée de Jupiter : on
commence à distinguer une petite tache ovale, de couleur
vaguement bistre. C'est la Grande Tache Rouge. Difficile d'en voir
plus avec un petit télescope de 114 mm de diamètre
...
La Grande Tache Rouge est un gigantesque cyclone
qui agite la haute atmosphère jovienne : 2 planètes
équivalentes à la Terre tiendraient à l'aise
dans ce monstrueux ouragan. Découvert en 1664 par Robert
Hooke, la Grande Tache Rouge semble diminuer de 0,19° tous les
ans depuis plusieurs décennies. De même, sa couleur
rouge tend à virer de plus en plus au beige et au ton crème
: peut-être la GTR (=Grande Tache Rouge) aura-t'elle totalement
disparu dans quelques années ?
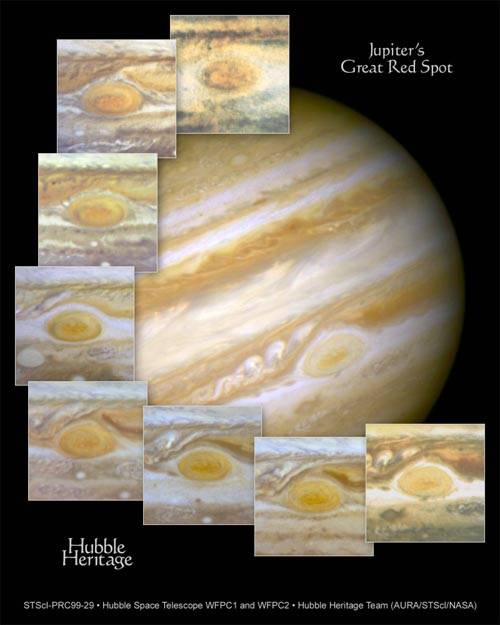
Quant au disque jovien par lui-même, votre télescope
vous montrera qu'il n'a pas de limite bien tranchée : le
disque de Jupiter tend à s'assombrir petit à petit
au fur et à mesure qu'on déplace le regard vers sa
périphérie. Car Jupiter n'est pas une planète
solide, mais une énorme boule de gaz et cet assombrissement
est dû aux épais nuages de la haute atmosphère
jovienne qui absorbent la lumière

Enfin, avec un grossissement x 150 à x 200, vous pouvez
voir la diminution progressive d'éclat puis l'extinction
totale des satellites lorsqu'ils pénètrent dans l'ombre
de Jupiter. Et si la turbulence du ciel n'est pas trop importante,
vous aurez également une bonne chance de réussir à
observer le passage de l'ombre des satellites devant le disque de
Jupiter, où ils auront l'aspect d'une petite tache noire

Double passage d'ombre sur Jupiter. Photo ASCT-astronomie / Ph
Ledoux
Par contre, voir le satellite lui-même est difficile avec
un modeste télescope de 114 mm de diamètre. Un diamètre
supérieur est nécessaire pour réussir ce
type d'observation
C'est grâce à l'observation des éclipses et
des occultations que l'astronome Olaus Römer parvint à
mesurer la vitesse de la lumière.
En 1671, cet astronome danois fut invité à l'observatoire
d'Uraniborg, sur l'île de Hven, afin d'en déterminer
la longitude de façon exacte. Afin de calculer celle-ci,
Römer avait besoin d'une détermination extrêmement
précise de l'heure. La montre venait tout juste d'être
inventée par Huyghens, en 1657, et sa précision laissait
encore un peu à désirer. Römer eût alors
l'idée de se servir de la grande horloge de la mécanique
céleste en observant l'heure des éclipses de Io, l'une
des 4 principales lunes de Jupiter, comme Galilée l'avait
déjà fait avec succès quelques années
avant lui.
Au bout de 8 mois d'observations de ces éclipses, Römer
se rendit compte que quelque chose clochait : l'intervalle entre
chaque éclipse de Io variait très légèrement,
en fonction de la position de la Terre sur son orbite. Lorsque la
Terre était plus éloignée de Jupiter, les éclipses
avaient lieu plus tard que lorsque la Terre était au plus
près de Jupiter. Olaus Römer trouva assez rapidement
la solution de cette énigme : la lumière de Io ne
se déplace pas instantanément dans l'espace, comme
on le croyait autrefois. Au contraire, elle a besoin de quelques
minutes pour nous parvenir. Et plus Io est éloignée
de la Terre, plus sa lumière met de temps à nous atteindre.
Cette découverte de Römer permit la première
estimation de la vitesse de la lumière : 214 000 km/s, ce
qui n'était pas très éloigné de sa véritable
valeur : 299 792,458 km/s
|