1. Les tentatives des grecs pour mesurer
la distance des étoiles
C'est Aristarque de Samos, qui émit vers 310 avant J-C,
l'idée que la Terre était ronde.
Continuant sur sa lancée, il eut également l'idée
que l'alternance du jour et de la nuit était due à
la rotation de la Terre sur elle-même.
Encore plus balèze : il imagina que la Terre tournait autour
du Soleil, bien avant Copernic. Mais comme lui, Aristarque fut accusé
d'impiété par ses contemporains, et ses enseignements
passèrent dans la grande trappe de l'Histoire.

Mais ses travaux ne furent pas totalement perdus puisqu'à
la même époque, Eratosthène d'Alexandrie s'en
servit pour calculer le rayon de la Terre, aboutissant à
la valeur de 6400 km. Chapeau bas l'artiste ! Le rayon réel
de la Terre étant de 6378 km à l'équateur,
on appréciera la performance du père Eratosthène
(284-192 avant J-C) ! On peut dire que ce fut la première
distance astronomique correctement établie .
Une cinquantaine d'années après Aristarque, Hipparque
de Nicée s'attela au calcul de la distance Terre-Lune. Ce
mathématicien génial fit tout simplement appel à
la trigonométrie (le théorème de son vieux
pote de lycée Pythagore, çà vous rappelle quelque
chose ?) pour estimer le rapport qu'il y avait entre la distance
Terre-Lune et la distance Terre-Soleil. Pour en savoir plus, cliquez
sur le dessin ci-dessous ...
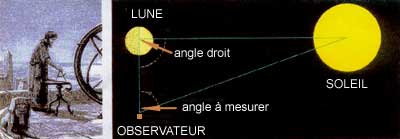
Hipparque aboutit à la conclusion que la distance Terre-Lune
est de 32,5 fois le diamètre de la Terre. Admirez là
encore la performance puisque la valeur exacte est de 30 fois !!!
Une fois ce menu travail accompli, Hipparque de Nicée découvrit
la précession des équinoxes puis, comme il se barbait
un peu, il établit le premier catalogue connu d'étoiles
: 1000 étoiles, classées par ordre de luminosité,
d'une grandeur de 1 à 6.
Dans les siècles qui ont suivi, les plus connus des grands
astronomes grecs restent Aristote et Ptolémée dont
le célèbre ouvrage "L'almageste" devait
constituer la base de toute l'astronomie au Moyen-Age. Hélas,
l'un et l'autre "oublièrent" les travaux d'Hipparque,
Eratosthène et Aristarque de Samos.

2. Les tentatives des arabes et des
perses :
n'avaient pas repris le flambeau : citons les tables astronomiques
réunies au IX ème siècle par Mohamed Al-Battani dans
son livre le "Zij " ou encore, au X ème siècle
le " Livre sur les constellations fixes " d'Abd Al-Rahman
As-Sufi.

En particulier, on retiendra le nom d'El-Farghâni dont
la traduction en latin de ses " éléments
d’astronomie ", au IX ème siècle, allaient
rester la référence de tous les calculs astronomiques
jusqu’à Copernic.
Si Charles Martel a arrêté les sarrazins à
Poitiers en 732 après J-C, il les a laissé s'installer
en Espagne. Sacré coup de pot ! Car c'est à Tolède
que naquit l'une des plus brillantes écoles d'astronomie
arabe, école qui s'attacha en particulier à retraduire
les textes grecs et perses en latin, permettant ainsi leur diffusion
en Occident.

3. Copernic et Képler mesurent les
proportions du système solaire :
Après bien des siècles d'errances et d'erreurs, Copernic
(1473-1543) réussit enfin à établir que toutes
les planètes connues à l'époque tournaient
autour du Soleil et que la Terre n'était pas le centre de
l'univers.
Reprenant les travaux de Copernic, Képler (1571-1630) réussit,
après des années d'un travail minutieux et harassant,
à calculer les lois qui régissent les mouvements des
planètes autour du Soleil puis à mesurer les distances
entre le Soleil et les planètes. Mais Képler ne parvint
calculer ces distances qu'en comparaison avec la distance Terre-Soleil
(= l'Unité astronomique UA). Képler établit
ainsi que la distance Mercure-Soleil était de 0,4 UA, la
distance Vénus-Soleil de 0,7 UA, la distance Mars-Soleil
de 1,5 UA, la distance Jupiter-Soleil de 5,2 UA, la distance Saturne-Soleil
de 9,5 UA.

Photo de Képler le jour de sa 1 ère communion
4. Cassini et Richer calculent la
distance Terre-Soleil :
En 1671, Richer partit en expédition à Cayenne pendant
que Cassini restait à Paris. Chacun de leur côté,
ils mesurèrent la position de la planète Mars dans
le ciel par rapport aux étoiles. De retour à Paris,
Richer compara ses mesures avec celles de Cassini : tous deux constatèrent
que Mars n'était pas tout à fait au même endroit
du ciel. Un petit coup de trigonométrie appliqué au
triangle Mars-Cayenne-Paris et la distance Terre-Mars était
connue. Une simple de règle de trois permit ensuite à
Richer et Cassini de déduire la valeur exacte de la distance
Terre-Soleil, la fameuse Unité Astronomique.

Cassini en peignoir
Mais il fallut attendre le XX ème
siècle pour que la question de la distance des étoiles
trouve des réponses satisfaisantes |