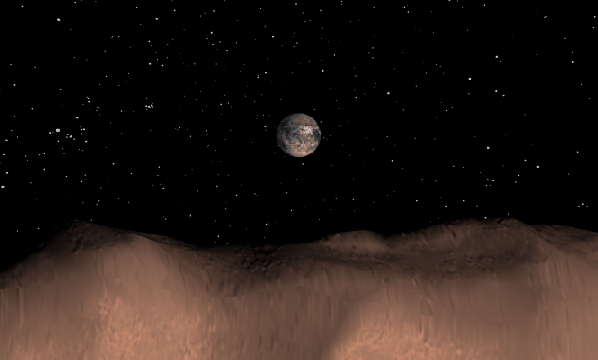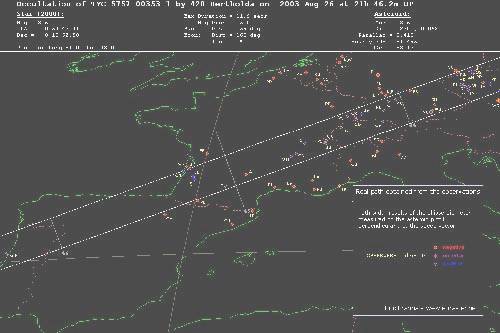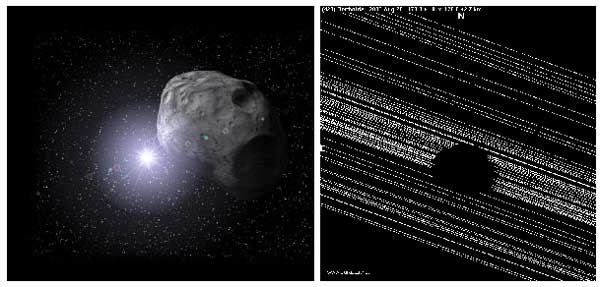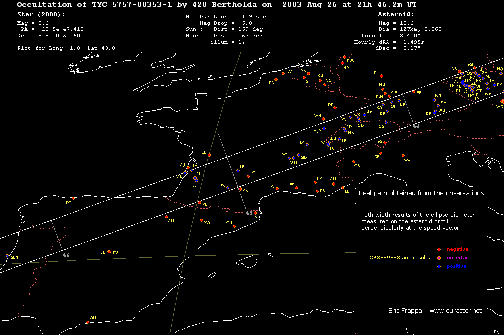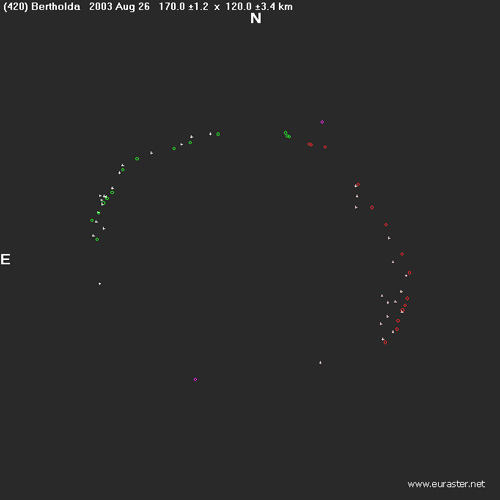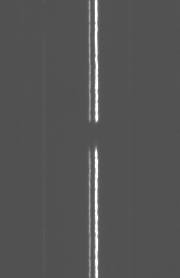C'est grâce à une caméra électronique
CCD qu'Alain Maury est parvenu à découvrir 4179 Toutatis.
L'invention de ces caméras CCD a accru de façon considérable
le nombre de découvertes, et a totalement supplanté la technique
photographique traditionnelle. La baisse des prix de ces caméras
électronique a permis à un nombre croissant d'astronomes
amateurs de s'équiper... et aux plus motivés de se tailler
leur part du gâteau, et de découvrir eux aussi des astéroïdes
ainsi qu'en témoigne remarquablement le site Internet où
Denis
Bergeron explique comment il est parvenu à réussir ses
4 découvertes.
La meilleure saison pour chasser les astéroïdes se situe
de septembre à mars : nuits plus longues et ciel plus noir obligent
! La zone de l'écliptique observable autour de l'opposition des
astéroïdes se situe dans les déclinaisons Nord, lesquelles sont
mieux visibles en hiver. De plus, l'écliptique à cette période de
l'année est bien dégagée de la Voie Lactée et de son fourmillement
d'étoiles qui empêche quasiment tout suivi d'un astéroïde.
Les télescopes professionnels mitraillant le ciel essentiellement
lors du passage à l'opposition des astéroïdes, l'astronome amateur astucieux
aura intérêt à chasser l'astéroïde AVANT l'opposition, dans le ciel du
matin, afin de ne pas se faire coiffer sur le poteau par les astronomes
professionnels. A ce petit jeu, beaucoup d'astronomes amateurs sont devenus
des maîtres. Les champions incontestables de ces chasseurs amateurs
d'astéroïdes sont les époux Van Houten (1010 découvertes
pour Monsieur et 1008 pour Madame !!!). Les japonais sont également
très fortiches à ce petit jeu, à l'instar de Takao
Kobayashi, qui a accumulé 567 découvertes homologuées
!

Tout astéroïde nouvellement découvert
porte un numéro de code provisoire, composé de l'année
de sa découverte, suivie d'une lettre indiquant la quinzaine de
l'année au cours de laquelle il a été découvert
(A = première quinzaine du mois de janvier, B = deuxième
quinzaine du mois de janvier, C = première quinzaine du mois de
février, D = deuxième quinzaine du mois de février,
etc...). Lorsque l'astéroïde a été suivi suffisamment
longtemps pour que son orbite puisse être calculée avec précision,
l'Union Astronomique Internationale lui donne un nom définitif,
précédé du numéro d'ordre de sa découverte.
C'est ainsi que le tout premier astéroïde découvert
s'appelle aujourd'hui 1 Cérès. Le deuxième astéroïde
découvert : 2 Pallas, le troisième : 3 Juno, le quatrième
: 4 Vesta.
Au début, on a donné aux astéroïdes
des noms de la mythologie. Puis, devant le nombre énorme de nouvelles
découvertes, la mythologie s'est trouvée à court
de noms et les astronomes sont allés imaginer des noms plus originaux
: il existe ainsi un astéroïde 3834 Zappafranck en l'honneur
de la star rock qui venait de décéder au moment de sa découverte
! On note aussi l'existence d'un 9631 Hubertreeves. Il y a même
un astéroïde baptisé 4179 Toutatis par son découvreur,
le français Alain Maury. Ce dernier a également proposé
que les cratères qui parsèment la surface de cet astéroïde
soient baptisés de noms tirés de la BD "Astérix".
Mais l'Union Astronomique Internationale n'a pas encore donné son
feu vert... Une spectaculaire animation de la rotation chaotique de Toutatis
sur lui-même est disponible en cliquant sur l'image ci-dessous (format
mpeg, 483 Ko).
|
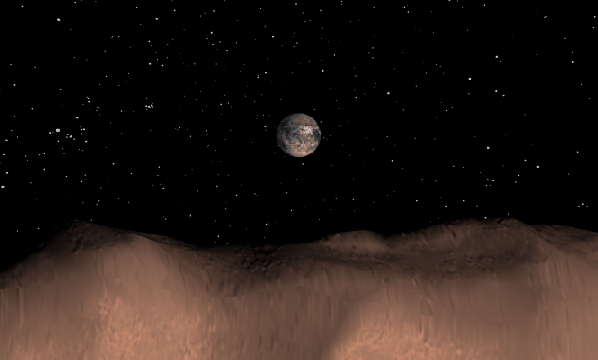
|
|
|
Aux plaisirs solitaires de la chasse aux nouveaux astéroïdes
peut s'ajouter également le plaisir partagé de l'observation
des occultations d'une étoile par un astéroïde. Lorsque
l'astéroïde passe devant l'étoile, celle-ci s'éteint
comme par magie durant quelques secondes avant de réapparaître
tout aussi brutalement. Le spectacle est étonnant et mystérieux...
mais pour le voir, il faut se trouver sur le chemin de l'ombre de cette
occultation, exactement comme pour une éclipse de Soleil. Les orbites
des astéroïdes n'étant pas toujours connues avec une
précision totale, il persiste toujours une part d'incertitude dans
l'observation de ces occultations : la verra ? la verra pas ?
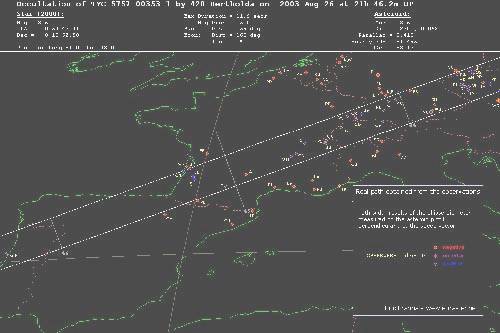
Août 2003 : les observateurs situés dans la bande de centralité
ont observé l'occultation d'une étoile par l'astéroïde
Bertholda
Le plaisir du spectacle peut aussi être associé
à la joie de faire oeuvre utile : les occultations d'étoiles
par des astéroïdes sont des phénomènes guettés
avec impatience par les professionnels qui font appel à ces occasions
aux astronomes amateurs pour les aider à multiplier le nombre d'observations.
Chaque observateur doit noter avec précision l'heure à laquelle
l'étoile s'éteint et l'heure à laquelle elle répparait
: ce timing varie selon le lieu d'observation et permet de calculer des
"cordes" qui permettront aux astronomes professionnels de déterminer
la forme exacte de l'astéroïde avec une précision de
l'ordre du kilomètre.
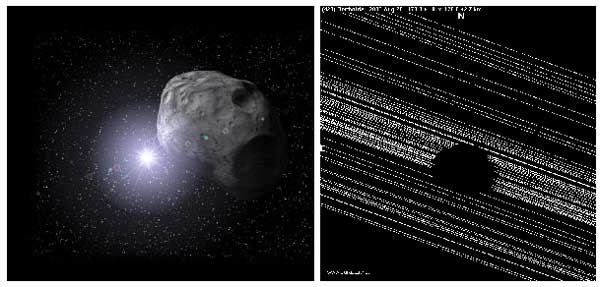
Les "cordes" calculées depuis les différents
sites d'observation dessinent la silhouette de l'astéroïde
Schéma Eric Frappa
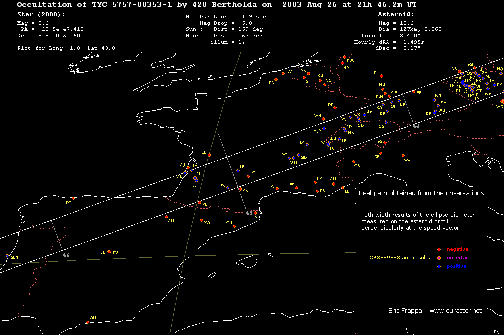
Cliquer sur la photo pour voir la totalité de l'image
Les résultats obtenus par les différents observateurs
lors de l'occultation de l'étoile TYC 5757-00353-1 par l'astéroïde
Bertholda
Schéma Eric Frappa
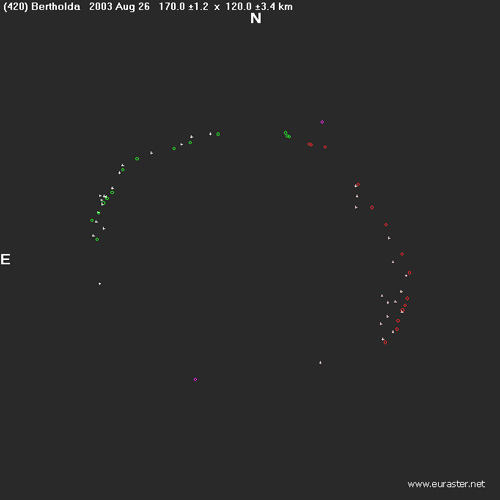
La forme de l'astéroïde Bertholda calculée par les
astronomes professionnels
Schéma Eric Frappa
Là encore, l'apport des caméras CCD a permis
aux observateurs de faire un bond en avant considérable dans la
précision de leurs observations, grâce à la technique
du scan : en laissant défiler le ciel devant leur caméra
CCD, les observateurs peuvent enregistrer un filé de l'étoile
jusqu'au moment où elle va s'éteindre, masquée par
l'astéroïde. Cette technique permet d'atteindre une précision
de l'ordre du 1/10 de seconde dans le timing de l'occultation.
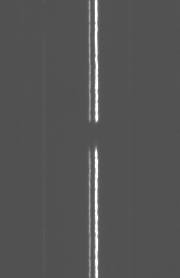
Pour connaître les occultations à venir,
consultez le site tchèque
de Jan Manek (site écrit en anglais).
|