LES TROUS DE LA CEINTURE PRINCIPALE DES ASTEROIDES
Dans le fatras des orbites de la multitude d'astéroïdes connus,
on distingue cependant plusieurs grands groupes :
La Ceinture dite Principale, située entre les orbites de Mars
et Jupiter, et distante de 2 à 3.5 unités astronomiques du Soleil (c'est
à dire entre 310 et 520 millions de kilomètres du Soleil), constitue
le principal groupement d'astéroïdes.
Cette ceinture n'est pas homogène : en certains points de la ceinture,
on trouve des concentrations plus importantes d'astéroïdes
présentant des orbites similaires, baptisées "familles"
par l'astronome japonais Hirayama en 1918. On distingue 6 grandes familles,
dénommées selon le nom de leur astéroïde principal
: les Flore, les Eros, les Thémis, les Coronis, les Maria et les
Troyens.
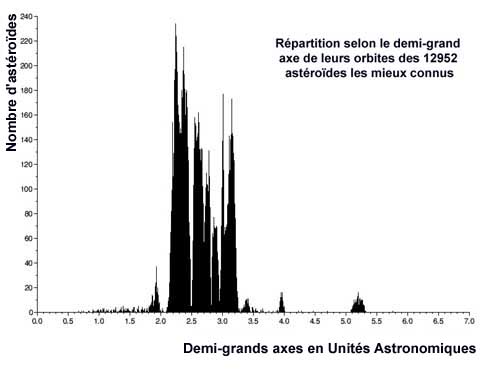
Au contraire, d'autres régions de la ceinture principale sont
quasiment dépeuplées : ces trous sont appelés
les lacunes de Kirkwood. Elles correspondent à des régions
de résonance avec l'attraction gravitationnelle de la planète
géante Jupiter. Les effets de marées gravitationnelles
y sont amplifiés de telle sorte qu'aucun astéroïde
ne peut y subsister sans être disloqué ou éjecté
de ces orbites.
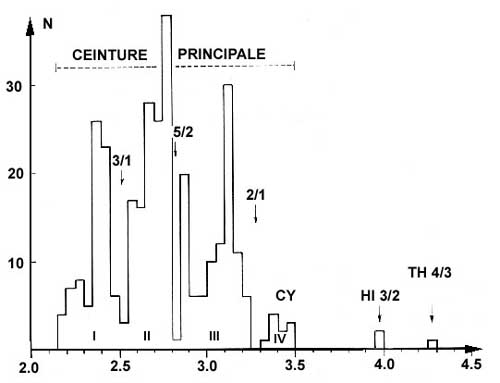
Histogramme des demi-grands axes des 322 astéroïdes découverts
avant 1892
Sur le schéma ci-dessus, les régions I, II et III, très
peuplées, correspondent à la Ceinture Principale des
astéroïdes. Les lacunes de Kirkwood qui les séparent
sont nettement visibles. Les astronomes ont remarqué qu'elles
correspondent à des orbites dont la période de révolution
autour du Soleil est une fraction rationnelle simple de celle de
Jupiter. Par exemple, la zone des orbites ayant un demi-grand axe
de 2.5 UA correspond à une résonance 3/1 : un astre
situé sur cette orbite fait exactement 3 révolutions
autour du Soleil pendant que Jupiter n'en fera qu'une seule. Deux
autres lacunes de Kirkwood sont facilement identifiables sur le
schéma ci-dessus : les orbites de 2.82 UA de demi-grand axe,
qui correspondent à une résonance 5/2 (les astéroïdes
y accomplissent 5 révolutions autour du Soleil pendant que
Jupiter en fait 2); et les orbites de 3.28 UA de demi-grand axe,
en résonance 2/1 avec Jupiter (2 tours du Soleil pour 1).

Rappel de la définition du demi-grand axe d'une orbite
Mais toutes les zones de résonance gravitationnelle ne donnent
pas forcément une lacune de Kirkwood. Certaines résonances
ont au contraire un effet de stabilisation des orbites. C'est ce
qui se passe dans la zone IV du schéma précédent,
qui correspond à la frontière externe de la ceinture
Principale, aux alentours de 3.4 UA : c'est à ce niveau que
se trouvent les astéroïdes de la même famille
que l'astéroïde 65 Cybèle. Des groupes isolés
d'astéroïdes sont également visibles en dehors
de la Ceinture Principale : les astéroïdes de la famille
de 153 Hilda, dont l'orbite est en résonance stabilisatrice
3/2 avec Jupiter, et les astéroïdes de la famille de
279 Thulé, en résonance stabilisatrice 4/3
Malgré de nombreux travaux de recherche et l'aide des
ordinateurs les plus puissants, on n'a pas encore réussi de nos jours
à faire une théorie générale du comportement des orbites près des résonances.
Seuls des cas particuliers sont bien élucidés mais pour la majorité
des astéroïdes, il persiste une part d'incertitude dans les
calculs de leurs paramètres orbitaux.
LES TROYENS
Ces astéroïdes circulent exactement sur la
même orbite que Jupiter qu'ils escortent : un premier groupe précède
Jupiter sur son orbite et un second le suit. On leur a donné le
nom des héros mythologiques de la guerre de Troie. Les astéroïdes
du groupe qui précède Jupiter ont reçu les noms des
héros grecs de cette guerre chantée par Homère dans
son poème épique "l'Iliade": Achille, Agamemnon,
Ulysse, Nestor, Ajax, Diomède, etc... Et, logiquement, les astéroïdes
du groupe qui suit Jupiter ont reçu les noms des héros troyens
: Patrocle, Hector, Priam, etc...
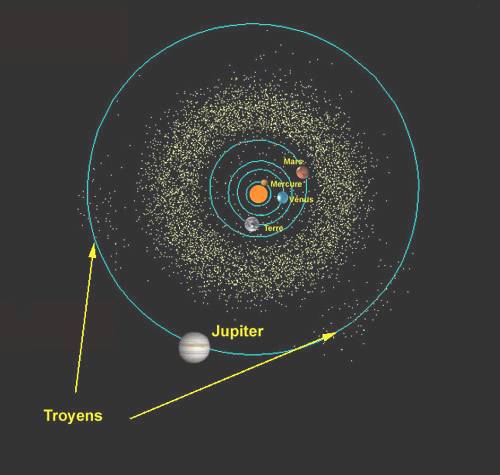
Comme ils sont situés sur la même orbite
que Jupiter, les astéroïdes troyens sont séparés
du Soleil par la même distance ( 778 000 000 km) et mettent
donc le même temps pour boucler une orbite autour de notre
étoile : 11,9 années. Il y a plus de 1200 astéroïdes troyens
observés à ce jour. Leur curieuse position sur l'orbite de Jupiter
s'explique par une particularité des lois de l'attraction
gravitationnelle : les astéroïdes troyens sont placés
exactement sur les points de Lagrange.
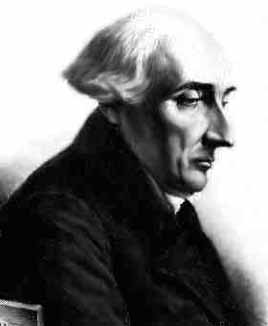
Le mathématicien Joseph-Louis Lagrange (1736-1813)
Les points de Lagrange sont les points d'équilibre
parfait entre l'attraction gravitationnelle du Soleil et celle de la planète
géante Jupiter. Les points de Lagrange L4 et L5 délimitent
un angle bien précis, de 60°, entre le Soleil et Jupiter (cf
schéma ci-dessous).
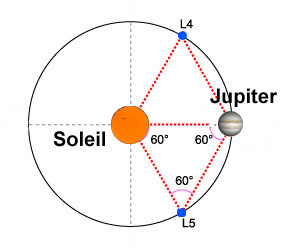
Les troyens ne sont pas répartis également entre ceux
qui sont "en avance" et ceux qui sont "en retard" sur Jupiter. Il y a
696 astéroïdes sur le point de Lagrange L4, qui précède
Jupiter et 519 sur le point de Lagrange L5, qui suit Jupiter. A noter
également que s'ils restent à distance constante de Jupiter, l'excentricité
et l'inclinaison de leurs orbites sont bien plus fortes que celles de
Jupiter.
La planète Mars possède également
quelques astéroïdes sur ses points de Lagrange, le plus gros
s'appelant Eureka. On ignore pour l'instant s'il existe des petits astéroïdes
sur les points de Lagrange de notre propre planète.
LES ASTEROIDES GEOCROISEURS
Cette famille d'astéroïdes a réveillé
l'intérêt de la communauté scientifique pour les astéroïdes.
Les astéroïdes géocroiseurs (Near Earth Asteroids ou Earth-Crossing Asteroids
en anglais) sont des astéroïdes dont l'orbite est relativement proche
de celle de la Terre. C'est en 1932 que l'astronome Delporte réussit
à photographier l'astéroïde 1221 Amor, alors qu'il
passait à seulement 16 millions de km de la Terre. Un mois plus
tard, ce fut au tour de 1862 Apollo d'être découvert : pour
la première fois, les astronomes se trouvaient en présence
d'astéroïdes pénétrant à l'intérieur
de l'orbite terrestre. Plusieurs autres astéroïdes géocroiseurs
ont été découverts depuis : Adonis, qui est venu
frôler la terre à 2 millions de km et, surtout Hermès,
qui est passé à moins de 800 000 km. Ces astéroïdes
ont une orbite qui plonge vers l'intérieur du système solaire,
ce qui peut les amener à croiser la route de planètes comme
la Terre...
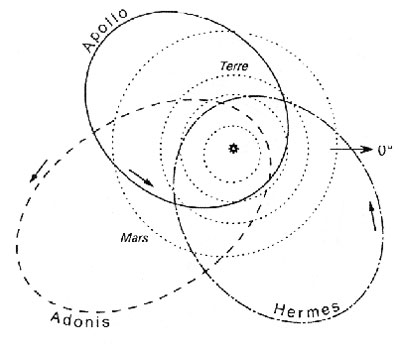
Schéma Jean Meeus - Société Astronomique de France
... Et qui dit croisement d'orbite dit risque de collision
potentielle ! Les spécialistes de la préhistoire sont à
peu près certains que c'est un choc de cette nature qui a entraîné
l'extinction des dinosaures.

La Terre porte encore des traces de ces rencontres cataclysmiques
:

Le "meteor crater" en Arizona (USA)
Plusieurs familles d'astéroïdes géocroiseurs ont
été identifiées :
- Les Amors, dont le principal représentant est l'astéroïde
Eros, qui traversent l'orbite de Mars mais jamais celle de la Terre,
et qui ne peuvent donc entrer en collision avec cette dernière
(ouf !)
- La famille des Aten, dont l'orbite passe à proximité du Soleil.
- La famille des Apollo, dont l'orbite passe légèrement au-delà de
l'orbite terrestre
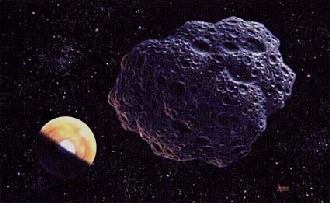
Seuls les Atens et les Apollos croisent l'orbite de
la Terre et l'intérêt grandissant qu'on leur porte est lié à la crainte
de les voir entrer en collision avec celle-ci. L'astéroïde
Toutatis découvert par le Français Alain Maury fait partie
de la famille des Apollo.Cet astéroïde est potentiellement
dangereux pour nous.
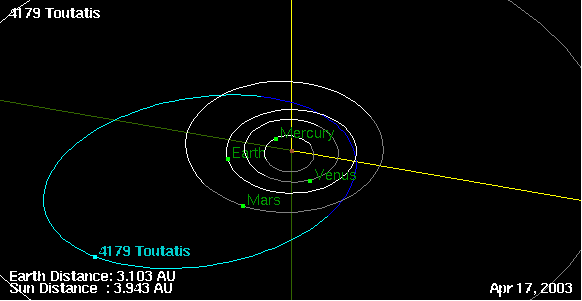
L'orbite de Toutatis
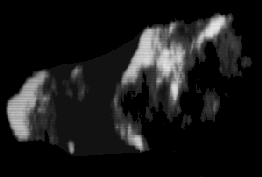
Image radar de Toutatis
Aujourd'hui fonctionnent plusieurs programmes de surveillance
de ces astéroïdes géocroiseurs, potentiellement dangereux
pour la Terre : en 1989, il y a eu le programme Spacewatch, et depuis
1996 le programme LINEAR. Ce dernier programme possède cependant
une face cachée : il s'agit également d'un programme militaire
américain, destiné à mener la "guerre des
étoiles".
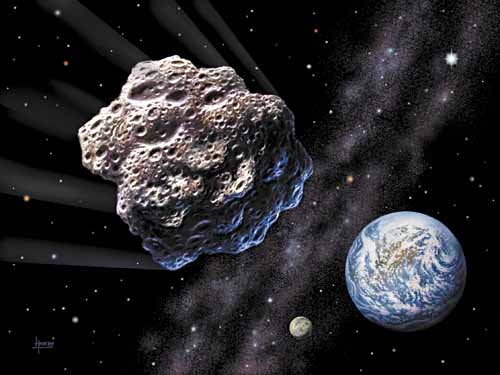
LES CENTAURES
Avec la découverte de l'astéroïde
Chiron en 1977, les astronomes professionnels ont également découvert
une nouvelle classe d'objets, les Centaures, issus en majeure partie de
la ceinture de Kuiper, et qui circulent entre Jupiter et Neptune sur des
orbites instables et donc provisoires : ces objets d'origine trans-neptunienne
restent encore bien mystérieux. Ci-dessous, les orbites des deux
premiers centaures découverts, Chiron et Pholus, comparées
à celle de la comète Halley.
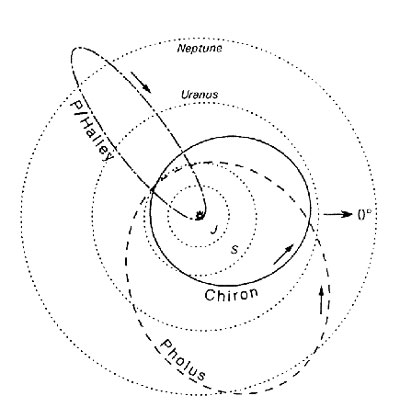
Schéma J. Meeus - Société Astonomique de France
Avec ses 200 km de diamètre, Chiron présenterait
plutôt les caractéristique d'un astéroïde; mais
en 1989, on a découvert autour de Chiron un halo de poussières
et de gaz analogues à ceux qui composent les comètes. Et
en 1997, c'est de la glace d'eau qui a été découverte
à la surface de Chiron. Alors, Chiron : astéroïde ou
comète ? Les astronomes supposent actuellement que les Centaures
sont des astéroïdes ou des comètes qui ont été éjectés de la ceinture
de Kuiper. Les Centaures correspondraient donc, au moins en partie, à
un réservoir de comètes à courte période.
Le cas de la comète Schwassmann-Wachmann 1 (SW1) est tout à fait éclairant
: sa morphologie est typiquement cométaire mais sa dynamique orbitaire
est incontestablement celle d'un Centaure
La frontière entre comètes, objets trans-neptuniens
et Centaures semble donc bien incertaine. La différence
majeure réside peut-être dans la masse de l'objet
: au-delà d'une certaine masse, la gravité propre
de l'objet lui permet de conserver captifs tous les gaz et toutes
les poussières qu'il contient. En-deçà de
cette masse critique, ces gaz et ses poussières pourront
s'échapper pour former la chevelure et la queue typiques
d'une comète. L'exemple de Chiron montre que la détermination
de cette masse critique n'est pas chose aisée !!!
DES PATATES ET DES OS DANS L'ESPACE :
Seuls les quelques astéroïdes d'une
taille supérieure à 600 km ont une forme sphérique.
L'immense majorité d'entre eux ont ont une forme irrégulière,
communément appelée en forme de "patatoïde". Cette différence
tient aux propriété différentes de 2 des
forces fondamentales de la nature : la force gravitationnelle
et la force électromagnétique. Toutes deux baissent
d'intensité lorsque la distance entre les corps augmente.
Mais la force électromagnétique est beaucoup plus
puissante : la répulsion électromagnétique
entre deux protons est 10 puissance 36 fois plus forte que leur
attraction gravitationnelle.
Lorsque la matière est à l'état
solide, et plongée dans un température aussi basse
que celle qui règne dans la ceinture des astéroïdes,
la force électromagnétique tend à lui donner
une structure cristalline qui la rend rigide et irrégulière.
C'est ce qui se passe pour les petits corps composant la majorité
des astéroïdes. Par contre, pour les plus gros, comme
Cérès ou vesta, c'est la force de l'attraction gravitationnelle
qui prend le dessus : toutes les forces gravitationnelles tendent
à s'additionner et toutes les parties de l'astéroïde
finissent par s'attirer réciproquement, ce qui finit par
lui donner la forme la plus compacte et la plus symétrique
qui soit : la forme d'une sphère. Bien sûr, ce processus
s'étalant sur des millions d'années, l'astéroïde
peut se trouver occasionnellement soumis à des contraintes
extérieures qui entraîneront des irrégularités
à sa surface : rides, fissures, vagues, cuvettes, etc...
La majorité des astéroïdes, de faible
masse, ne sont donc pas sphériques mais des "patatoïdes".
Des observations photométriques ont permis de démontrer que leur course
s'accompagne d'un mouvement de rotation sur eux-mêmes. Ceci explique
les variations régulières de leur éclat. Si vous regardez attentivement
l'animation réalisée ci-dessous par l'astronome amateur
Fernand Van Den Abbeel, vous distinguerez nettement les variations de
luminosité de l'astéroïde, dues à sa forme irrégulière.
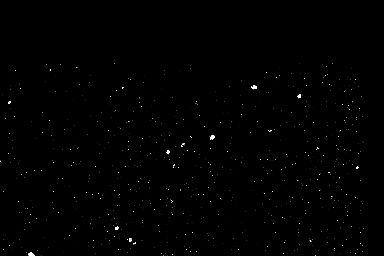
Cliquez sur l'image ci-dessus pour voir le film
Ainsi Vesta et Gaspra tournent sur eux-mêmes en
5 h 20 mn et 7 h. La période la plus longue est celle de Némésis qui atteint
39 h. Grâce à des méthodes d'interférométrie, on a pu conclure que pratiquement
tous les astéroïdes avaient une forme particulière, jamais sphérique,
aplatie pour les uns, elliptique pour la plupart. L'analyse de la courbe
de lumière de Gaspra illustre bien cette rotation de l'astéroïde
sur lui-même.
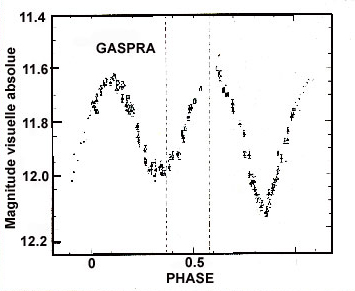
Courbe réalisée avec le télescope du Maunea Kea
(Hawaï)
La forme des courbes de lumière peut donner une
idée assez précise de la forme générale de
l'astéroïde.
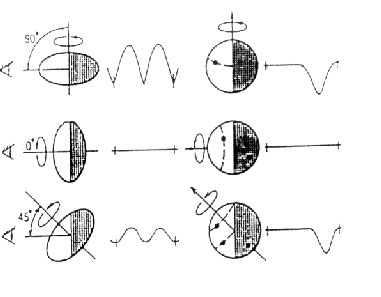
Un superbe exemple de rotation d'astéroïdes,
comparée à la rotation de la Terre, a été
reconstitué sur simulateur numérique pour les
astéroïdes Gaspra et Toutatis (861 Ko au format mpeg).
On a également découvert que certains astéroïdes
avaient été formés suite à la collision à faible vitesse de deux
corps, tels Toutatis, Hector ou Kleopatra, ce qui tend à confirmer l'hypothèse
selon laquelle les planètes ont également été formées par le même
mécanisme d'accrétion par collision.

Kleopatra : un os dans l'espace !
LA COMPOSITION DES ASTEROIDES :
La spectroscopie permet d'analyser la lumière
que la surface des astéroïdes reflète : le spectre
de cette lumière varie selon la composition de leur surface. Mais
ce type d'analyse est à prendre avec quelques pincettes : il ne
renseigne que sur la composition de la surface de l'astéroïde
mais ne dit rien de sa composition interne. Par ailleurs, seuls les astéroïdes
les plus lumineux, dont la surface reflète le mieux la lumière
du Soleil, sont facilement accessibles. Les astéroïdes plus
sombres, de faible albédo (= qui reflètent un pourcentage
plus faible de la lumière) sont beaucoup plus délicats à
analyser. Enfin, de nombreux astéroïdes ne sont pas forcément
homogènes et contiennent des minéraux différents
selon l'endroit de leur surface qui est tournée vers la Terre.
C'est le cas de l'astéroïde Asbolus, dont le spectre varie
selon la face qui est tournée vers la Terre : on suppose qu'il
a dû être victime d'un impact qui a mis à nu les couches
profondes de l'astéroïde, plus fraîches que le reste
de sa surface qui est exposée depuis des millions d'années
au vent solaire et aux rayonnements cosmiques.

Ces limites posées, on distingue cependant plusieurs
grands types d'astéroïdes :
- Les astéroïdes de type C : 75% des astéroïdes connus
sont de ce type. Le "C" signifiant carbone. Ces astéroïdes sont très
sombres (coefficient d'albédo autour de 0.03, c'est à dire
qu'ils ne reflètent que 3 % de la lumière du Soleil)
et similaires aux météorites. Leur composition chimique est proche
de celle du Soleil, excepté pour l'hydrogène, l'hélium et d'autres
gaz volatiles qui se sont évaporés depuis belle lurette
de ces astéroïdes
- Les astéroïdes de type S : 17% des astéroïdes sont de
type S, le "S" signifiant silice. Ils sont assez brillants
(albédo 0.10 à 0.22). Ils sont riches en métal (fer, nickel
et magnésium principalement). Leur spectre se situe vers le rouge,
similaire aux météorites sidérolithes.
- Les astéroïdes de type M : cette classe un peu fourre-tout
inclut la plupart des autres astéroïdes. M signifie métallique. Ils
sont faits d'alliage fer-nickel et brillants (albédo 0.10 à
0.18).
- Il y a un certain nombre de types plus rares d'astéroïdes,
nombre qui augmente au gré des nouvelles découvertes : type E, pour
enstatite, type R, pour rouge, type V, pour Vesta (on suppose que
les astéroïdes de type V sont en fait des fragments issus
de cet astéroïde à la suite de collisions).
Il serait faux de croire que les différentes
familles d'astéroïdes décrites plus haut sont homogènes
: qu'il s'agisse des Flore, des Thémys, des géocroiseurs,
etc... dans chacune de ces familles, on retrouve un mélange d'astéroïdes
de composition différente : des C, des S, des M, etc...
L'ORIGINE DES ASTEROIDES :
Au XIX° siècle, l'hypothèse en vogue
était celle élaborée par Heinrich Wilhelm Olbers,
le découvreur de l'astéroïde Pallas, qui voulait
que les astéroïdes soient les débris de l'explosion
d'une ancienne planète.

H.W. Olbers (1758-1840)
Si la prolifération d'astéroïdes
de petites tailles est compatible avec l'hypothèse d'Olbers,
par contre, très vite, les astronomes y ont trouvé plusieurs
objections :
- La masse totale de tous les astéroïdes réunis
est inférieure à celle de de notre Lune. Les astéroïdes
ne représentent que 1/1600 de la masse de la Terre, 1/100
de la masse de la petite Mercure. Bref, pas de quoi faire une véritable
planète...
- Autre difficulté : les innombrables et diverses orbites
des astéroïdes ne semblent pas dériver d'une
explosion unique.
- De même, la grande variété dans la composition
minéralogique des astéroïdes s'accomode mal avec
l'hypothèse de leur origine à partir d'un astre unique
et homogène. Autre argument : un très grand nombre des
météorites retrouvées sur Terre proviennent incontestablement
de la ceinture des astéroïdes. Or, ces météorite
sont le plus souvent constituées de matériaux très
primitifs, datant de la naissance du ssytème solaire. On n'y
retrouve pas, en particulier, de minerais réchauffés et
compressés comme c'est typiquement le cas chez les planètes
telluriques comme la Terre, Mercure, Mars ou Vénus : il y a donc
peu de chances pour que les astéroïdes ayant donné
naissance à ces météorites soient issus de l'explosion
d'une planète comme la Terre.
Toutes ces objections ont conduit à abandonner
la théorie d'Olbers. Dans les années 1950, l'astrophysicien
V.S. Safronov a émis l'hypothèse que les astéroïdes
seraient les restes d'une planète avortée et non détruite.
La formation d'une planète se réalise alors en 2 stades
: au début, on assiste à la formation d'un grand nombre
de petits corps solides (les planétésimaux), mesurant
quelques kilomètres. Au terme d'une multitude de collisions à
petite vitesse, ces planétésimaux finissent par s'agréger
jusqu'à ce que les plus gros balayent leur orbite et la nettoye
de toutes les poussières et de tous les corps de plus petite
dimension, formant ainsi des planètes par accrétion et
attraction gravitationnelle.
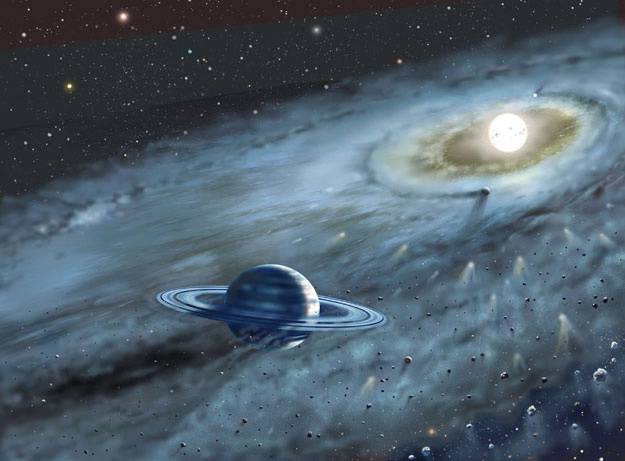
Ainsi, selon Safronov, Cérès serait l'embryon
d'une planète. Mais très vite, la croissance de Cérès
a été bloquée par celle, plus rapide, de sa voisine
Jupiter, la planète géante du système solaire.
L'influence gravitationnelle de Jupiter est alors venue perturber violemment
les orbites primitives des premiers astéroïdes, occasionnant
impacts destructeurs et collisions à grande vitesse comme celles
qui ont donné naissance aux astéroïdes de type V,
manifestement issus de l'astéroïde Vesta. Certains des astéroïdes
ainsi formés auraient subi des chocs tellement violents qu'ils
en auraient été éjectés vers la périphérie
du système solaire.

Pour Afranov, les astéroïdes correspondraient
donc à une phase intermédiaire entre la nébuleuse
protosolaire et la naissance des planètes telluriques.
|