Introduction :
Si la majeure partie des observations astronomiques se déroule
de nuit, il ne faut cependant pas oublier que l'étoile la plus
proche de nous est le Soleil, et que son observation se pratique de jour.
Il faut simplement utiliser des filtres adéquats afin de bien
se protéger les yeux : n'oubliez pas que Galilée est devenu
aveugle en observant le Soleil sans protection au travers d'une petite
lunette astronomique...
Pour votre sécurité, nous vous conseillons de reconsulter
notre dossier réalisé lors du passage de Vénus devant
le Soleil, concernant toutes les
bêtises à ne pas faire lors de vos observations solaires.
Concernant le matériel nécessaire à l'observation
du Soleil en toute sécurité, une page est également à votre
disposition

Une fois votre télescope correctement protégé,
un simple coup d'oeil sur le Soleil vous montrera la présence
de taches à sa surface, plus ou moins nombreuses selon les jours
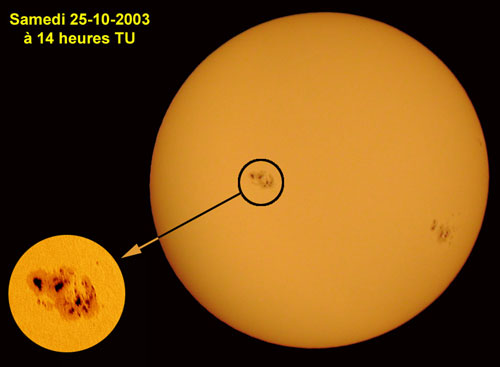
Historique de la découverte des taches
du Soleil :
L'observation des taches du Soleil ne date pas d'hier ! Il y a plus
de 2000 ans, les premiers astronomes chinois semblent avoir déjà remarqué l'existence
de taches géantes visibles à l'oeil nu.

Photo Michel
Benvenuto / Astrobiniou Club
Il a fallu attendre le début du XVIIème siècle en Occident pour que
les taches du Soleil soient "redécouvertes", en 1610, par plusieurs observateurs
au moyen d'une toute nouvelle invention : la lunette astronomique.
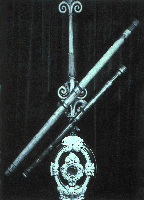
La lunette de Galilée
Les observations de Galilée sont les plus connues car c'était déjà un
personnage renommé avant ces observations : il était titulaire de la
chaire de mathématique de Padoue.
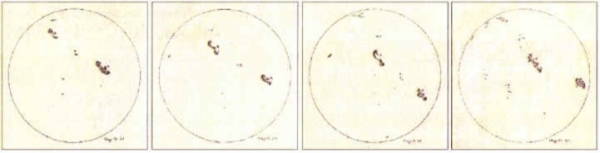
Dessins de Galilée
Mais, bien que moins connus que Galilée, les astronomes Fabricius,
Scheiner et Harriot nous ont également laissé de remarquables
dessins des taches solaires
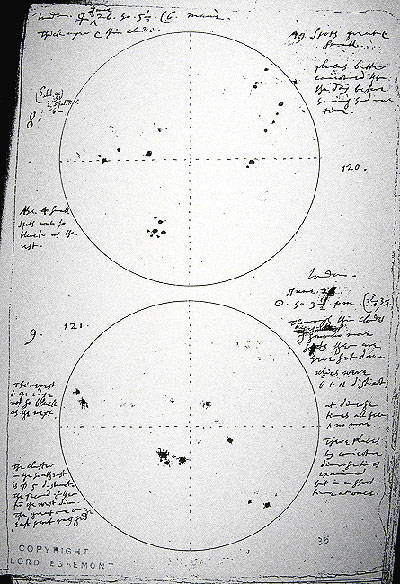
Dessin de Harriot
Jusqu'à la Renaissance, on pensait que, au-delà de l'orbite de
la Lune, tout était parfait, tandis que les objets présents sous l'orbite
de la Lune était imparfaits. Par exemple on pensait que les comètes,
imparfaites, étaient situées à l'intérieur de l'orbite lunaire, ce qui
n'est pas le cas. Observer des taches sur le Soleil était donc difficile à admettre,
et l'idée qu'il s'agirait simplement de petits nuages ou bien de petits
corps planétaires a alors été proposée. En particulier, Scheiner
pensait avoir découvert une nouvelle planète, située
très près du Soleil, à l'intérieur de l'orbite
de Mercure. Mais devant les changements permanents de formes des taches,
Galilée a montré que les taches solaires devaient être situées soit à la
surface du Soleil, soit si près qu'il était impossible de mesurer leur
altitude. Ces observations ont donc bouleversé beaucoup de croyances
anciennes !
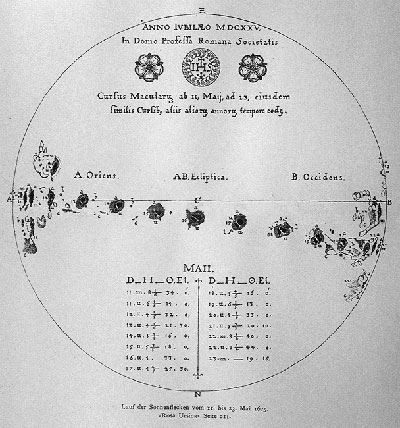
Dessin de Scheiner
Puis les observations se sont systématisées et, à partir
de 1749, un programme d'observations quotidiennes a commencé à l'observatoire
de Zürich. Depuis, le Soleil est régulièrement étudié à la
loupe : observatoires terrestres (Thémis au Iles Canaries, Pic du Midi,
Paris-Meudon) et spatiaux (satellite Soho).

Les observatoires de Meudon, Thémis et Soho
De quoi sont faites les taches solaires ?
Grâce à ces nombreuses observations, nous savons aujourd'hui
que les taches solaires sont en fait des zones de la surface du Soleil
plus sombres car plus froides (3500° contre 5500° pour le reste de la
surface du Soleil). Les taches les plus importantes comportent deux zones
bien distinctes :
- une zone centrale très sombre, appelée "ombre"
- l'ombre est entourée d'une "pénombre" plus claire,
de structure filamenteuse.
Les télescopes professionnels montrent bien ces structures, qui correspondent à des
flux de matière gazeuses brûlante circulant entre le centre de la tache
et le reste de la surface du Soleil
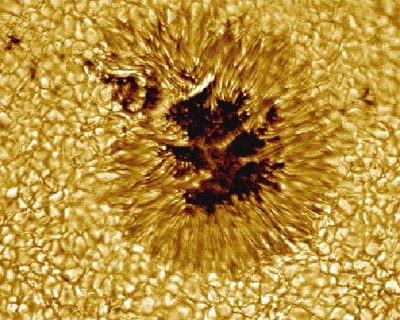
Photo Vacuum
Tower Telescope - Académie Royale des Sciences de Suède Certaines taches solaires atteignent des dimensions imposantes :
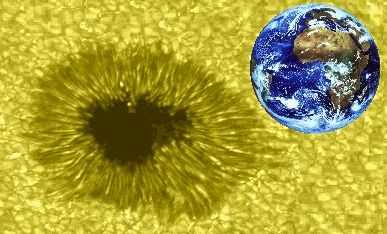
Les taches sont fréquement entourées de zones d'hyperactivité du Soleil,
qui ont un aspect plus brillant que le reste de la surface de ce dernier.
Ces zones brillantes sont appelées "facules".
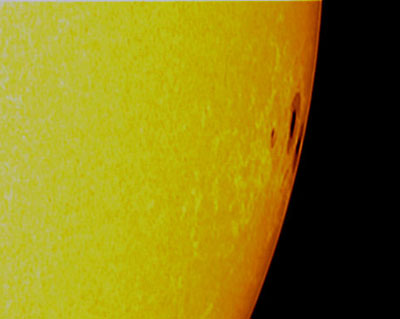
Photos Ph Ledoux / ASCT-astronomie
L'observation régulière des taches
du Soleil a permis de mettre en évidence plusieurs phénomènes
très intéressants, que vous pourrez facilement constater
vous-même au moyen de votre télescope :
1. Le Soleil tourne sur lui-même, en un peu plus de 27 jours,
entraînant avec lui les taches qui parsèment sa surface
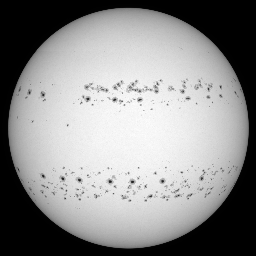
2. Les taches évoluent sans cesse au fil des jours, apparaissant,
disparaissant, se déformant, fusionnant, se fragmentant, leur
durée de vie étant de quelques semaines. Les deux images ci-dessous montrent
bien l'évolution d'un groupe de taches en l'espace de 24 heures.
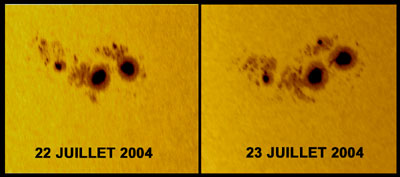
3. au-delà des variations du nombre de
tache d'une journée à l'autre, l'astronome allemand Heinrich
Schwabe (un amateur, pharmacien de son état !) est parvenu à identifier
en 1840, dans l'indifférence générale, un grand
cycle d'environ 11 ans
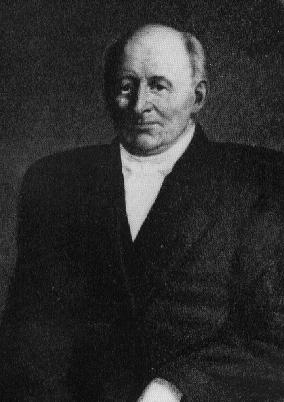
Heinrich Schwabe
Schwabe a découvert que tous les 11 ans, on enregistre un pic
maximal dans le nombre de taches solaires relevées durant le mois,
suivi d'une baisse lente et régulière du nombre mensuel
de taches.
Les taches et le champ magnétique
du Soleil
Les astronomes pensent que ces variations vont de pair
avec le champ magnétique du Soleil : les taches sont en effet
souvent groupées par deux, et son le lieu d'intenses champs magnétiques,
l'une des taches jouant le rôle du pôle + et l'autre le rôle
de pôle -. Les astronomes se sont rendus compte que c'est au niveau
des taches solaires que les lignes du champ magnétique solaire
jaillissent et plongent sous la surface de notre étoile.
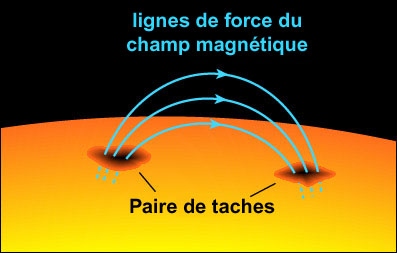
Tous les 11 ans, il y a inversion entre les pôles
+ et - des taches. Cette inversion est la conséquence évidente de l'inversion
du dipôle apparent du champ magnétique solaire global dont les lignes
de forces émergentes au niveau des taches de la photosphère. La raison
de cette inversion globale du champ magnétique solaire et sa relative
régularité sont encore mal comprises mais elles expliquent sans doute
ce fameux cycle de 11 ans que subissent les taches solaires.
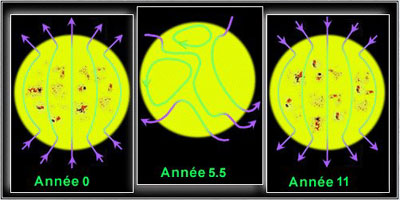
Le rôle de ce cycle de 11 ans dans les variations
du climat terrestre est encore l'objet de controverses. Cependant, un
phénomène extrêmement curieux s'est produit entre
1645 et 1715 : pendant 70 ans, pratiquement aucune tache n'a pu être
observée à la surface du Soleil.
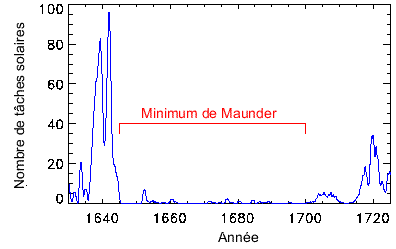
Cette période, appelée "minimum de Maunder" du
nom de l'astronome anglais qui l'a étudiée, a coïncidé avec
une période anormale de grands froids et d'hivers terriblement
rigoureux : la Tamise et la Seine étaient prises dans les glaces
au point que l'on pouvait y patiner ! Cette période de notre histoire,
appelée "le Petit Age Glaciaire", a eu des conséquences
dramatiques sur l'agriculture, entraînant des récoltes catastrophiques
et des famines dans toute l'Europe. Le dur contraste entre les souffrances
du peuple et les fêtes fastueuses de Louis XIV, puis de ses successeurs,
n'est peut-être pas étranger à l'impopularité grandissante
qu'a alors connu la monarchie en France, impopularité qui devait
finir par déboucher sur la Révolution de 1789...

Tableau de Bruegel
L'étude systématique des taches solaires est facilement
accessible aux astronomes amateurs désireux d'apporter leur petite
pierre à l'étude de notre étoile. Un peu d'assiduité et
de minutie suffisent pour réussir ce type d'études : mesure
de la position des taches et de leur taille, analyse de leur morphologie
etc... C'est ce que vous allez découvrir dans la page
suivante.
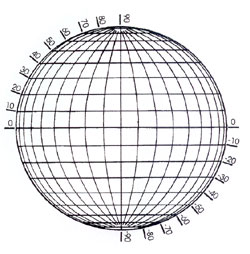
|