Les techniques :
Si l'observation directe à l'oculaire d'un télescope,
muni d'un filtre spécial, permet d'admirer la subtile dentelle
des jeux d'ombre au sein des taches, voire de les dessiner, par contre
les astronomes préfèrent employer la technique de la projection
ou bien la photographie pour réussir leurs programmes de surveillance
systématique des taches du Soleil
La projection :
Cette technique consiste à projeter l'image du Soleil sur une
feuille de papier placée en arrière de l'oculaire du télescope
comme le montre la photo ci-dessous :

Projection de l'image du Soleil sur une feuille de papier
Pour éviter les lumières parasites, un cache placé au
niveau de l'oculaire permet de plonger l'écran dans l'ombre. Pour observer
confortablement le Soleil, l'image est en général projetée
sur un écran qui sert de support à la feuille de papier.
Un gabarit en forme de cercle est tracé à même l'écran
et on y superpose ensuite une feuille de papier calque. Les feuilles
de papier calque successives permettent ainsi, par simple superposition,
de suivre très facilement le déplacement des taches au
fil de vos observations quotidiennes. Le gabarit employé par les
astronomes consiste en un cercle standardisé de 114 mm ou de 139
mm. Avec un cercle de 114 mm, une tache de 1 mm au milieu du disque du
Soleil représente 12 000 km; avec un cercle de 139 mm, 1 mm représente
10 000 km
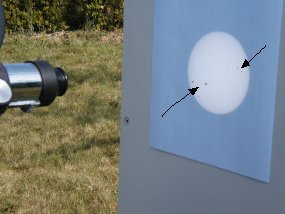
Première difficulté : réussir
la mise au point. Pour y parvenir, il suffit de veiller à ce que
le bord du Soleil soit bien net, ainsi que les taches... s'il y en a !
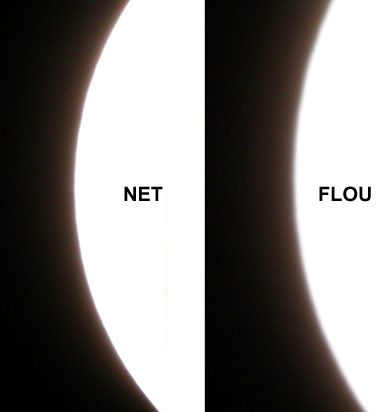
Deuxième difficulté : l'orientation
de l'écran
En effet, selon le montage optique choisi, l'orientation
de l'image du Soleil n'est pas identique.
| Le Soleil vu à l'oeil nu |
|
| Le Soleil vu dans l'oculaire d'un télescope |
|
| Le Soleil vu sur l'écran de projection |
|
| Le Soleil vu par transparence pour un observateur
placé derrière
le papier calque |
|
Autre problème d'orientation : au fil de la journée,
la Terre tourne sous vos pieds, modifiant petit à petit l'angle
sous lequel vous voyez le Soleil. Les taches de ce dernier semblent
alors subir une rotation apparente comme vous le montre le schéma
ci-dessous.
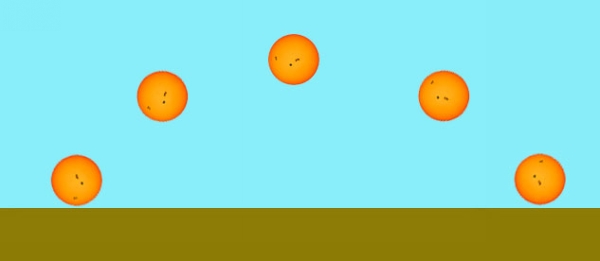
Il est donc primordial de bien repérer la position de l'Est et
de l'Ouest sur l'écran de projection. En cas de présence
de taches sur le Soleil, placez l'image du Soleil sur une feuille de
papier calque positionnée sur le cercle tracé sur l'écran
de projection. Au fil des minutes, vous aurez l'impression que le Soleil
bouge mais en fait c'est la Terre qui tourne sur elle même et qui fait
sortir le Soleil du champ de votre feuille. Marquez au crayon la position
des taches toutes les minutes environ. Comme le Soleil semble aller d'Est
en Ouest, le déplacement de la tache vous donne la direction Est-Ouest.
La perpendiculaire à cette ligne Est-Ouest vous donnera le sens
Nord-Sud.
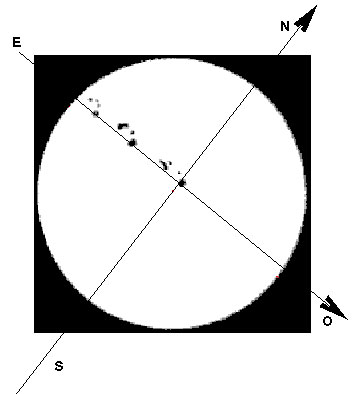 |
Une autre méthode, plus précise, consiste à couper
le moteur du télescope et à laisser l'image du Soleil défiler
après avoir tracé une tangente au cercle tracé sur
votre papier calque, parallèle à l'un des axes : le mouvement apparent
du Soleil vous donnera le sens Est-Ouest. Il vous suffit alors d'orienter
la tangente dans le même sens que le déplacement du Soleil.
La détermination de l'orientation Nord-Sud est encore plus aisée : si
votre télescope a été correctement mis en station
(par exemple sur l'étoile polaire durant la nuit précédant
votre observation du Soleil), il suffit tout simplement de le basculer
en déclinaison, puis vous remettrez en route l'entraînement motorisé avant
de recentrer l'image du disque solaire sur le cercle de l'écran.
Avec un appareil photo :
On peut également photographier directement le disque solaire
au travers du télescope. Il faut disposer d'un boîtier qui permette
de faire 2 poses sur la même image. On commence alors par orienter "gross
modo" le boîtier afin que le disque solaire se déplace, une fois
coupé le moteur de la monture du télescope, à peu près
parallèlement au grand côté du cadre du viseur de l'appareil
photo. La direction Nord-Sud géographique est alors la perpendiculaire à la
grande longueur de la fenêtre du négatif photo.
Pour affiner cette orientation, on prend ensuite successivement deux
photos, à environ 90 secondes d'intervalle, sur le même cliché : ainsi,
le second disque se superpose partiellement au premier et la sécante
qui joint les deux points d'intersection correspond à la direction Nord/Sud
géographique.
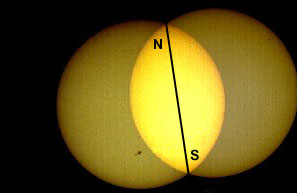
Ces méthodes demandent essentiellement du soin et de la précision et,
surtout en photo, il faut bien veiller à ne pas modifier la position
du boîtier quand on prend les photos du Soleil taché (utilisez un déclencheur
souple pour éviter tout geste intempestif).
Repérez la position des taches :
Une première méthode consiste à projeter l'image
du Soleil directement sur un gabarit avec réseau de coordonnées
héliographiques comportant les parallèles et les méridiens correspondant, équivalant à nos
latitudes et longitudes terrestres. Pour ce faire, l'épatant petit logiciel
Astrothèque 2000 propose des petits gabarits très simples à utiliser
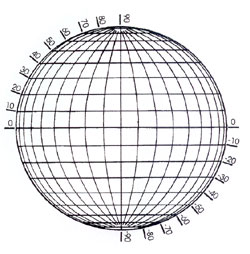
Mesurez la taille des taches
Vos systèmes de coordonnées vous permettront également
de mesurer précisément la taille des taches et des groupes
de taches qui agitent la surface de notre étoile. Vous pouvez également
estimer cette taille au moyen du gabarit simplifié que nous vous
fournissons ci-dessous, tiré du remarquable livre de Pierre Bourge et
Jean Lacroux, "A l'affût des étoiles - Manuel pratique de l'astronome
amateur" édité par Dunod. La règlette graduée de ce petit
gabarit intègre le fait que le Soleil est une sphère et
le fait que, sur les bords du Soleil, les taches sont vues selon une
perspective en fuite.
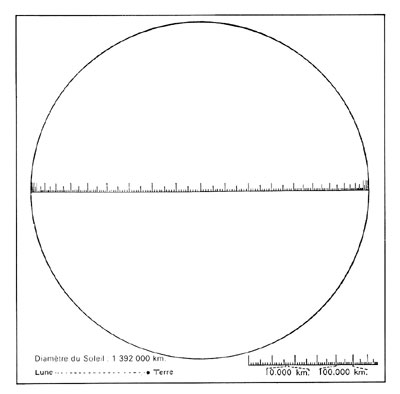
Réglez la distance entre votre feuille de papier et l'oculaire de votre
télescope afin que l'image du Soleil se superpose exactement à votre
gabarit. Vous n'avez plus ensuite qu'à faire tourner celui-ci afin que
les taches solaires observées se retrouvent sur la règle centrale du
gabarit : vous pourrez estimer ainsi très facilement la taille
des taches du Soleil.
Décortiquez la forme des taches :
Les taches peuvent prendre des formes plus ou moins complexes, qui font
l'objet de classification. Celle de l'astronome suisse Max Waldmeier
(1912-2000), assez ancienne, reste facile à manier pour un amateur
débutant.
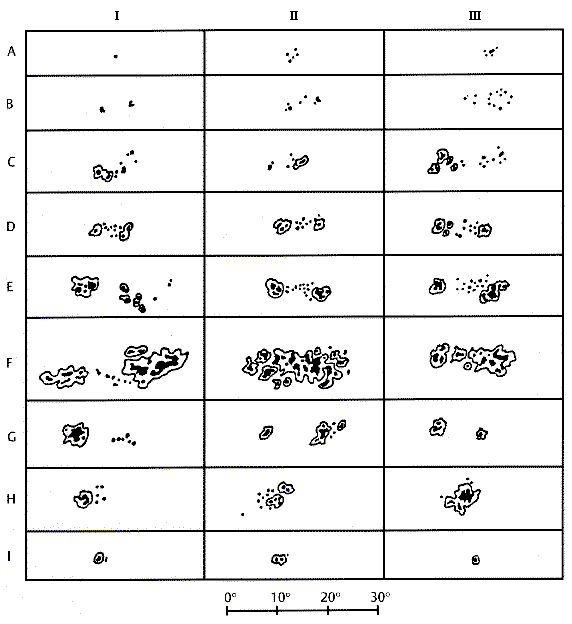
La classification de Waldmeier
- A : petite tache isolée ou groupe de taches sans pénombre et sans
structure bipolaire
- B : groupe de petites taches bipolaires sans pénombre
- C : groupe bipolaire avec une zone de pénombre entourant la tache
principale
- D : groupe bipolaire constitué d'au moins deux taches principales
entourées de pénombre dont la plus petite montre une simple structure
; la longueur du groupe est inférieure à 10 degrés
- E : grand groupe bipolaire comprenant des petites et des grandes
taches. Les deux taches principales entourées de pénombre présentent
une structure complexe avec plusieurs petites taches entre elles et
la longueur du groupe est d'au moins 10 degrés
- F : très grand groupe bipolaire d'au moins 15 degrés constitué de
nombreuses taches entourées de pénombre
- G : grand groupe bipolaire sans présence de petites taches entre
les deux principales d'une longueur d'au moins 10 degrés
- H : grande tache unipolaire entourée de pénombre avec de petites
taches isolées, d'un diamètre supérieur à 2,5 degrés
- I : petite tache unipolaire avec pénombre, d'un diamètre inférieur à 2,5
degrés
- J : groupe de taches indéfinissables par temps très brumeux ou situé très
près du bord du disque solaire (ne figurant pas dans le tableau).
Comptez le nombre de taches :
Le nombre de taches constellant la surface du Soleil est un paramètre
important pour les astronomes, qui s'en servent pour évaluer l'intensité de
l'activité du Soleil, grâce à l'ingénieuse
méthode mise au point au XIX° siècle par un astronome
suisse de l'observatoire de Zürich, Rudolf Wolf. Ce dernier est
l'un des rares astronomes professionnels à avoir été intéressé par
les travaux de Schwabe sur les cycles
solaires : c'est entreprenant des recherches dans les archives de ce
dernier qu'il est parvenu à mettre au point sa "formule magique" pour
calculer l'index d'activité du Soleil.
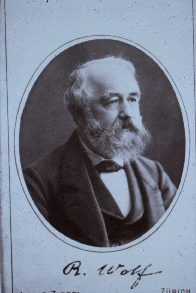
Pour calculer le nombre de Wolf, commencez par compter le nombre de
taches, que vous appelerez "t" puis comptez le nombre de groupes de taches,
que vous appellerez "g". Essayez-vous à ce petit exercice au moyen
de la photo ci-dessous :

Si vous avez les yeux en face des trous, vous devriez réussir à dénombrer
15 taches réparties en 2 groupes et 1 tache isolée. Il
vous suffit ensuite d'appliquer la formule suivante : W = k (10 g + t)
où : "W" est le nombre de Wolf, "g" le nombre de groupes de taches, "t" le
nombre de taches et "k" un coefficient correcteur dépendant de votre
type de télescope et de votre expérience d'observateur. Et hop, le tour
est joué...enfin... en principe...
Car l'estimation du nombre de Wolf n'est pas toujours aussi facile,
notamment lorsqu'il y a plusieurs ombres dans une même pénombre ou bien
lorsque un ou plusieurs groupes de taches sont situés dans une zone étendue
puisque ce nombre de taches est multiplié par le chiffre 10. Une tache
isolée constitue, à elle seule, un groupe mais en cas d'hésitation il
faut considérer la distance angulaire séparant deux groupes de taches
: si la distance est supérieure à 10 degrés, on est bien en présence
de deux groupes distincts et dans le cas contraire, on a affaire à un
seul groupe.
Le coefficient pondérateur, noté "k", a été établi afin de mieux comparer
les relevés des différents observateurs et, éventuellement seulement,
d'y apporter une correction. Ce coefficient tient compte des différents
paramètres pouvant influencer le décompte des taches solaires
:
- le diamètre de votre télescope
- le grossissement employé
- l'acuité visuelle de l'observateur
- l'expérience de l'observateur
- la transparence du ciel
Par exemple, il est évident que la détection d'une toute petite
tache isolée avec une petite lunette de 60 mm de diamètre
est très difficile, voire impossible. Le coefficient "k" tient
compte de toutes ces incertitudes. Wolf, qui observait le Soleil avec
une lunette de 75 mm de diamètre, estimait que dans ces conditions, "k" était égal à 1.
Dans l'exemple précédent, si k = 1 et si vous comptez la
tache isolée comme un groupe à part entière, vous
aurez donc le nombre de Wolf suivant :
W = k (10 g + t) = 1 (10 x 3 + 16) = 46
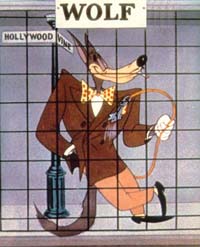
Pour estimer la valeur de k qui vous est propre, comparez systématiquement
pendant plusieurs semaines le nombre de Wolf que vous avez calculé et
celui donné par un site Internet comme spaceweather.com :
vous pourrez alors facilement découvrir le décalage moyen
qui existe entre vos mesures et le nombre de Wolf réel. Vous pourrez
ensuite utiliser systématiquement le coefficient "k" ainsi
calculé lors de toutes vos observations ultérieures.
C'est ainsi qu'à partir des observations réalisées par des astronomes
amateurs et professionnels du monde entier, et envoyées au "Sunspot
Index Data Center" (S.I.D.C) à l'observatoire Royal de Bruxelles,
le nombre de Wolf est établi mois après mois. Ci-dessous, à titre
d'exemple, la moyenne mensuelle du nombre de Wolf, calculé durant les
12 mois de l'année 2000, année de très forte activité solaire :
|
jan |
fev |
mars |
avril |
mai |
juin |
juillet |
août |
sept |
oct |
nov |
déc |
|
108.9 |
125.5 |
161.9 |
144.2 |
120.1 |
136.9 |
173.8 |
135.8 |
109.6 |
103.7 |
114.8 |
107.8 |
Repérez la rotation du Soleil :
L'étude minutieuse de la position des taches sur
le Soleil a également montré que la rotation du Soleil
n'était pas partout identique : le Soleil n'est pas une masse
solide mais une boule gazeuse et sa vitesse de rotation est plus forte à l'équateur
qu'aux tropiques ou aux pôles. Cette rotation différentielle
est assez facile à mettre en évidence grâce au
déplacement des taches solaires au fil des jours
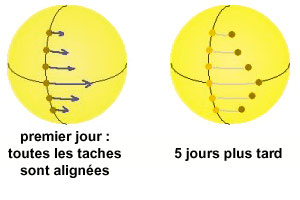
L'observation quotidienne du déplacement des taches
permet de calculer ainsi facilement les différentes vitesses
de rotation du Soleil sur lui-même en fonction de la latitude
: à l'équateur, les taches font le tour de l'astre du
jour en 26 jours environ. Il faut 35 jours à celles situées à proximité des
pôles pour effectuer un tour complet
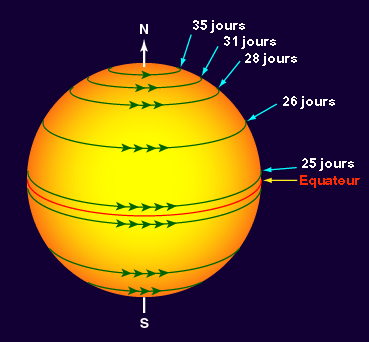
En cliquant sur l'image ci-dessus, vous pourrez imprimer
le gabarit fourni par le logiciel
Astrothèque 2000, qui vous permettra de calculer vous-même
la rotation du Soleil.
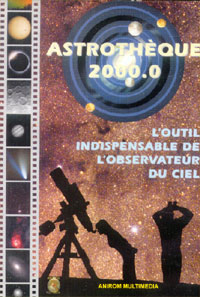
Une fois vos premières observations bien rodées,
vous souhaiterz peut-être aller plus loin dans vos travaux :
si tel est le cas, alors la page suivante est
faite pour vous !
Et n'hésitez pas à consulter les excellentes
pages pédagogiques réalisées par Nadège
Meunier sur le site de l'observatoire
du Soleil Paris/Meudon/Pïc du Midi. |