|
100 milliards d'étoiles : voilà de quoi est composée
notre galaxie, la Voie Lactée. Et on y trouve de tout ! Des
étoiles rouges, des blanches, des brunes, des jaunes, des
bleues ... Des géantes, des supergéantes et des naines
... Et perdue au milieu de ce fantastique zoo, là, au coeur
de l'un des bras de notre galaxie, une toute petite étoile
jaune toute bête : notre Soleil ...
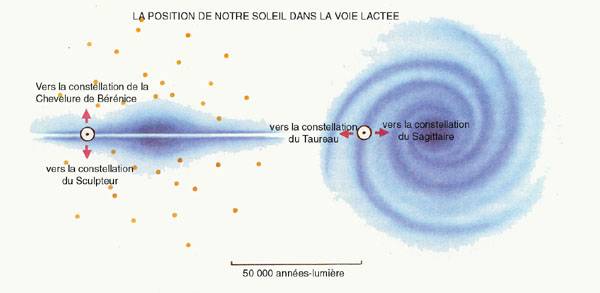
Le Soleil, cette étoile banale, est en réalité
une bombe thermonucléaire de 1 392 000 km de diamètre
qui nous éclaire, nous réchauffe et sans laquelle
la vie sur Terre serait absolument impossible ...
Mais le Soleil n'est pas le père tranquille que l'on pourrait
croire : cette grosse boule de gaz bouillonne en tous sens sous
l'effet de l'intense chaleur qui y règne (6000° à
la surface du Soleil, 15 à 20 millions de degrés au
coeur du Soleil).
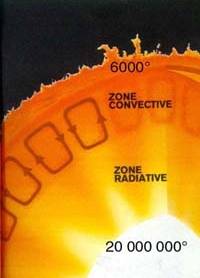
L'intense chaleur qui y règne agite la surface de notre
Soleil de plusieurs phénomènes, plus ou moins violents
:
1. Les taches solaires :
Ces cyclones magnétiques sont des zones plus froides que
le reste de la surface du Soleil (environ 4500° contre 6000°
pour le reste de la surface du Soleil).

Photographie prise au foyer d'un télescope Meade LX 200
de 254 mm de diamètre, à F/D 6.3 avec un film 100
ISO.
Cliché réalisé le 20-09-2000 par Ph. Ledoux
/ X. Lefebvre / ASCT
Les taches sont composées de 2 parties : une zone centrale,
appelée "ombre", entourée d'une zone moins noire,
d'aspect filamenteux, appelée "pénombre". La surface
du Soleil, également appelée "photosphère"
a une structure en grains de riz, bien visible sur l'image ci-dessous.
Ces grains correspondent aux bouillons qui agitent la photosphère,
chacun d'entre eux étant grand comme la France.
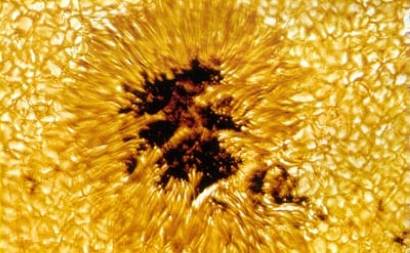
une tache solaire vue par le satellite SOHO
Les taches solaires apparaissent, disparaissent, se fragmentent,
fusionnent au fil des jours, tissant à la surface du
Soleil une dentelle sans cesse renouvelée. Elles sont
également emportées par la
rotation du Soleil sur lui-même comme en témoigne
l'animation que nous avons
réalisée à partir des images du satellite
SOHO. En outre, les taches sont animées d'un mouvement
propre qui les fait dériver à la surface du
Soleil : les taches naissent pour l'essentiel dans une zone
appelée la "zone royale", située à
40° de latitude de part et d'autre de l'équateur
du Soleil. Leur mouvement propre tend à les faire dériver
de jour en jour en direction de l'équateur.
2. Les protubérances et les éruptions solaires :
La surface du Soleil crache également en direction de son
atmosphère de grandes flammes, appelées "protubérances".
Ce sont en réalité de gigantesques jets de matière
brûlante et électrisée.

le petit rond en bas, à gauche vous permet de comparer
les tailles de la Terre et de cette splendide protubérance
Le Soleil peut aussi connaître de terribles colères
: les éruptions solaires. A l'occasion de brutales ruptures
du champ magnétique solaire, d'énormes jets de plasma
brûlant parviennent à s'arracher à l'attraction
gravitationnelle du Soleil et foncent dans l'espace pour atteindre
parfois la Terre où elles donnent naissance à des
aurores boréales.
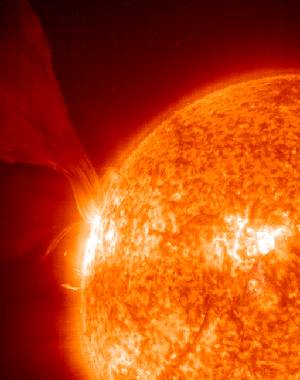
Photo SOHO
Toute cette activité bouillonnante de notre Soleil connait
des hauts et des bas : les astronomes ont en particulier repéré
l'existence d'un cycle de 11 ans appelé "cycle undécennal"
: tous les 11 ans, l'activité du Soleil connait ainsi un
pic maximal d'activité. Le découvreur de ce cycle
est l'astronome allemand Heinrich Schwabe, en 1840 (dans l'indifférence
générale ...). Nous en sommes aujourd'hui au 23ème
cycle solaire
Ce cycle semble dû au champ magnétique
solaire, car notre étoile se comporte comme un gigantesque
aimant, avec un pôle positif et un pôle négatif.
Si les lignes de force du champ magnétique ne sont pas visibles
à l'oeil, par contre, les trajectoires des protubérances
qui s'écoulent le long de certaines de ces lignes de force
permet de visualiser leurs boucles à la surface du Soleil.
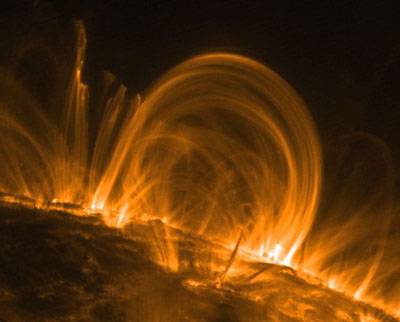
Tous les 11 ans, pour une raison encore mystérieuse, le
champ magnétique du Soleil s'inverse, le pôle positif
du Soleil devient le pôle négatif et vice-versa.
Lorsque le Soleil approche du moment de ce changement de polarité,
l'activité est minimale : les protubérances sont plutôt
rachitiques et il est fréquent de ne pas apercevoir une seule
tache à la surface du Soleil pendant plusieurs jours, voire
plusieurs semaines.
Par contre, lors du pic maximal d'activité du Soleil,
les protubérances sont légion, on assiste à
de fréquentes éruptions solaires, responsables
d'aurores boréales sur Terre, et les taches se multiplient
à la surface du Soleil. Si vous possédez un
télescope, vous pouvez d'ailleurs mesurer
vous-même les taches solaires et calculer facilement,
comme le font les astronomes, l'index de l'activité
solaire, grâce au Nombre de Wolf.

Le dernier minimum solaire, c'est à dire le dernier changement
de polarité du Soleil, s'est produit en Avril 1996. Le
dernier maximum d'activité du Soleil a eu lieu à la
fin de l'année 2000 : forte augmentation de la moyenne mensuelle
du nombre de taches solaires, taches géantes observables
à l'oeil nu, avec des lunettes d'éclipse, une tache
géante entre le 18 et le 23 septembre 2000 : il s'agissait
de la plus grosse tache observée depuis 11 ans.


la tache géante de septembre 2000 vue par la NASA : 144
000 km de long, soit 12 fois le diamètre de la Terre !
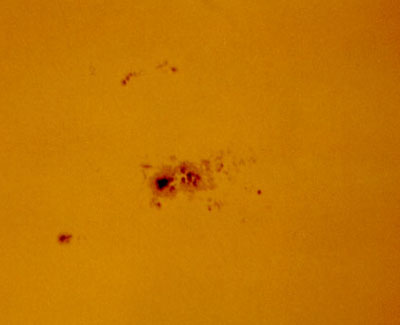
Pphotographie prise au foyer d'un télescope Meade LX 200
de 254 mm de diamètre,
à F/D 6.3 avec un film 100 ISO, après projection de
l'image avec une Barlow x2.
Cliché réalisé le 20-09-2000 par Ph. Ledoux
/ X. Lefebvre / ASCT
De même, de magnifiques protubérances apparaissent
régulièrement dans la basse atmosphère du Soleil,
dont l'une, particulièrement spectaculaire a pu être
photographiée le 20 juillet 2000 par les astronomes en herbe
de Toussaint lors de leur stage d'été à l'observatoire
de Briançon.

photographie prise au foyer du coronographe de 110 mm de diamètre
de l'observatoire de Briançon avec un film 100 ISO.
Cliché réalisé le 20-07-2000 par Ch. Ferruel
/ Ph. Ledoux / ASCT
Enfin, plusieurs éruptions solaires ont été
suffisamment puissantes pour déclencher des aurores boréales
visibles depuis la France, ainsi que ce fut le cas le 6 Avril 2000
et le 28 Avril 2001. N'hésitez pas à aller admirer
les photographies de la dernière aurore
boréale vue à Fécamp et en Normandie en
Avril dernier.

|