Note : Cette page est rédigée de telle sorte qu'elle
soit compréhensible par chacun.Si vous souhaitez des détails
plus approfondis, cliquez sur les liens soulignés en orange.
Un spectacle grandiose :
C'est à un spectacle grandiose que Dame Nature a convié
les fécampois le Jeudi 6 Avril 2000 et le Mercredi 11 Avril
2001 : une aurore boréale, spectacle rarissime.
Les dernières aurores boréales visibles en Normandie
remontant, en l'état actuel de nos informations, au 4 août
1972, au 19 décembre 1980 et au 13 mars 1989 ! Par chance,
le Jeudi 6 Avril 2000, un magnifique rapprochement de planètes
avait lieu : la Lune, Mars, Jupiter et Saturne étaient attroupées
dans la même région du ciel. Beaucoup d'astronomes
amateurs étaient donc de sortie ce soir-là. Ce
qu'ils n'avaient pas prévu, c'était l'apparition soudaine
d'une aurore boréale, comme en témoignent le
récit et les photos qu'ont fait les amateurs du Club
d'astronomie de Toussaint et du Groupe d'astronomie populaire de
Sotteville.
Par contre, le 11 Avril 2001, un avis d'aurore boréale avait
été émis sur Internet, suite à une gigantesque
éruption à la surface du Soleil : nous étions
tous sur le pied de guerre !!! La beauté des photos était
donc au rendez-vous, comme en témoigne ce cliché réalisé
par Denis Joye depuis la région parisienne.

L'ami Denis ne s'en tient d'ailleurs pas là puisqu'il
vous propose une animation
de cette aurore boréale.
Le mystère des aurores polaires :
C'est Galilée, au début du XVIIe siècle, qui
aurait inventé le terme "aurore boréale" pour décrire
ce phénomène. Pour d'autres auteurs, c'est le
philosophe français Pierre Gassendi qui aurait pour la première
fois employé ce terme en 1621. La polémique fait rage
...

Mais il semble que ce soit un Grec, Anaximène, qui ait décrit
pour la première fois, en 593 avant J.-C., des "nuages de
gaz enflammé" dont la description semble correspondre à
celle d'une aurore polaire. Anaximène mit au point une théorie
astucieuse qui affirmait qu'à des densités très
faibles, l'air se transforme en feu.
Cependant ni Galilée ni Anaximène ni Gassendi n'avaient
trouvé d'explication bien satisfaisante à ces aurores
polaires. Les shamans inuit du centre du Canada, de leur côté,
prétendaient effectuer des voyages spirituels au sein des
aurores pour y puiser des conseils sur le traitement des malades.
Les indiens du Wisconsin, voyaient dans les aurores les fantômes
des ennemis décédés qui, avides de vengeance,
essaient de se réveiller... Plus cools, les indiens Menominee,
croyaient, eux, que des géants amicaux du Nord tenaient en
leur main d'immenses torches pour les éclairer lors de leur
pêche à la lance.

Plus près de nous, au cours du XIXe siècle, 27 théories
scientifiques (excusez du peu !) ont tenté d'expliquer, sans
beaucoup plus de succès, le phénomène des aurores.
Jusqu'au début du XX° siècle, on a cru que les
aurores étaient causées par la réflexion de
la lumière du Soleil sur les icebergs et les glaces qui recouvrent
les 2 pôles terrestres.
Plus observateurs, certains astronomes avaient cependant remarqué
que les périodes où les aurores polaires sont les
plus intenses sont également les périodes où
l'on distingue le plus de taches à la surface du Soleil.
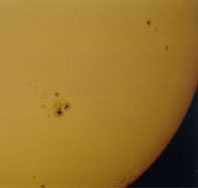
En 1741, l'astronome suédois Anders Celsius s'était
aperçu que les rayures lumineuses des aurores semblaient
suivre les lignes de force du champ magnétique terrestre.
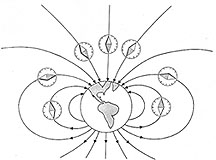
Mais c'est à un Norvégien, Olaf Birkeland, que revient
le mérite d'avoir découvert au début du siècle
la relation qui existe entre les aurores boréales et les
courants électriques créés dans notre atmosphère
par le vent solaire, découverte qui a depuis été
amplement confirmée par les satellites qui observent la fréquence
de l'activité solaire et le nombre de taches sur le Soleil.
Une aurore polaire, comment çà marche ?
C'est effectivement le Soleil qui détient la clé
de l'énigme : sa surface émet dans l'espace une "soupe
électrisée" formée de protons et d'électrons,
appelée plasma.
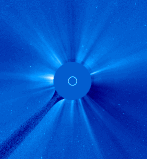
Image fournie par le satellite SOHO (NASA/ESA)
Ce flux de particules constitue le vent
solaire qui balaie tout le système solaire comme le feraient
les jets tournants d'un arrosage de jardin.
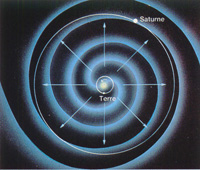
Lors de l'aurore boréale du 6 Avril 2000, le satellite
ACE a enregistré dans la banlieue terrestre un vent solaire
qui s'est mis brutalement à souffler en tempête, à
600 km/seconde.
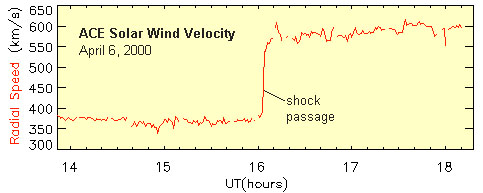
Ce sont les jets de plasma éjectés par le Soleil
qui viennent exciter les molécules d'oxygène, d'azote
et d'ozone qui composent l'atmosphère de notre Terre, créant
ainsi ces magnifiques jeux de lumière que sont les aurores
polaires.
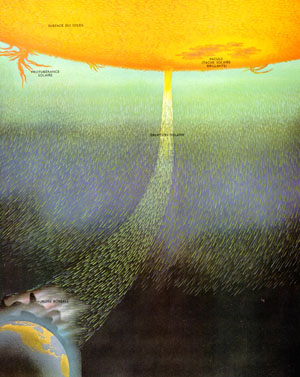
Mais la Terre se protège des vents solaires grâce
à son bouclier magnétique, également appelée
magnétosphère.
Heureusement, car si toutes les particules ionisées du Soleil
arrivaient sur Terre, aucune cellule vivante ne résisterait
bien longtemps à un tel traitement et la vie serait impossible
...
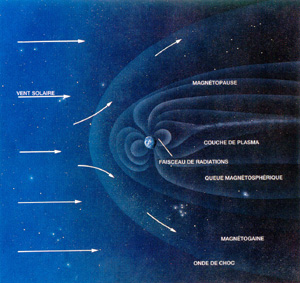
Cependant, notre bouclier magnétique a 2 points de faiblesse
: les pôles. C'est en effet au niveau de chacun des 2
pôles que les lignes de force de notre champ magnétique
plongent vers le coeur de la Terre, formant ainsi 2 grands "entonnoirs
magnétiques" par lesquels le plasma solaire pénètre
dans la haute atmosphère du globe terrestre, en donnant naissance
aux aurores polaires : lors de leur chute vertigineuse en direction
des pôles, les particules du plasma solaire accélèrent
de plus en plus. C'est cette accélération qui leur
donne l'énergie nécessaire pour entraîner des
collisions avec l'oxygène et l'azote de notre atmosphère. Ces
collisions dégagent de la lumière : l'aurore polaire
!
Les aurores ont ainsi la forme de grands ovales centrés
sur les pôles Nord et Sud de la Terre.
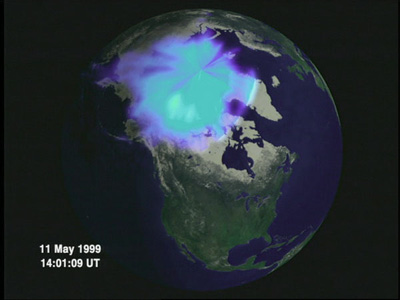
Image NASA/GSFCp
Lorsque l'activité solaire est calme, l'ovale auroral est
petit. Par contre, lors des périodes d'activité
solaire éruptive, l'ovale auroral s'étend vers des
latitudes plus basses : c'est ce qui s'est produit le 6 Avril 2000
et le 11 Avril 2001, permettant aux habitants de Fécamp d'admirer
une aurore boréale. Mais à Fécamp, c'est quand
même infiniment plus rare qu'à Fairbanks, en Alaska,
qui compte 200 aurores boréales par an !
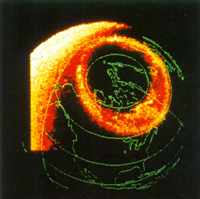
Image NASA/NOAA
On sait maintenant que les aurores boréales se produisent
bien au-dessus des nuages, dans la très haute atmosphère
de la Terre : bien qu'il puisse se produire des aurores polaires
dès l'altitude de 60 km, c'est entre 100 et 150 km environ
au-dessus du sol qu'on les retrouve en plus grand nombre, comme
en témoigne l'image suivante prise depuis la navette spatiale,
à un peu plus de 300 km d'altitude.
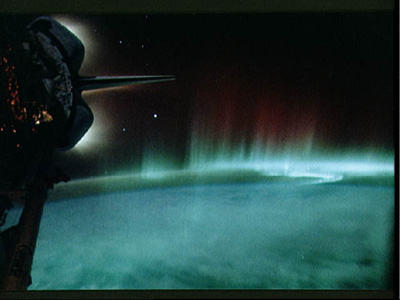
Image NASA / GSFC
La Terre n'étant pas la seule planète du système
solaire à posséder un champ magnétique, des
aurores polaires sont aussi observables sur des planètes
comme Jupiter, ou bien Saturne, comme l'a montré le télescope
spatial Hubble .

Des couleurs de rêve :
Lorsque les électrons et les protons du plasma solaire viennent
frapper les molécules des gaz de notre atmosphère,
ces dernières émettent alors de la lumière,
exactement comme le gaz contenu dans le tube cathodique de votre
télévision ou comme le gaz de nos tubes de néon.
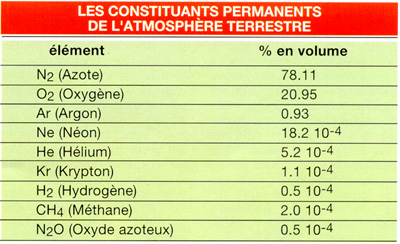
Les atome d'oxygène situés à environ 100 km
d'altitude émettent une éclatante couleur jaune-verte.

Les atomes d'oxygène situés dans les hautes couches
de l'atmosphère, au-delà de 300 km émettent
une lumière rouge foncé. Ces aurores toutes rouges
sont rares....

Copyright 2000 - Jean Jacques Hélie -
GAPS
Les molécules d'azote neutre de la basse atmosphère,
produisent une lumière rouge pâle.

Par contre, les atomes ionisés de l'azote situé dans
la haute atmosphère émettent une lumière bleue
ou violette. Ce sont ces derniers atomes qui sont également
responsables de l'aspect en vagues de beaucoup d'aurores boréales.

Ainsi, la couleur des aurores boréales peut nous renseigner
sur leur altitude. Mais attention, pour que votre oeil puisse
bien distinguer les couleurs des aurores, il faut que la nuit soit
bien noire, sans trop de réverbères ni de Pleine Lune
à proximité !
Peut-on prédire les aurores boréales ?
Non. Désolé. Hiver, été, froid,
chaleur : aucune condition météorologique n'a d'influence
sur la survenue ou la forme des aurores polaires. La
vitesse du vent solaire est extrêmement variable, de 300
à 30 000 km/s, selon qu'il nait au niveau de la surface du
Soleil, au niveau d'une tache solaire ou bien lors d'une éruption
solaire. Difficile dans ces conditions de prévoir une éventuelle
rencontre entre la Terre et ce plasma. D'autre part, le champ
magnétique terrestre varie lui aussi, ce qui rend ses
interactions avec le vent solaire encore plus délicates à
prévoir.
Alors, comment peut-on mettre de son côté le maximum
de chances de voir une aurore boréale ?
Puisqu'elles ne sont visibles que la nuit, on a plus de chance
d'en voir une durant les longues nuits d'hiver, entre 22 heures
et 3 heures du matin. En général, les aurores boréales
surgissent dans la direction du Nord. Vous aurez plus de chance
d'en apercevoir une en rase campagne, loin de tout éclairage
artificiel
L'activité du Soleil connait des hauts et des bas, selon
un cycle de 11 ans : lors des maxima d'activité, les éruptions
solaires et les jets de plasma sont beaucoup plus fréquents,
augmentant ainsi les chances de voir une aurore boréale.
Le dernier pic d'activité solaire a eu lieu à la fin
de l'année 2000 !
Un petit coup d'oeil sur internet peut vous montrer l'activité
aurorale enregistrée aujourd'hui par le satellite NOAA :
http://sec.noaa.gov/pmap/index.html.
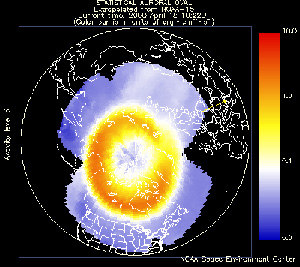
Pour interpréter les données du satellite NOAA, notez
que la légende "activity level" située sur le côté
gauche du schéma ci-dessus, correspond à l'indice
d'activité globale de l'ovale auroral. Pour mémoire,
sachez que le 6 Avril 2000, l'indice est grimpé à
10. L'échelle des couleurs permet de visualiser rapidement
l'intensité de l'activité aurorale : plus c'est bleu
et plus l'activité est faible. Plus c'est rouge et plus
il y a une forte activité de l'ovale auroral.
Vous trouverez également beaucoup d'éléments
pédagogiques très bien faits sur le site anglophone
suivant :
http://www.alaskascience.com/aurora.htm
Enfin, pour surveiller l'activité du Soleil au jour le jour,
la NASA met en ligne quotidiennement une image de notre étoile
:
http://umbra.nascom.nasa.gov/images/latest_mdi_igram.gif
A l'avenir, les satellites Cluster envoyés dans l'espace
durant l'été 2000, devraient nous permettre d'en savoir
un peu plus sur les interactions entre le vent solaire et la magnétosphère
terrestre, ouvrant ainsi la porte à des prévisions
un peu plus fiables. Affaire à suivre ...
En attendant, vous pouvez vous rincer l'oeil grâce aux photos
d'aurores boréales normandes prises par JC Dalouzy
|