|
Un grand merci à Jean-Christophe
Dalouzy, membre de la société astronomique de Rouen, pour
cet article qu'il nous a fourni et qui devrait rendre service
à tous les webcamés débutants.
A) Introduction
En cette année 2003, la planète Mars sera idéalement placée
pour l'observation mais aussi pour l'imagerie. De nombreux
détails seront observables à sa surface et pourront être immortalisés
sur une pellicule photo ou sur un capteur numérique. Dans
ce chapitre, je vais essayer de vous donner toutes les clefs
pour vous permettre de réaliser des images de Mars à l'aide
d'une webcam et aussi de vous persuader qu'il n'est pas forcément
nécessaire d'avoir un très gros matériel pour obtenir de bons
résultats.

Image Ph Ledoux
Après une rapide présentation des conditions d'observation
et d'imagerie de la planète nous allons aborder plus précisément
le sujet qui nous intéresse. Une large part sera réservée
à toute la partie acquisition d'image puis une seconde
partie sera consacrée au traitement des images obtenues.
Pour finir par un petit paragraphe sur la réalisation d'images
un peu plus exotiques mais toujours relatives à Mars et qui
pourront être tentées avec une webcam.
B) Les conditions d’observation de la planète durant le
mois d’août 2003
Ce n'est pas arrivé depuis 73 000 ans ! En effet, il faut
remonter à l'homme de Néanderthal pour trouver Mars aussi
proche de la Terre que cette année. L'événement est donc bel
et bien exceptionnel et tous les mordus de l'astro ne doivent
surtout pas le rater.
La distance séparant la Terre de la planète Mars sera, lors
de l'opposition, le 28 août 2003, d'un peu moins de 56 millions
de kilomètres. La planète atteindra alors une magnitude de
-2,8, plus brillante que Jupiter, et aura une taille de 25,1
secondes d'arc, ce qui, dans un télescope, est plus grand
que le globe de Saturne ! Le spectacle s'annonce donc grandiose.
Le seul point noir au tableau est sa déclinaison de -15° lors
de l'opposition, ce qui représente une hauteur par rapport
à l'horizon d'un peu moins de 25° pour le Nord de la France
et de 30° environ pour le Sud de la France lors du passage
de la Planète Rouge au méridien.
Les images ci-dessous représentent les différences de taille
entre plusieurs planètes. Elles ont toutes les trois été faites
avec le même matériel : un télescope Schmidt Cassegrain de
200 mm de diamètre, une lentille Barlow x2 et une webcam Vesta
Pro. Cela permet ainsi de bien apprécier la taille qu'aura
Mars lors de l'opposition.
|

|

|

|
|
Mars à l'opposition 2001
taille: 18,1
|
Mars loin de l'opposition 2001
taille : 6,6
|
Saturne à l'opposition 2002
Mars sera, cette année, plus
grand que le globe de Saturne.
|
Images JC Dalouzy
Mars est une planète très intéressante à observer car elle possède
de beaux détails à sa surface : des zones sombres, des zones plus
claires et bien sûr deux calottes polaires. Ces détails sont déjà
repérables visuellement avec un télescope de 115 mm de diamètre.
Les plus belles formations sombres sont : Syrtis Major, Utopia,
Mare Acidalium, Mare Erythraeum. Les zones claires facilement identifiables
sont les plaines Hellas, Chryse et bien sûr les deux calottes polaires.
Voici un planisphère de la planète qui pourra vous aider à reconnaître
ces formations sur vos images webcam :
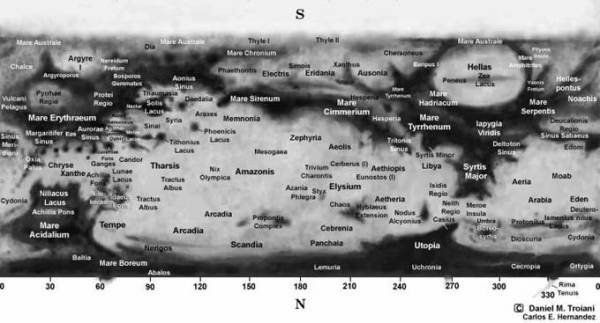
En plus de ces formations, il est possible d'observer et
donc de photographier les phénomènes météorologiques de la
planète (Tempête de sable, lever de brume matinale.). De par
leur nature imprévisible, ces phénomènes sont d’autant
plus intéressants et peuvent être un bon challenge pour l'imagerie
d'amateur.
C) L’imagerie webcam
I) Généralités
Le grand ennemi de l'amateur désirant faire de l'imagerie
planétaire c'est la turbulence de l'air. Avant que les capteurs
numériques n'apparaissent, seule la photographie argentique,
avec une pellicule classique, permettait d'obtenir des clichés
des planètes. Mais de plus en plus, pour le planétaire notamment,
les caméras numériques ont complètement supplanté le bon vieux
film photo 24x36. Leur avantage essentiel est leur sensibilité.
En photographie classique pour faire des photos des planètes
(et de Mars en particulier), il était nécessaire de faire
des poses de plusieurs secondes. Pour obtenir de bons résultats
les conditions de turbulence devaient être exceptionnelles
(l'air devait être stable durant toute la durée de la pose,
ce qui n'arrive que quelques fois par an). Mais maintenant,
grâce aux capteurs numériques, les temps de pose sont de l'ordre
du dixième, voir du centième de seconde. Ces temps de pose
extrêmement courts permettent quasiment de figer la turbulence
ou tout du moins d'obtenir des images dans les « trous
de turbulence » et donc d'avoir de meilleurs résultats
qu'en photographie argentique. Si on y rajoute la puissance
de l'ordinateur et du traitement d'image, on comprend alors
très bien pourquoi les capteurs numériques ont complètement
remplacé la pellicule traditionnelle.
Mais le gros inconvénient du numérique réside dans le prix.
Il existe de très bonnes caméras astronomiques, qu'on appelle
caméra CCD ( Charge Couple Device ), mais leur prix varie
de 1200 à plus de 15000 € ! C'est pourquoi certains amateurs
ont eu l'idée géniale de détourner les webcams de leur utilisation
première pour en faire de véritables petites caméras astronomiques
à part entière et pour un coût beaucoup plus faible !
II) Gros plan sur la webcam
A l'origine, ces petites caméras étaient prévues pour la
visioconférence sur internet. Elles possèdent un capteur CCD
ou CMOS que certains astronomes ont eu l'idée de mettre au
foyer de leurs instruments. Mais de par leur temps de pose
réduit (1/15ème de seconde pour les caméras non modifiées),
seuls les objets brillants leur sont accessibles. La Lune,
le Soleil et les planètes sont donc leur domaine de prédilection.
Toutes les webcams actuellement disponibles sur le marché
ne conviennent pas forcément à l'imagerie astronomique : il
faut impérativement qu'elles possèdent un capteur CCD et non
un capteur CMOS. Même si d'anciens modèles (comme les Qc
VC, Qc noir et blanc et Vesta Pro) peuvent
encore se trouver d'occasion sur Internet, actuellement la
seule webcam utilisable en astronomie et dont l'achat est
facile, est la Philips ToUcam Pro (son prix est de
120 € environ).
Les webcams les plus utilisées sont les Vesta Pro
et les ToUcam Pro. De plus, elles ont un capteur couleur
et permettent donc de faire de l'imagerie couleur sans avoir
recours à la méthode de la trichromie (recomposition d’une
image couleur à partir de trois images individuelles faites
au travers de trois filtres colorés, rouge, vert et bleu).
Ces webcams ont une sortie sur port USB, ce qui veut dire
que votre ordinateur devra impérativement posséder au moins
une prise USB. De plus, elles sont assez exigeantes en terme
de ressources informatiques. Il faudra donc vous doter d'un
ordinateur (si possible portable car beaucoup plus pratique
à transporter sur le terrain) assez récent, avec une vitesse
horloge d'au moins 500 MHz et un minimum de 16 Mo de Ram.
Un gros disque est fortement conseillé car les films enregistrés
par la webcam, prennent rapidement plusieurs centaines de
Mo ! 20 Go de disque dur semble donc un bon minimum. Si la
caméra en elle-même n’est pas très chère, en revanche
l’ordinateur nécessaire pour la faire fonctionner est
relativement coûteux.
III) Adaptation de la webcam sur le télescope et système grossissant
Une fois votre webcam achetée, vous constaterez qu'elle possède
un objectif qui permet de former l'image sur le capteur lors
d'une utilisation courante. Dans cet objectif, il y a un filtre
qui coupe les infra-rouges (les capteurs CCD sont assez sensibles
à l'infra-rouge) et également des lentilles. Malheureusement
celles-ci sont en plastique, et de ce fait de trop mauvaise
qualité optique pour être utilisable en astronomie. Il faut
par conséquent enlever l'objectif pour adapter la webcam sur
le télescope. C'est ce dernier qui jouera alors le rôle de
l'objectif.
|

|

|
|
La webcam et son objectif
|
La webcam, objectif dévissé
|
Dans le cas des webcams de marque Philips (ToUcam
Pro et Vesta Pro), cette opération est aisée, puisque
l'objectif est amovible. Il suffit juste de le dévisser :
un pas fileté apparaît et au fond de la caméra, le petit capteur
CCD.
La plupart des télescopes du commerce possèdent un coulant
de 31,75. Il faut donc trouver un système permettant d'adapter
la webcam sur du 31,75. Pour cela deux solutions : coller
une boite de pellicule photo (dont certaines ont le diamètre
tant recherché, notamment celles de marque Fujicolor) sur
le capot de la caméra, mais dans ce cas, il faut faire très
attention que cet adaptateur soit rigoureusement perpendiculaire
au capteur. Sinon, lors de la prise de vue, un côté de l'image
sera net et pas l'autre. La seconde solution est d'utiliser
le pas fileté et de faire usiner un adaptateur en métal (aluminium
par exemple) possédant d'un côté un filetage correspondant
au filetage de la webcam et de l'autre le coulant 31,75.

Philips Vesta Pro avec son adaptateur au coulant 31,75 - Image
JC Dalouzy
Ce système d'adaptation peut être utilisé avec deux configurations
possibles : la webcam placée directement au foyer du télescope
(intéressant pour l'imagerie solaire ou la mosaïque lunaire)
ou bien placée sur une lentille de Barlow, elle-même mise
au foyer du télescope. Si l'on veut utiliser un oculaire de
projection, il faudra concevoir un système différent et plus
complexe permettant d’insérer et de fixer dans l'adaptateur
un oculaire.

2 lentilles de Barlow et, au milieu, l’adaptateur pour la
webcam - Image JC Dalouzy
Pour l'imagerie webcam de Mars, il faut pousser la focale
du télescope jusqu'à un minimum de 4 mètres. Pour cela, on
peut utiliser une lentille de Barlow x2 ou x3 dans le cas
des télescopes de type Schmidt-Cassegrain ou Maksutov-Cassegrain,...
Et de tous les instruments possédant une focale de départ
suffisamment longue. Dans le cas des télescopes de Newton,
l'utilisation d'un oculaire de projection est mieux indiquée.
Dans tous les cas, il faudra prendre une très bonne qualité optique
et le haut de gamme des lentilles de Barlow (voici quelques exemples
de Barlow : la Meade x2 Apo, ou toutes celles de la gamme
Télévue…). Le prix de cet accessoire est de l’ordre de 150
à 200 €.
IV) Les télescopes utilisables pour l’imagerie webcam
En théorie n'importe quel instrument peut être utilisé pour
faire de l'imagerie webcam. Il s’agit là aussi d'un
avantage par rapport à l'imagerie argentique. Il y a quelques
années, il était totalement impensable d'obtenir des détails
sur Mars en photographie traditionnelle avec un télescope
de 115 mm par exemple. Mais maintenant grâce à la webcam,
on peut même utiliser une lunette de 60 mm ! Bien évidemment
la qualité des résultats sera proportionnelle au diamètre
et à la qualité optique de l'instrument. Mais chacun avec
son instrument, et même avec un instrument d'entrée de gamme,
peut obtenir des résultats intéressants et assez rapidement.
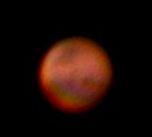
Mars lors de l’opposition 2001 faite avec un 115mm - Image
E Bonduelle
Néanmoins, l'instrument le plus souvent utilisé en imagerie
webcam planétaire est l'incontournable télescope Schmidt-Cassegrain.
Avec un rapport F/D de 10, il permet avec l'adjonction d'une
Barlow x2 ou x3 d'arriver à des focales compatibles avec une
imagerie planétaire de qualité
Cependant, j'insisterai plus sur la monture du télescope.
Il est fortement conseillé qu'elle soit équatoriale et si
possible motorisée (au moins en ascension droite) pour compenser
la rotation de la Terre et également pour éviter les rotations
de champ lors de la prise de vue. Il est assez illusoire de
faire de bonnes images webcam avec une longue focale sur une
monture azimutale.
V) Les conditions de prise de vue et le réglage de votre instrument
1) La turbulence
Même si vous possédez le meilleur instrument avec une qualité
optique parfaite, son « défaut » sera toujours qu'il est sur
Terre et donc soumis aux aléas des mouvements de notre atmosphère.
La prise de vue des planètes et de Mars en particulier nécessite
des conditions atmosphériques éminemment favorables. Par là,
il faut entendre que la turbulence doit être faible pour obtenir
des résultats intéressants.
Physiquement, il s'agit de mouvements d'air provoqués par
des masses d'air de différentes températures. C'est ce qui
fait « danser » les images au dessus d'un radiateur, ou c'est
ce qui fait scintiller les étoiles. En imagerie planétaire,
la turbulence est l'ennemie numéro 1 contre laquelle il faut
se battre constamment car elle brouille les plus fins détails
de la planète.

Mars au milieu d’une belle turbulence … Image Ph Ledoux
Elle est due à deux phénomènes : « la turbulence instrumentale
» et « la turbulence atmosphérique ». La première est due
à la différence de température entre l'instrument et l'air
ambiant. Celle-ci peut être combattue en mettant l'instrument
en température, c'est à dire en mettant le télescope à l'extérieur
pendant au moins 30 minutes avant de commencer des prises
de vue (ne pas oublier les accessoires et la webcam).
La seconde est beaucoup plus ennuyeuse puisqu'on ne peut
rien faire pour y remédier ! On peut quand même éviter la
proximité des cheminées, des maisons, des terrasses en béton,
et éviter d'observer à travers une fenêtre ouverte. Mais il
restera toujours celle de la haute atmosphère. Et là, il n'y
a qu'à attendre une belle nuit (pour en juger, regardez les
étoiles : si elles scintillent au zénith, ne sortez même pas
! Mais si elles sont parfaitement ponctuelles, même basses
sur l'horizon, attendez-vous à de bonnes conditions). Toutefois
pour juger plus précisément les conditions de turbulence,
il faut observer une étoile fortement grossie. Juste pour
indication (bien évidemment cela dépend des lieux ) : quelques
nuits par mois sont assez peu « turbulentes » et seulement
quelques nuits par an sont sans aucune turbulence !!! Il faut
donc profiter au maximum de ces rares nuits !
Cependant, il faut quand même relativiser. Même si la turbulence
est rarement nulle, lors des nuits de turbulence moyenne à
faible, il y a toujours des trous de turbulence dans lesquels
les mouvements d'air se calment et permettent d'obtenir tout
de même des images détaillées. Comme la webcam filme la planète,
on obtiendra forcément des images dans ces trous, qui seront
de bonne qualité et qu'il faudra sélectionner pour le traitement
: nous verrons tout cela en détail un peu plus loin.
2) La collimation
Voyons maintenant, un point important qui s'adresse qu'aux
possesseurs de télescope : il s'agit de la collimation. Sous
ce nom se cache tout simplement le réglage des miroirs. En
effet, un défaut d'alignement de ces derniers entraîne une
perte de luminosité et de contraste de l'image. Vous l'aurez
compris, pour l'obtention de bons résultats, il s'agit d'une
étape obligatoire avant chaque prise de vue planétaire. Je
vais la détailler rapidement
Il serait souhaitable de refaire la collimation avant chaque
prise de vue et même avant chaque pointage de l'instrument
!!! En réalité, la résolution est souvent plus limitée par
la turbulence que par la collimation. Lorsque la turbulence
est faible la collimation doit être impérativement refaite
avant la prise de vue. Je vais surtout détailler la collimation
des télescopes Schmidt Cassegrain car ce sont les instruments
les plus répandus chez les amateurs, sachant que la collimation d’un
Newton est semblable.
Une petite décollimation transforme votre Schmidt Cassegrain
en un instrument de piètre qualité. La collimation sur ce
genre d'instrument se fait en vissant ou en dévissant les
3 petites vis qui tiennent le miroir secondaire.
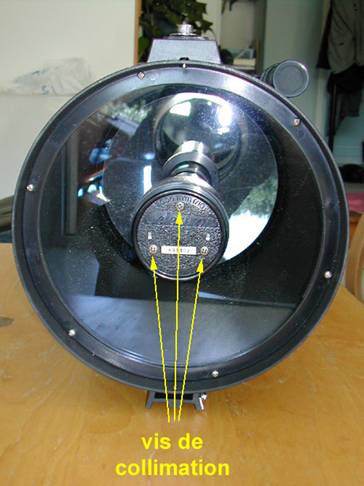
Attention, il ne faut jamais que l'une des 3 vis soient serrées
au maximum car une contrainte sur le miroir secondaire apparaîtrait,
de même, il ne faut jamais que l'une des vis soit totalement
libre car alors le miroir aurait du jeu. Dernier point : certains
télescopes comportent une 4° vis, en position centrale sur
le support du miroir secondaire, qui ne doit jamais être touchée
car c'est elle qui maintient le miroir secondaire dans le
télescope : un miroir secondaire qui se détache et vient fracasser
le miroir principal au fond du télescope est une expérience
douloureuse, tant pour le porte-monnaie que pour l'amour-propre
!
La première chose à faire lors de la collimation est d'attendre
la mise en température de l'instrument car la dilatation thermique
fait bouger l'alignement des miroirs. On pointe tout d'abord
une étoile dans le même secteur que la planète à « webcamer
», puis on prend un oculaire de longue focale et on défocalise
fortement l'étoile. On obtient alors l'image ci-dessous :

Image JC Dalouzy
Il faut que le cercle noir (qui représente le miroir secondaire)
soit parfaitement centré par rapport au grand cercle blanc. Ceci
représente la première étape. Il faut ensuite grossir environ 300
fois une étoile et la défocaliser en intra et en extra focale, on
obtient alors une image comme ci-dessous :

Image JC Dalouzy
On voit très bien un point lumineux au centre et des cercles
concentriques centrés sur cette étoile, il faut que l'ensemble
soit parfaitement centré. Si ceci est fait en intra et en
extra focale, la collimation peut être jugée comme acceptable,
c'est la seconde étape.
Mais le mieux, que je recommande de faire, et qui constitue
la troisième et dernière étape, c'est de collimater sur les
disques d'Airy. Ils s'obtiennent en grossissant fortement
une étoile (au moins 1,5 fois le diamètre de votre instrument)
et en faisant une très bonne mise au point sur l'étoile. C'est
une étape délicate qui demande des conditions atmosphériques
très propices. C'est pourquoi la majeure partie du temps,
on s'arrête à l'étape deux.
3) La mise en station
Continuons dans les réglages de l'instrument avant la prise
de vue, car je le répète, ce sont ces réglages qui vous permettront
d'obtenir de bonnes images et qui feront la différence entre
une image de qualité médiocre et une image de bonne qualité.
La mise en station est uniquement destinée aux montures équatoriales,
elle consiste à aligner l'axe polaire de la monture du télescope
vers l'étoile polaire pour permettre un suivi de qualité.
Si en imagerie du ciel profond elle doit être faite de façon
très très rigoureuse (avec la méthode de Bigourdan par exemple)
pour assurer un suivi parfait, en imagerie planétaire et webcam
en particulier, une telle mise en station n'est pas nécessaire.
Un simple alignement vers le pôle, facilité éventuellement
par le viseur polaire de votre télescope s'il en est doté,
suffit amplement.
En effet, s'il est beaucoup plus agréable de ne pas être
obligé de faire constamment des mouvements de rappels pour
garder la planète dans le champ de la webcam, on peut cependant
lui autoriser une petite dérive. Ceci est même conseillé car
les capteurs CCD des webcams possèdent souvent des défauts
ou des poussières, que le déplacement de la planète devant
ce capteur permet d'annuler lors de la phase de retraitement
numérique des images (cf chapître VII).
4) La mise au point
C'est l'action de rendre nette l'image. On emploie également
le terme de focalisation. Pour cela, on va amener le capteur
de la webcam dans le plan focal de l'instrument. La mise au
point doit être la plus parfaite possible. C'est pourquoi,
on la refait souvent entre chaque prise de vue. On peut la
faire de différentes manières : à l'aide du disque de Hartmann,
par FWHM,……
Mais, avec l'habitude, elle se fait directement sur la planète,
en regardant les images brutes sur l'écran de l'ordinateur.
Cette étape est la plus longue, la plus délicate mais c'est
très certainement la plus importante. Il faut donc la soigner.
En conclusion de ce paragraphe V, voici la récapitulation
sous forme de tableau des différentes étapes à soigner plus
ou moins pour l'imagerie webcam de la planète Mars :
| Etapes |
« A soigner » |
| La mise en température |
+ |
| La collimation |
++ |
| La mise au point |
++ |
| La mise en station |
- |
- : Peut être plus ou moins « bâclé »
+ : A soigner
++ : A soigner absolument, étape obligatoire |