|
L'été, juste à droite de la constellation du Sagittaire,
et aussi basse sur l'horizon que cette dernière, vous trouverez
la constellation du Scorpion. Au sein du Scorpion, vous reconnaîtrez
sans peine la brillante étoile Antarès, à sa
luminosité rougeâtre : il s'agit en effet d'une étoile
super-géante rouge, en fin de vie, dont la taille atteint
700 fois celle de notre Soleil. Cette étoile est arrivée
au dernier stade de sa vie, et à tout moment, elle pourrait
exploser en une Supernova. Mais rien à craindre pour nous
: Antarès est distante de 700 années-lumière
... Une autre étoile est également à surveiller
de près : l'étoile Delta du Scorpion qui, pour une
raison encore inconnue, augmente petit à petit de luminosité
depuis plusieurs mois, au point de devenir la deuxième étoile
la plus brillante de la constellation, après Antarès.
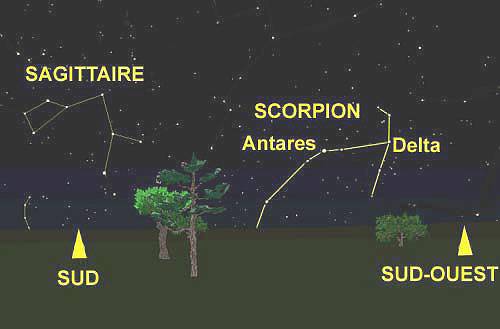
Orion était un excellent chasseur mais aussi un sacré
frimeur. Un jour, lassée de l'entendre se vanter de son invincibilité
face à tous les animaux de la Terre, la déesse Junon
décida d'envoyer un animal minuscule afin de le punir : un
scorpion. La bestiole piqua Orion au talon, lequel en mourut vite
fait, bien fait. Désespérée, la déesse
de la chasse, Diane, demanda à Jupiter de placer le bel Orion
dans le ciel. Vexée, Junon exigea qu'il en soit fait de même
pour son scorpion. Afin d'avoir la paix, Jupiter donna satisfaction
aux deux déesses mais, pour éviter toute bagarre,
il plaça chaque constellation à un bout du ciel afin
qu'elles ne se rencontrent jamais : Orion au milieu du ciel de l'hiver
et le Scorpion au milieu du ciel de l'été.

La constellation du Scorpion héberge plusieurs curiosités
visibles aux jumelles, lorsque le ciel n'est pas trop voilé
ni par la brume qui encombre souvent l'horizon de Fécamp
en été, ni par la pollution lumineuse des villes.
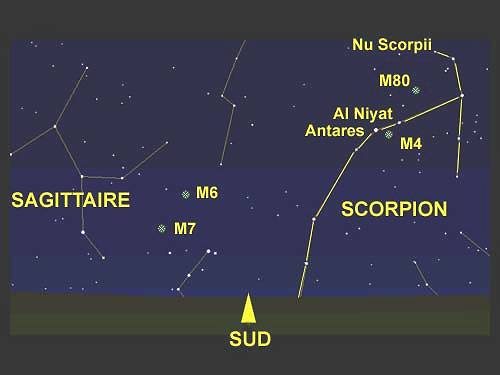
Entre le Scorpion et le bec verseur de la théière
du Sagittaire, 2 taches floues situées
au ras de l'horizon, devraient vous apparaître, si le ciel
n'est pas trop pollué : les amas d'étoiles M6 et M7,
également connus respectivement sous les noms d'amas du Papillon
et d'amas de Ptolémée, du nom de l'astronome du IIème
siècle après JC qui le découvrit. Les 80 étoiles
de l'amas de Ptolémée sont très proches de
la Terre : 780 années-lumière. L'amas du Papillon
est beaucoup plus éloigné : 1950 années-lumière.
Au télescope, avec un bon ciel transparent, l'observation
de ces deux amas est possible à condition de ne pas employer
de grossissement supérieur à 50 fois.

Un autre gros amas d'étoiles est également visible
dans le Scorpion : il s'agit cette fois d'un amas globulaire, appelé
M4, et situé juste à côté d'Antarès
: aux jumelles, il prend l'aspect d'une petite tache floue. Mais
il faut au minimum un télescope de 114 mm de diamètre
pour détailler les étoiles qui compose cet amas globulaire,
le plus proche de tous les amas globulaires, puisqu'il n'est situé
qu'à 6800 années-lumière de la Terre. Son centre
est peu dense et est barré du Nord au Sud par une ligne de
8 étoiles visibles dans un télescope de 200 mm.
Un deuxième amas globulaire est repérable dans le
Scorpion : l'amas M80, à peu près à mi-chemin
entre l'étoile Al Niyat et l'étoile Nu Scorpii. Beaucoup
moins lumineux que le précédent, vous aurez besoin
d'un ciel irréprochable pour le voir avec votre télescope.

Enfin, les heureux possesseurs d'un bon ciel et d'un bon appareil
photographique pouront espérer fixer sur la pellicule les
délicats nuages de poussières et de gaz qui nimbent
Antarès et Rhô :
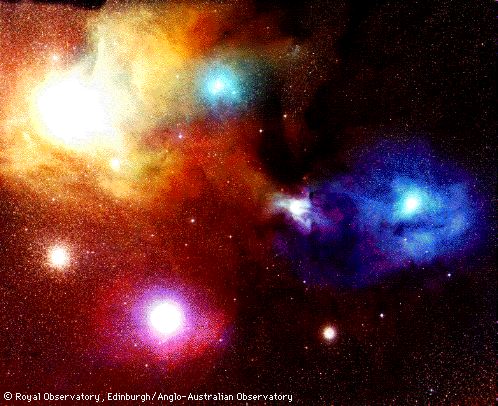
Mais la faible hauteur de la constellation du Scorpion en Normandie
devrait singulièrement vous compliquer la tache et l'observation
de ces différents objets célestes reste un véritable
défi pour l'astronome amateur fécampois. Si vous allez
en vacances dans le Sud de la France, la constellation du Scorpion
sera beaucoup plus haute sur l'horizon et vos conditions d'observation
en seront grandement améliorées. Bonne chasse, donc
!
|