|
En juillet, on trouve la constellation d'Hercule très haut dans le
ciel, juste à l'Ouest de l'étoile Vega de la Lyre.
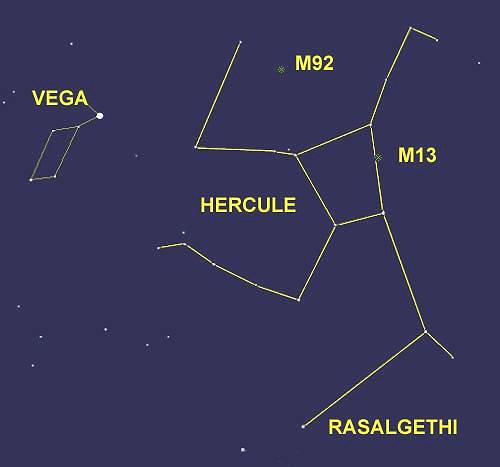
On distingue en premier le quadrilatère
qui forme le centre de la constellation d'Hercule. Puis, lorsque
la nuit commence à être bien noire, on voit les "pattes"
qui partent de chacun des 4 angles de ce quadrilatère.
L'une des ces pattes se termine par l'étoile principale
d'Hercule, qui a pour nom Ras Algethi. C'est une étoile géante
rouge dont le diamètre égale 800 fois celui du Soleil. Il s'agit
en fait d'une étoile double dont l'autre composante est également
une géante. Ce couple d'étoiles est très esthétique
au télescope, avec une composante orangée et une composante
émeraude. Autre intérêt de Ras Algethi, il s'agit
d'une étoile variable dont la luminosité varie en
90 jours environ de la magnitude 4 à la magnitude 3.
La constellation d'Hercule fait référence au héros
légendaire de la mythologie : mi-homme, mi-dieu, Hercule
était l'un des nombreux fils illégitimes de Jupiter.
D'où la haine tenace que lui voua toute sa vie Junon, la
femme de Jupiter, qui s'ingénia à pourrir la vie du
malheureux Hercule, notamment en lui infligeant 12 épreuves
toutes plus abracadabrantes les unes que les autres, les fameux
12 travaux où Hercule fut obligé de se farcir toute
une floppée de monstres particulièrement épouvantables,
travaux dont il parvint à s'acquitter au mieux grâce
à sa force colossale. Dans le ciel, la constellation représente
en fait Hercule la tête en bas.

La constellation d'Hercule est célèbre pour contenir
le plus beau de tous les amas globulaires d'étoiles du ciel
boréal : Messier 13. Situé à près de
25000 années-lumière de la Terre, cet amas a été découvert
en 1715 par Edmund Halley, avant que Charles Messier ne l'intègre
à son fameux catalogue en 1764. M13 se trouve juste à la
limite de visibilité de l'oeil et contient un nombre incroyable
d'étoiles, environ 1 million, toutes très âgées
puisque cet amas aurait environ 10 milliards d'années. Déjà,
si vous braquez vos jumelles sur le côté droit du quadrilatère
central de la constellation d'Hercule, vous distinguerez sans peine
le petit disque flou et brillant que dessine M13 dans le ciel. Mais
c'est au télescope que M13 prend toute sa dimension : n'hésitez
pas à forcer le grossissement et vous verrez alors le spectacle
féérique de ces centaines de milliers d'étoiles
agglutinées les unes aux autres.
Hercule compte également un autre amas globulaire, M92, plus petit
et plus concentré que M13. Dans une lunette de 60 mm ou un télescope
de 114 mm, on distingue le petit disque brillant de cet amas globulaire.
Mais il faut un télescope de 200 mm de diamètre pour
parvenir à distinguer les étoiles de cet amas dont
le repérage est un peu plus ardu que celui de M13.
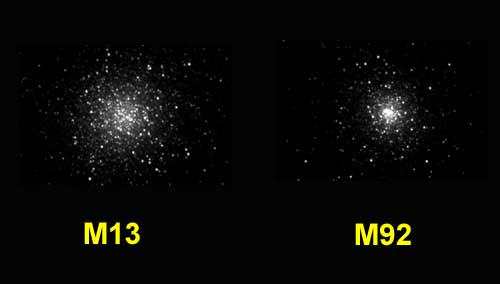
Photo Ph Ledoux - ASCT astronomie
Les amas globulaires sont des structures généralement
très anciennes, contemporaines de la naissance de notre galaxie,
et qui tournent en orbite autour du bulbe central de celle-ci. En
quelque sorte, les amas globulaires d'étoiles sont des satellites
de notre Voie Lactée. Il en va de même pour les autres
galaxies de l'univers qui possèdent, elle aussi, leurs amas
globulaires d'étoiles.

Montage Ph Ledoux - ASCT astronomie
Le télescope spatial Hubble nous a donné une photo
qui permet de mieux imaginer l'aspect qu'aurait le ciel nocturne
si notre Soleil était logé dans l'amas globulaire
M13 :
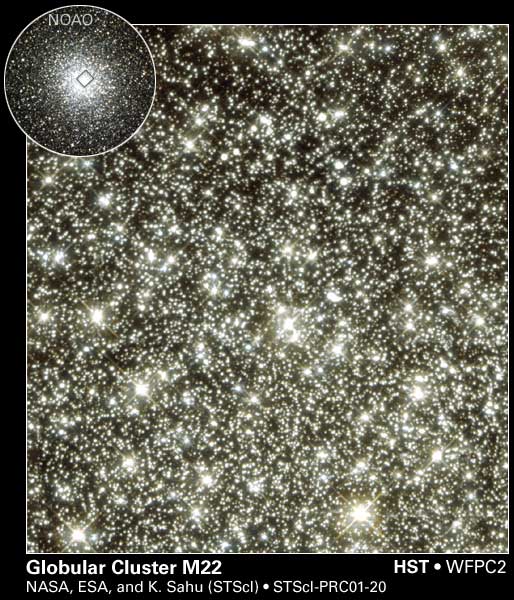
|