Toutes ces photographies ont été prises le 20 juillet
2000, au foyer du coronographe de 110 mm de l'observatoire du Centre
d'Astronomie du BRIançonnais (CABRI), grâce à
un boîtier photographique Canon EOS 50, muni d'un déclencheur
souple et d'une pellicule Fujicolor Superia Reala 100 ISO.

Photo n°1 : 08 h 40 TU, pose de 1/90 seconde.

Photo n°2 : 08 h 42 TU, pose de 1/60 seconde.

Photo n°3 : 08 h 44 TU, pose de 1/45 seconde.

Photo n°4 : 08 h 46 TU, pose de 1/30 seconde.

Photo n°5 : 08 h 48 TU, pose de 1/30 seconde.
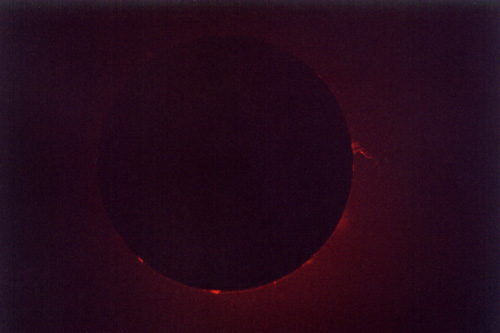
Pphoto n°6 : 09 h 00 TU, pose de 1/45 seconde.

Ah là, ce n'est pas une de nos photos mais une image
de la même protubérance solaire prise par le satellite
SOHO.
Cette énorme protubérance est très représentative
d'une forme particulière de protubérance solaire,
appelée "quiescente". Cette protubérance particulière
est créée par une boucle magnétique d'un rayon
tellement grand que cette "canalisation" magnétique sort
très largement de la zone de frontière entre la partie
basse de l'atmosphère du Soleil (= la chromosphère)
et le reste de cette atmosphère (= la couronne), au point
de ne faire apparaître qu'une partie de la boucle sous la
forme d'un pilier. Cet aspect la fait ressembler à une éruption
qui jaillirait du Soleil. Mais il ne s'agit pas d'une éruption
réelle, qui met en jeu d'autres mécanismes.Cei qui
reste encore à découvrir est le mécanisme exact
de "l'emprisonnement", de la "canalisation" de la matière
solaire dans ces boucles magnétiques. Deux hypothèses
sont en concurrence.La première hypothèse voudrait
que le champ magnétique du Soleil canalise la matière
de la chromosphère en la tirant vers les couches inférieures,
plus froides, de la basse couronne. Le champ magnétique isole
alors ce courant de matière de l'environnement de la zone
froide sur le fond de laquelle il apparaît contrasté.
Deuxième hypothèse : le champ magnétique ionise
l'hydrogène moléculaire de la zone froide de la couronne,
en lui donnant les mêmes propriétés que celui
de la zone chromosphérique immédiatement en-dessous
(émission dans la raie H-alpha de l'hydrogène), ce
qui le fait apparaître par contraste avec celui qui n'est
pas soumis à l'action du champ magnétique et qui n'est
donc pas ionisé. Dans la première hypothèse,
il y a un mouvement de matière; dans la seconde, il n'y a
qu'une modification du rayonnement de la matière par ionisation.
Les spécialistes ne sont encore sûrs de rien : mais
le plus probable en l'état actuel de nos connaissances est
que les deux phénomènes coexistent et se combinent.
|