Un énorme groupe de taches a traversé le Soleil durant
la deuxième quinzaine du mois de juillet 2004. Les astronomes l'ont
référencé sous le nom de "groupe AR 10652".

Photo Ph Ledoux / ASCT-astronomie
Ce groupe de taches a mesuré jusqu'à plus de 172 000 km
de long, soit 13,5 fois le diamètre de la Terre !!!

Photo Ph Ledoux / ASCT-astronomie
Le groupe de taches AR 10652 a même été visible à
l'oeil nu, avec des lunettes d'éclipse, durant plusieurs
jours :

Les taches solaire sont en fait des zones de la surface du Soleil plus
sombres car plus froides (3500° contre 5500° pour le reste de
la surface du Soleil). Au fil des jours, les taches apparaissent, se fragmentent,
fusionnent, disparaissent, leur durée de vie étant de quelques
semaines. Les deux images ci-dessous montrent bien l'évolution
du groupe AR 10652 en l'espace de 24 heures.

Photos Ph Ledoux / ASCT-astronomie
Observées à l'oeil nu il y a 2 000 ans par les Chinois, Galilée
fut le premier européen à observer, en 1610, la présence
de ces taches à la surface de notre étoile. En suivant leur
déplacement jour après jour, Galilée en a déduit que la rotation
du Soleil, à l'équateur, s'effectuait en 27 jours, et qu'elle était plus
lente vers les pôles. Si votre connexion ne rame pas trop, cliquez sur
l'image ci-dessous afin de télécharger l'animation (900
Ko) montrant la rotation du Soleil emportant le groupe AR 10652 entre
le 16 et le 31 juillet 2004.

Images SOHO / NASA / ESA
Puis les observations de taches se raréfièrent durant la
période 1645-1715. Cette période correspond au "petit
âge glaciaire" qui balaya l'Europe de façon inhabituelle
: la Tamise et la Seine gelèrent, les hivers furent anormalement
froids, les récoltes furent catastrophiques attisant encore un
peu plus la colère populaire qu'avaient déjà suscitées
les guerres et les fêtes somptueuses de la royauté.
L'observation systématique et quotidienne de l'activité
des taches solaires démarra en 1749 à l'observatoire de
Zurich. Depuis, le Soleil est régulièrement observé
à la loupe : observatoires terrestres (Thémis au Iles Canaries,
Pic du Midi, Paris-Meudon) et spatiaux (satellite Soho). Le nombre de
taches relevé mensuellement suit un cycle d'activité de
11 ans : au moment du maximum d'activité, plusieurs dizaines de
taches sont visibles tous les jours. A l'inverse, au minimum, il arrive
qu'il n'y en ait aucune pendant plusieurs jours d'affilée. Le prochain
maximum devrait avoir lieu en 2011.
Les taches les plus importantes comportent une zone centrale très
sombre, entourée d'une pénombre plus claire, de structure
filamenteuse.

Photo Ph Ledoux / ASCT-astronomie
Les télescopes professionnels montrent bien cet aspect filamenteux,
qui correspond à des flux de matière gazeuses
brûlante circulant entre le centre de la tache et le
reste de la surface du Soleil :

Photo Vacuum Tower Telescope - Académie Royale des Sciences de
Suède
Les taches sont fréquement entourées de zones d'hyperactivité
du Soleil, qui ont un aspect plus brillant que le reste de la surface
de ce dernier. Ces zones brillantes sont appelées "facules".

Photo Ph Ledoux / ASCT-astronomie
Les facules du groupe de taches AR 10652 vues le 25 juillet 2004 dans
la longueur d'onde de l'hydrogène H-alpha :
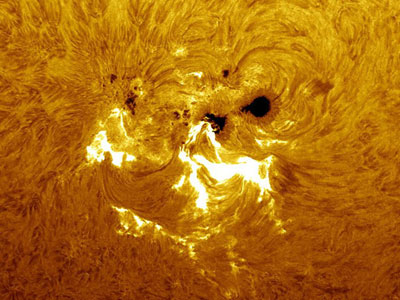
Les facules du groupe de taches AR 10652 vues le 28 juillet
dans la longueur d'onde de l'hydrogène H-alpha :
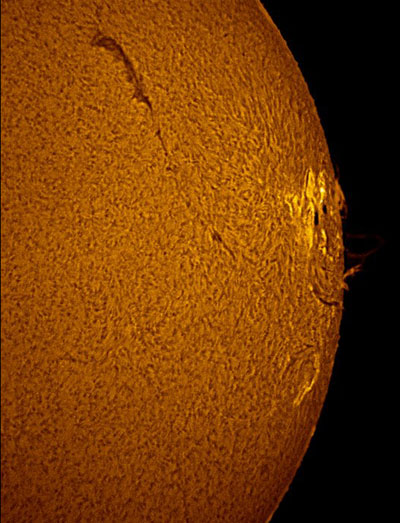
Les facules sont des zones d'intense activité du Soleil, où
les lignes du gigantesque champ magnétique du Soleil
viennent crever la surface de notre étoile, emportant
avec elles des jets de gaz brûlants, appelés
"protubérances" par les astronomes. Ce fut
le cas du groupe de taches AR10652 qui a généré
la naissance d'une énorme protubérance le 31
juillet dernier, au moment où la rotation du Soleil
allait faire disparaître la tache à nos yeux.

Parfois, ces jets sont tellement intenses que les astronomes parlent
"d' éruption solaire". Cliquez sur l'image
ci-dessous pour télécharger le film (248 Ko)
d'une éruption vue par le satellite SOHO.

Photo TRACE / SOHO / NASA / ESA
Il arrive que ces éruptions de matière traversent l'espace
pour parvenir jusqu'à la Terre où elles déclenchent
des orages magnétiques responsables d'aurores boréales.
Ce fut le cas du groupe de taches AR 10652, dans la nuit du
24 et 25 juillet 2004.

Enfin, le 31 juillet 2004, la tache AR 10652 disparaissait de notre champ
de vision, emportée par la rotation du Soleil de l'autre
côté de celui-ci.

Photo Ph Ledoux / ASCT-astronomie
|