|
L'été est une bonne saison pour visualiser une à une
toutes les étapes de la vie d'une étoile comme notre
Soleil. Pour une raison simple : c'est l'été que l'on
voit le mieux notre galaxie, la Voie Lactée, et les 200 milliards
d'étoiles qu'elle contient. Des étoiles jeunes, ou
vieilles, des étoiles qui viennent de naître ou qui
vont mourir, bref, tout un inventaire fantastique à la Jacques
Prévert, que nous vous proposons de découvrir ce soir,
une fois la nuit tombée. Commencez par placer la carte du
ciel au-dessus de votre tête, orientée vers le Sud.
Si vous tournez vos yeux en direction du Sud, vous apercevrez juste
au-dessus de l'horizon une drôle de constellation en forme
de théière : la constellation du Sagittaire. C'est
dans cette constellation que nous allons commencer notre promenade,
en y surprenant des étoiles au berceau.

La naissance des étoiles
C'est dans la direction de la constellation du Sagittaire que se
trouve le centre de notre galaxie. D'où l'extraordinaire
richesse de cette constellation en nébuleuses et en amas
d'étoiles : Charles Messier y a répertorié
15 objets dans le fameux catalogue qu'il a établi au XVIIème
siècle !!!

Le Sagittaire le 9 août à minuit dans le ciel de
Toussaint
Malheureusement, en Normandie, cette constellation est toujours
bas située sur l'horizon et les brumes de chaleur qui traînent
durant l'été gênent parfois l'observation du
Sagittaire. Mais si vous allez en vacances dans la moitié
Sud de la France, vous allez vous goinfrer de beautés ! La
longue pose photographique ci-dessous donne une bonne idée
du fouillis d'étoiles, de nébuleuses que contient
le centre de notre galaxie. Là-bas, le coeur de la Voie Lactée
bat ...

Admirez la pollution lumineuse du Havre, à gauche, et le
passage à droite d'un des nombreux avions qui zèbrent
la nuit...
Pas d'affolement, nous allons vous aider à vous y retrouver,
commencez par pointer vos jumelles sur le bec verseur de la théière,
et remontez lentement vos jumelles vous montreront une première
tache floue allongée, entourant quelques petites étoiles
il s'agit de la belle nébuleuse de la Lagune. On ne sait
pas très bien qui a découvert en premier la nébuleuse
de la Lagune : John Flamsteed en 1680 ? Le Gentil en 1747 ? Toujours
est-il que c'est en 1764 que Charles Messier décida de l'inclure
dans son catalogue des objets flous du ciel, sous le label M8.

Le Sagittaire et la nébuleuse de la Lagune au-dessus de
Toussaint - Photo Ph Ledoux - ASCT astronomie
La nébuleuse de la Lagune est en fait un immense nuage de
gaz, d'environ 115 années-lumière de diamètre,
qui est rendu luminescent par le rayonnement des nombreuses jeunes
étoiles qu'il contient. Ces étoiles sont faciles à
voir dans des jumelles. Si vous disposez d'un télescope ou
d'une lunette astronomique, ne loupez pas le spectacle de cette
pouponnière d'étoiles qu'est la nébuleuse de
la Lagune !

Et dans un télescope professionnel, vous pourriez voir
ceci :

Notre Soleil est né de la même manière, voici
5 milliards d'années, que les étoiles de la nébuleuse
de la Lagune. La seule différence est que ces dernières
sont beaucoup plus de jeunes : elles ont à peine 2 000 000
d'années. Que s'est-il passé à cette lointaine
époque ?
Il était une fois, il y a longtemps, longtemps, très longtemps,
il y a des milliards d'années ... il était une fois une gigantesque
bulle de plusieurs années-lumières de diamètre, composée de gaz
extrêment ténu. Un atome d'hydrogène par-ci, un atome d'hélium par-là
et pas grand chose entre les deux : voilà à quoi ressemblait la
nébuleuse primordiale qui devait donner naissance au Soleil ...

Photo télescope spatial Hubble
Ce nuage d'hydrogène et d'hélium n'était pas
homogène, des "grumeaux" s'y sont formés.
Sous l'effet de leur propre gravité, ces grumeaux, appelés
"proplyds" par les astrophysiciens, ont commencé
à se contracter et à s'échauffer : deux atomes
d'hydrogène en attirent un troisième, puis un quatrième
et ainsi de suite, selon un effet "boule de neige". Lentement,
très lentement. Pendant des millions d'années.

Photo télescope spatial Hubble
Petit à petit, à l'intérieur de ces grumeaux,
la chaleur et la pression ont augmenté. Jusqu'à atteindre
le point critique où pression et chaleur ont été
suffisantes pour obliger les atomes d'hydrogène à
fusionner de force pour se transformer en atomes d'hélium,
en dégageant un intense rayonnement : les réactions
thermonucléaires en chaîne venaient de se déclencher.
Une étoile venait de naître. Ainsi sont nées
les étoiles de la nébuleuse de la Lagune. C'est ainsi
qu'est né notre Soleil.

C'est celà la nébuleuse de la Lagune : un gigantesque
berceau d'étoiles en gestation.

Photo télescope spatial Hubble
Outre M8, vos jumelles devraient vous montrer dans le même
champ, juste au-dessus de la nébuleuse de la Lagune, un autre
petit nuage rond et flou : la nébuleuse Trifide, recensée
sous le nom de M20 dans le catalogue de Charles Messier.

Les nébuleuses M8 et M20 -Photo Ph Ledoux- ASCT astronomi
La nébuleuse Trifide est également une splendide
nébuleuse située, elle aussi, à 4500 années-lumière
mais elle nécessite un télescope pour commencer à
être appréciée.

Comme M8, la nébuleuse Trifide est éclairée
par les reflets des jeunes étoiles chaudes qu'elle contient,
lesquelles lui confèrent de somptueuses couleurs mais ces
dernières ne peuvent se voir qu'au moyen d'une longue pose
photographique

Photo NOAO
La jeunesse des étoiles
Si vous continuez votre balade dans la constellation du Sagittaire,
toujours en remontant la Voie Lactée avec vos jumelles, vous
distinguerez une nouvelle tache floue juste au-dessus de la nébuleuse
Trifide : il s'agit cette fois d'un amas de 40 étoiles, appelé
M21.

Les étoiles qui peuplent cet amas, situé à
4040 années-lumière, sont arrivées à
un stade plus tardif de leur évolution que celles de la nébuleuse
de la Lagune ou de la nébuleuse Trifide : alors que dans
ces nébuleuses, les étoiles venaient tout juste de
s'allumer, dans M21 on a affaire à des étoiles qui
ont déjà 4.5 millions d'années de vie et qui
se sont dégagées de la gangue de gaz et de poussières
qui leur a donné naissance.

Ces amas d'étoiles sont extrêmement fréquents
dans notre galaxie. Petit à petit, au fil des millénaires,
les étoiles composant ces amas vont se disperser au gré
des grands courants d'étoiles qui parcourent la Voie Lactée
et l'amas finira par se disloquer totalement : chacun sait qu'il
faut bien que les oiseaux quittent leur nid un jour ou l'autre.
Un bon exemple d'amas devenu extrêmement lâche est constitué
par les étoiles qui composent la constellation de la Grande
Ourse.
Mais pour l'instant, revenons au Sagittaire. Si vous poursuivez
votre lente remontée de la Voie Lactée avec vos jumelles,
vous verrez successivement 3 autres petits nuages flous et pâles,
correspondant à 3 autres nids d'étoiles, M18, M23
et M25. M25 est un amas d'environ 80 étoiles, âgé
de 89 millions d'années. M18 est également un amas
d'étoiles, mais beaucoup plus pauvre, puisqu'il ne contient
qu'une vingtaine d'étoiles âgées de 31 millions
d'années.

Enfin, M6, également appelé "l'amas du papillon",
est un splendide amas de jeunes étoiles encore entourées
d'un voile ténu de gaz. Malheureusement, il est situé
très bas sur l'horizon, en dessous du bec verseur de la théière
du Sagittaire et, de ce fait, il est rarement visible dans de bonnes
conditions depuis la Normandie, sauf en cas de ciel exceptionnnellement
clair.

Le magnifique amas ouvert M6 - Photo NOAO
Si vous n'êtes pas parvenus à repérer ces différents
amas d'étoiles, nous vous proposons plus loin une cible plus
facile : l'amas du Canard sauvage, M11, dans la constellation de
l'Ecu.
Mais revenons à la constellation du Sagittaire qui contient
encore deux belles nébuleuses accessibles à un astronome
amateur : juste au-dessus de l'amas d'étoiles M18, vous trouverez
tout d'abord une magnifique nébuleuse, M17, également
appelée nébuleuse Omega, visible aux jumelles comme
une petite tache blanchâtre allongée.

Mais c'est dans un télescope de 200 mm qu'elle devient vraiment
bien visible, avec ses nuées brillantes en forme de "L"
et les nuages de poussières plus sombres qu'elle contient.
La nébuleuse Omega constitue là encore un grand nuage
de gaz au sein duquel de nouvelles étoiles sont en train
de se condenser. Exactement comme la nébuleuse de la Lagune,
décrite précédemment.

Dans un télescope professionnel, le spectacle devient absolument
magique. Autre curiosité de cette nébuleuse distante
de 5700 années-lumière : c'est une source importante
d'émissions de rayons radio. A l'évidence, l'enfantement
de ces nouvelles étoiles se passe dans la douleur ...

Photo NTT
Enfin, une dernière tache floue est décelable aux
jumelles à la limite de la constellation du Sagittaire, à
côté de la précédente nébuleuse
: la nébuleuse M16, la nébuleuse de l'Aigle. Avec
vos jumelles, vous verrez surtout l'amas d'une vingtaine d'étoiles
que renferme cette nébuleuse située à 7000
années-lumière de nous. Cette très belle nébuleuse
correspond au même stade d'évolution stellaire que
la nébuleuse de la Lagune. Pour distinguer le cocon de gaz
qui entoure ces étoiles, il faut un télescope d'au
moins 200 mm de diamètre.

Et si vous aviez accès au télescope spatial Hubble,
vous y verriez de grands nuages sombres, appelés les "piliers
de l'univers" par les techniciens de la NASA : ce sont eux
qui contiennent les futures étoiles à naître.


Photo télescope spatial Hubble
Nous quitterons là la constellation du Sagittaire pour
aller crapahuter un instant dans la constellation de l'Ecu, située
entre les constellations de l'Aigle et du Sagittaire, afin d'y débusquer
un superbe nid d'étoiles serrées les unes contre les
autres : l'amas du Canard Sauvage, M11.

L'Ecu le 9 août à minuit dans le ciel de Toussaint
Déjà visible aux jumelles comme une petite tache
floue bien ronde, dans un petit télescope le spectacle devient
de toute beauté avec cet amas d'étoiles dont la forme
dessine effectivement un peu celle d 'un canard en plein vol (avec
un chouïa d'imagination).

Les étoiles adultes
Lorsque des étoiles s'allument, la nébuleuse gazeuse
au sein de laquelle elles se sont formées se dissipe en quelques
centaines de millions d'années.
Le gaz a servi à la fabrication des étoiles mais
aussi, éventuellement, à celle de futures planètes
qui vont, elles aussi, se condenser petit à petit autour
de leur étoile-mère.
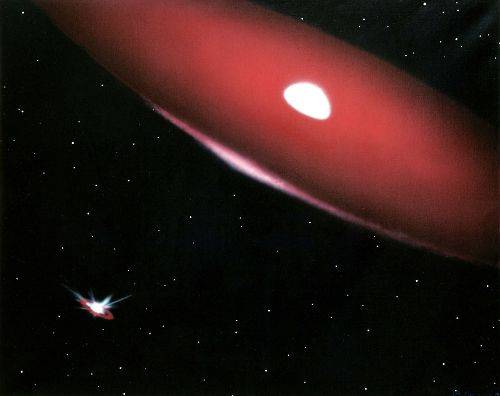
Un bon exemple de cette étape de la vie d'une étoile
est l'étoile 51 Pegasi, située à 44 années-lumière
de nous, dans la constellation du Grand Carré de Pégase,
située au-dessus de l'horizon Est
L'étoile 51 Pegasi est une étoile jumelle de notre
Soleil : même taille, même température, même
composition chimique. Elle est simplement un peu plus âgée
que notre Soleil : 8 milliards d'années contre 5. Cette petite
étoile, tout juste visible à l'oeil nu et à
première vue banale, a eu une importance historique : c'est
autour de cette étoile qu'a été découverte
en 1995 la première planète extérieure à
notre système solaire. L'exoplanète en orbite autour
de 51 Pegasi est une planète gazeuse géante, grosse
comme 0.6 fois Jupiter.

Le Carré de Pégase le 9 août à minuit
au-dessus de Toussaint
La vieillesse des étoiles
Abandonnons le Carré de Pégase et tournons maintenant
nos yeux vers l'Ouest, en direction de la constellation du Bouvier,
facilement identifiable grâce à sa forme de cerf-volant.
Elle est aisément repérable grâce à la
Grande Ourse : il vous suffit de prolonger l'arc de cercle formé
par la queue de la grande Ourse pour tomber sur une grosse étoile
très brillante, Arcturus, l'étoile principale du Bouvier.

Le Bouvier et la Grande Ourse le 9 août à minuit
au-dessus de Toussaint
Regardez attentivement Arcturus et vous constaterez que son éclat
tire nettement sur le rouge : Arcturus est une étoile géante
rouge. Elle nous montre ce que deviendra notre Soleil dans 5 milliards
d'années, lorsqu'il arrivera en fin de vie.

Photo SOHO
Lorsqu'une étoile a transformé tout son hydrogène
en hélium, elle atteint un seuil critique de déséquilibre.
Avant cette phase, il existait un équilibre stable au sein
de l'étoile entre, d'une part, l'attraction gravitationnelle
dûe à sa masse, et d'autre part, la pression de son
rayonnement. L'attraction gravitationnelle tend à amener
l'étoile à se contracter. Au contraire, la pression
de son rayonnement l'oblige à se dilater. Tant que ces deux
forces s'équilibrent, tout va bien.
Mais le jour où l'étoile a brûlé tout
son hydrogène, la force d'attraction gravitationnelle prend
le dessus et l'étoile entamera alors une phase rapide de
contraction au terme de laquelle son coeur s'échauffera à
des températures de plusieurs milliards de degrés.
Ce violent échauffement permet de relancer de nouvelles réactions
thermo-nucléaires de l'étoile : la force du rayonnement
l'emporte à nouveau sur l'attraction gravitationnelle et
l'étoile se met alors à se dilater démesurément
durant environ 100 millions d'années pour former une étoile
géante rouge, comme Arcturus. C'est ce qui arrivera aussi
dans 5 milliards d'années à notre Soleil.

Grossissant de plus en plus, le Soleil atteindra alors presque
l'orbite de la planète Mars. Mercure, Vénus et la
Terre seront englouties dans cette énorme sphère rougeâtre.

Mais ne vous inquiétez pas : tout ceci ne se produira que
dans 5 milliards d'années. Vous avez tout le temps devant
vous ! Notamment le temps de profiter de votre balade dans la constellation
du Bouvier pour braquer votre télescope sur Izar, une jolie
petite étoile double, comme il y en a tant dans notre galaxie.
Les systèmes stellaires multiples y sont extrêmement
fréquents. Notre petit Soleil solitaire fait un peu figure
d'étoile minable ... pour l'instant...

La mort des étoiles
Passons à la dernière étape de la vie d'une
étoile : qu'adviendra-t'il de notre Soleil lorsqu'il se sera
transformé en étoile géante rouge ? La constellation
de la Lyre va vous en donner une illustration.
Cette toute petite constellation est située au dessus de
votre tête, presque au zénith. Elle a une forme tarabiscotée,
composée d'un parallélépipède accroché
à un triangle. Elle est bien reconnaissable grâce à sa brillante
étoile bleutée Véga, distante de la Terre d'environ 25 années-lumière
: c'est la plus brillante de toutes les étoiles du ciel d'été et,
de ce fait, c'est la première étoile que apercevrez
lorsque la nuit commencera à tomber.

C'est dans cette constellation que se trouve l'une des plus belles
nébuleuses planétaires, située entre 1400 et 2000 années-lumière
de la Terre selon les estimations, et appelée par les astronomes
Messier 57. Cette nébuleuse est facile à repérer
avec un télescope d'entrée de gamme, de 114 mm de
diamètre, juste entre les étoiles Bêta et Gamma
de la Lyre (cf le schéma de la constellation placé
ci-dessus) : il s'agit d'une grosse bulle d'hydrogène et
d'hélium, éjectés à la vitesse de 20
km/s voici 20 000 ans par une étoile à l'agonie.

La Nébuleuse annulaire de la Lyre - Photo Ch Ferruel -
ASCT Section Astronomie
M57 préfigure ce que sera la fin de notre Soleil : après
avoir gonflé démesurément au point de devenir
une étoile géante rouge, il expulsera dans l'espace
son enveloppe gazeuse. Au centre de cette nébuleuse planétaire,
il ne restera plus que le cadavre de notre Soleil, une étoile
naine blanche qui se refroidira et se ratatinera au fil des millénaires.
Pour voir l'étoile naine blanche qui gît au milieu
de M57, il faut cependant un gros télescope, d'au moins 400
mm de diamètre. Par contre, pour voir la coquille de gaz
expulsée dans l'espace par l'étoile, un petit télescope
amateur, avec un grossissement de 50 fois, suffira à votre
bonheur. Si vous avez le télescope Hubble dans votre poche,
vous aurez droit à ceci :

Une autre magnifique nébuleuse planétaire est également
visible l'été : la nébuleuse Dumbbell, M27.
Vous pouvez la repérer en partant de la petite constellation
de la Flèche, en pointant la dernière étoile
de cette constellation avant de remonter à angle droit en
direction de la Lyre : dans le chercheur de votre télescope,
ou bien dans vos jumelles, elle aura l'aspect d'une petite étoile
floue.

Dans un télescope d'amateur, cette belle nébuleuse
aura l'aspect d'un trognon de pomme. Et dans le télescope
spatial Hubble ... mamma mia !!!!
devinez laquelle des 2 photos ci-dessus a été prise
avec le télescope Hubble ...
Ne quittez pas cette région du ciel sans jeter un petit
coup d'oeil sur l'étoile Epsilon de la Lyre. A l'oeil nu,
rien de bien folichon dans cette petite étoile de magnitude
5. Maintenant, pointez vos jumelles sur cette étoile banale
: vous la dédoublerez alors en une étoile double,
appelée Epsilon 1 et Epsilon 2 !
Encore plus fort : prenez maintenant une petite lunette astronomique
de 75 mm de diamètre, choisissez un oculaire donnant un grossissement
d'au moins 120 fois, et vous découvrirez que chacune des
2 composantes de cette étoile double est elle aussi double
! C'est la raison pour laquelle l'astronome William Herschel décida
d'appeler en 1779 ce quadruple système solaire "la double
double étoile de la Lyre". Imaginez-vous un instant
que notre Terre soit en orbite autour d'un système composé
de 4 Soleils ...

Epsilon de la Lyre vue au travers de jumelles puis au télescope
- Montage Ph Ledoux - ASCT Section Astronomie
Les Supernovae
Ce scénario de nébuleuse qui se condense en étoile,
laquelle engendre en vieillissant une étoile géante
rouge, laquelle meurt en laissant derrière elle une nébuleuse
planétaire et une étoile naine blanche, ne concerne
que les étoiles classiques, de taille moyenne, analogue au
Soleil.

Les étoiles plus massives que le Soleil connaissent une
fin infiniment plus violente : l'explosion en une supernova. Dans
ce scénario catastrophe, l'étoile ne se contente pas
d'expulser son enveloppe externe dans l'espace : elle explose intégralement
en une fraction de seconde.

Le résidu de cette gigantesque explosion se ratatine en
quelques dixièmes de secondes pour donner un astre extraordinairement
dense, appelée pulsar : une cuillère à café
de la matière dégénérée, essentiellement
des neutrons, composant ce pulsar pèserait autant que le
porte-avion Charles de Gaulle ! Les pulsars tournent sur eux-mêmes
à toute vitesse, envoyant à cadence régulière
dans l'espace un mince pinceau lumineux.

Dans le cas d'étoiles super-géantes de taille exceptionnelle,
le cadavre de l'étoile atteindra le stade ultime de concentration
de la matière : un trou noir, d'où rien ne peut s'échapper,
même pas la lumière, tant son attraction gravitationnelle
est immense.
Une bonne candidate au rôle de supernova est l'étoile
Deneb de la constellation du Cygne : cette étoile supergéante
bleue est grande comme 300 fois le Soleil et elle brûle la
chandelle par les deux bouts, illuminant le ciel à chaque
instant comme 394 438 Soleils !!! L'espérance de vie de ce
monstre se limite à quelques centaines de milliers d'années.

Quant aux restes de la supernova, ses débris gazeux vont
se disperser au fil des millénaires dans le cosmos : le Cygne
en contient un magnifique exemple, avec "les Dentelles",
somptueux enchevêtrement de gaz et de poussière expulsés
voici plusieurs milliers d'années par une supernovae. Mais
attention : en Normandie, cette délicate nébuleuse
torsadée nécessite un filtre contre la pollution lumineuse
pour être vue au télescope, juste à côté
de l'étoile 51 Cygni qui sera votre balise pour la repérer.
En Normandie, son observation nécessite donc du bon matériel
astro.

Les Dentelles du Cygne, également appelées NGC6992
Le satellite Chandra, spécialisé dans l'observation
du ciel dans les longueurs d'ondes des rayons X, a réussi
à repérer le pulsar issu de l'explosion de la supernova
des Dentelles du Cygne :
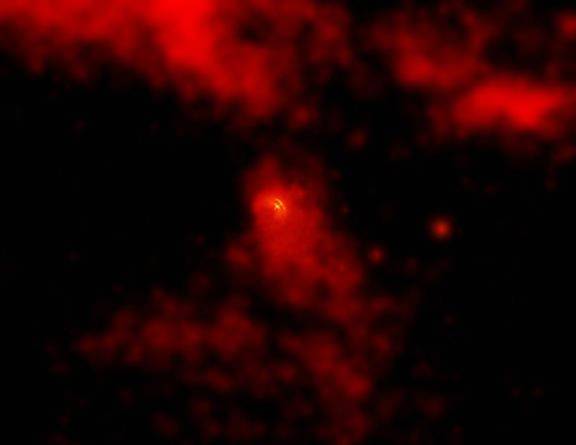
Que deviennent ensuite les débris de la supernova ? Ils
vont continuer à se répandre dans notre galaxie, où
ils vont ensemencer les grands nuages d'hydrogène qui y dérivent
: de cette onde de choc naîtront alors de nouvelles nébuleuses
qui donneront un jour lointain naissance à de nouvelles étoiles
et à de nouvelles planètes. La grande boucle de la
vie et de la mort des étoiles sera alors achevée.
Pour finir cette belle promenade dans le ciel de l'été,
tournez votre télescope vers l'étoile formant l'autre
extrêmité de la constellation du Cygne : Albiréo.
Ce sera votre cadeau de fin de soirée : votre télescope
vous montrera qu'Albiréo est sans doute la plus belles des
étoiles doubles du ciel de l'été. Vous pourrez
admirer un Soleil rouge et un Soleil bleu en orbite l'un autour
de l'autre.
Si vous souhaitez aller plus loin dans votre découverte
des constellations de l'été et des nombreuses nébuleuses
et amas d'étoiles qu'elles contiennent, vous trouverez un
dossier plus
complet destiné aux possesseurs de télescopes
Les enseignants et les animateurs de club peuvent également
télécharger sur le site Internet d'Yves Lhoumeau,
maniaque binoculaire bien connu dans le milieu des astronomes amateurs,
un fichier et un manuel complets afin de réaliser eux-mêmes
des diapositives des
constellations du ciel (cliquez sur "diaporama à
fabriquer").
Si vous disposez d'un télescope et que vous souhaitez disposer
d'une aide complète et en même temps facile à
utiliser pour un débutant, nous vous recommandons chaudement
le CD-Rom Astrothèque 2000 : un atlas du ciel comprenant
220 objets détaillés comme nulle part ailleurs avec les cartes,
les photos, les explications et les dessins indispensables pour
les repérer, des éphémérides interactives
vous permettant de tout savoir sur ce qui se déroulera au cours
de la nuit, un atlas lunaire, une banque de plus d'un millier de
photos et dessins d'astronomes amateurs commentés, des cartes du
ciel, fiches et maquettes prêtes à être imprimées, un pilotage dans
le système solaire en 3D : bref, une vraie petite merveille que
nous utilisons très régulièrement à
Toussaint pour préparer nos soirées d'observation
du ciel. Pour plus de renseignements, cliquez sur l'image ci-dessous.

|